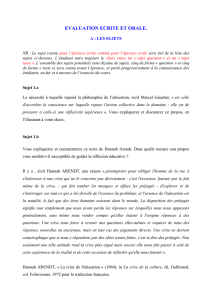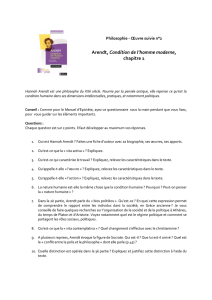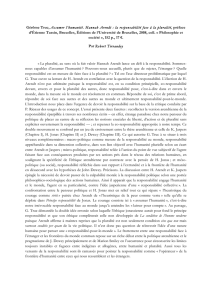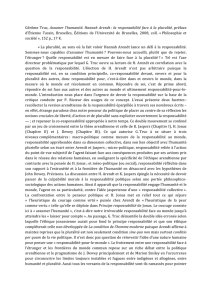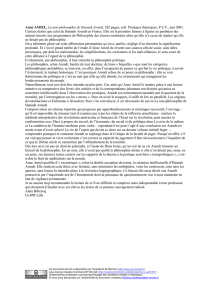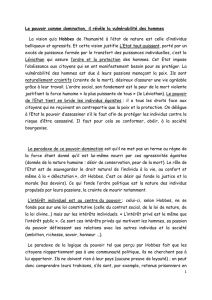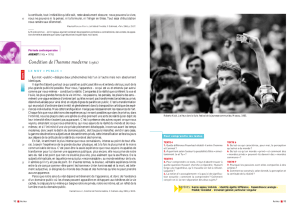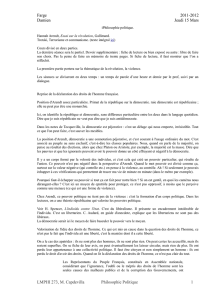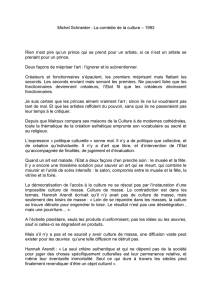Araben, Volume 6, "Hannah ARENDT : de la théorie

ARABEN
Revue du GREPH
Groupe de Recherche en Epistémologie Politique et Historique
Institut d’Etudes Politiques de Lyon
Hannah ARENDT :
de la théorie politique
aux relations internationales
N°6
Octobre 2011
1

ARABEN
Revue du GREPH
Groupe de Recherche en Epistémologie Politique et Historique
(Laboratoire Education, Cultures et Politiques
Université Lumière-Lyon2
EA 4571)
Directeur de la Publication :
Jacques MICHEL
Secrétaire de Rédaction :
Marie-Pierre ESCUDIE
Comité scientifique :
François DAGOGNET (Univ. Paris1),
Hervé GUINERET (Univ. Dijon),
Pierre-François MOREAU (ENS-LSH, Lyon), Sophie PAPAEFTHYMIOU (IEP Lyon)
Michel PINAULT, Gilles VERGNON (IEP Lyon),
Loïck VILLERBU (Univ- Rennes 2)
Comité de Rédaction :
Daniel DUFOURT, Francis SANSEIGNE,
Gilles VERGNON
GREPH
Institut d’Etudes Politiques
14, avenue Berthelot
69365 Lyon cedex 07
contact : [email protected]
ISSN : 1778-0772
2

Pourquoi ARABEN ?
Claude Lévi-Strauss nous le rapporte (La potière jalouse, 1985) : Araben est le
nom donné dans un mythe munducuru (peuple indien d’Amazonie) à une demoiselle
Paresseux (Bradypus tridactylus, mammifère d’Amérique du sud) qui résistait aux avances
d’un indien en médisant sur la première femme de son soupirant.
Pour les Indiens les paresseux sont dotés de qualités sociales et culturelles : ils
sont menteurs et jaloux mais également ingénieux et habiles. Ils savent tant triompher des
pièges que leurs tendent leurs rivaux que tirer parti de l’environnement. A tel point que « du
temps que les paresseux étaient pareils aux humains » les femmes-paresseux étaient très
recherchées par les hommes : elles faisaient « les meilleures tisserandes et les meilleurs
épouses », sachant parfaitement administrer une économie domestique.
Le mythe développe certains traits de comportement du Paresseux : économe
de sa nourriture comme de ses mouvements, propre et ordonné, « il apparaît, nous dit
l’anthropologue, comme un animal naturellement bien élevé qui peut servir de modèle
culturel », et « il n’est pas surprenant que les Indiens lui attribuent une compétence
particulière en matière de tissage, le plus complexe et le plus raffiné des grands arts de la
civilisation, et celui que des sociétés d’un niveau technique rudimentaire ont su porter à un
haut degré de perfection ».
Pourquoi ARABEN ? – Parce qu’il nous a plu de retrouver ailleurs que dans
des sources plus « académiques » cette image du tisserand, symbole technique de l’art de bâtir
une société.
J.M.
3

Note de l’éditeur
Le GREPH (Groupe de Recherche en Epistémologie Politique et Historique)
accueille avec bonheur pour le numéro 6 de sa revue Araben les travaux réalisés par le groupe de
travail Krisis sur la portée de la pensée d’Hannah Arendt pour l’analyse et la compréhension des
relations internationales.
Le GREPH, qui a, depuis sa création, cherché à dépasser les cloisonnements
académiques et disciplinaires, se réjouit d’autant mieux de cette publication que celle-ci prouve de
manière convaincante combien est productive pour la construction lucide d’un problème
l’association de chercheurs d’origines différentes.
Jacques MICHEL
4

Hannah ARENDT :
de la théorie politique
aux relations internationales
SOMMAIRE
Introduction
par Ninon Grangé, Pierre-François Moreau, Frédéric Ramel
6
Expérience et conceptualisation.
Comment se pensent les révolutions ? Comment les penser ?
par Anne Amiel
8
Les « Religions politiques » : le débat Arendt / Voegelin.
par Sylvie Courtine-Denamy
22
De l'unité du monde à la pluralité internationale
par Frédéric Ramel
31
Les éléments totalitaires des sociétés post-totalitaires
par Étienne Tassin
44
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
1
/
52
100%