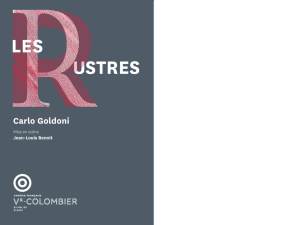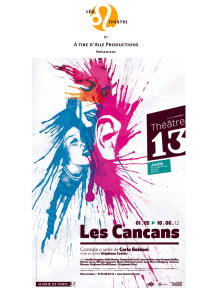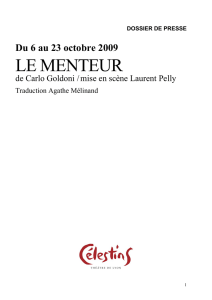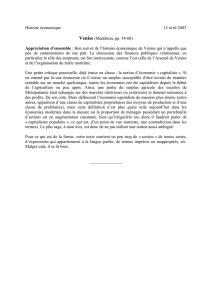Une des dernières soirées de Carnaval

1
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Une des dernières soirées de Carnaval
Carlo Goldoni
Hervé Van der Meulen
Au Théâtre Montansier
Du mardi 4 au samedi 8 février 2014 à 20h30
Durée : 2h30 avec entracte
Théâtre Montansier
13 rue des Réservoirs – 78000 Versailles
www.theatremontansier.com

2
Le texte
Une des dernières soirées de Carnaval
fut créée le 23
février 1762 à Venise dans le théâtre qui porte
aujourd’hui le nom de l’auteur.
Carlo Goldoni a déjà cinquante-cinq ans. Il a triomphé
sur les scènes vénitiennes et peaufiné au fil des ans
la réforme qui lui tient à cœur et qui consiste à rendre
un contenu psychologique et social et un langage aux
masques de la
Commedia dell’Arte
abâtardie. Mais il
est las des incessantes attaques de ses adversaires,
en particulier celles de l’atrabilaire Comte Carlo Gozzi
qui soutenait un théâtre de féeries et détestait le
réalisme des pièces de son compatriote. Goldoni songe à quitter Venise. L’occasion se
présente ; il est invité à Paris par les acteurs de la
Comédie-italienn
e.
Il écrit dans ses
Mémoires
, rédigées en français à la fin de sa vie : « Voici la dernière pièce que je
donnai à Venise avant mon départ
Una delle ultime sere di Carnevale
(La soirée des jours Gras)
comédie vénitienne et allégorique dans laquelle je faisais mes adieux à ma patrie. Zamaria,
fabricant d’étoffes, donne une fête à ses confrères et y invite Anzoletto qui leur fournissait les
dessins ; l’assemblée des fabricants représentait la troupe de comédiens et le dessinateur,
c’était moi. Une brodeuse française, appelée Madame Gâteau (remarquons que Goldoni corrige
ici l’orthographe du nom de ce personnage qu’il nomme en 1762 Madama Gatteau) se trouve
pour des affaires à Venise. Elle connaît Anzoletto, elle aime autant sa personne que ses
dessins, elle l’engage, et va l’emmener à Paris. » Lapsus de l’auteur ?
En fait, Anzoletto part en Moscovie, métaphore du futur voyage en France de l’auteur, pays
dans lequel Goldoni mourra dans la misère en 1793 après avoir fréquenté Versailles et enseigné
l’italien à Mesdames, les filles de Louis XV et aux sœurs de Louis XVI. Il se souvient : « Je puis
dire que le peu de français que je sais je l’ai acquis pendant les trois années de mon emploi au
service de Mesdames. Elles lisaient les poètes et les prosateurs français, elles les répétaient
avec grâce et élégance ». Goldoni reconnaît implicitement par là qu’en 1762, il connaissait mal
notre langue. Il l’écrivit fort bien ensuite : sa pièce
Le Bourru bienfaisant
en témoigne ; elle
triompha à la Comédie-Française en 1771.
Pour prendre congé de son public, Goldoni a le bon goût d’écrire
Une des dernières soirées de
carnaval
, sa comédie des adieux, en vénitien. Seule la vieille et ridicule brodeuse française ne le
parle pas mais elle le comprend. Ce personnage comique, que le public voit arriver avec plaisir,
s’exprime à la fois en un italien souvent déformé et en un français désuet et précieux. Sans
doute Goldoni exorcise-t-il, à travers elle, sa peur de s’expatrier en France.
Dans la pièce nous avons donc trois langues ; le vénitien (proche de l’italien), l’italien
baragouiné par Madame Gatteau et un français désuet ; nous avons laissé les répliques de
Madame Gatteau telles que Goldoni les avait écrites.
À travers les mots des personnages, aussi bien au deuxième acte durant le jeu de cartes
typiquement vénitien de
La Meneghella
(dont Goldoni donne les règles dans sa préface) qu’au
troisième acte durant le repas, ce sont les sous-entendus et les double sens qu’il faut
décrypter. Et si dans la pièce le comique est présent, la nostalgie parcourt néanmoins
l’ensemble de la comédie.
Comme si Goldoni devinait qu’il ne reviendrait jamais dans sa chère patrie. Une des dernières
répliques, attribuée à la jeune et raisonnable maîtresse de maison, Domenica, résume bien
l’humeur de Goldoni, pressentant la fin d’une époque de sa vie et obligé d’y faire face : tandis
que les chandelles se consument, Domenica déclare : « Allons, finissons de jouir d’une de nos
dernières soirées de Carnaval ! »
Huguette Hatem

3
ACTE I. La ronde des invités
Nous sommes chez un tisserand, à Venise, pendant le Carnaval. Évoqués par les personnages,
les lieux de Venise en fête, les bruits de l'extérieur vont venir contaminer cet "intérieur vénitien".
Car le fabricant de tissus Zamaria a bien l'intention, lui aussi, de s'en donner à cœur-joie ! Il
annonce le programme de la soirée à ses jeunes ouvriers : souper et danses. Il les y convie. Pour
sa fille, Domenica, il énumère les invités : son ami tisserand Lazaro avec sa femme Alba, le
marchand de soie Bastian et son épouse Marta, sa filleule Elenetta et son mari Agustin, le
dessinateur Anzoletto, la fileuse d'or Polonia et le calandreur (1) Momolo. Justement, voici
qu'arrivent les invités : Elenetta et Agustin qui se chamaillent pour un rien, Marta et Bastian qui
ont l'air d'aimer vivre et se moquer, Momolo qui est manifestement en bisbille avec Polonia,
Lazaro et Alba, Polonia qui apprend à Domenica qu'Anzoletto vient de recevoir une proposition
pour aller travailler en Moscovie, Anzoletto qui confirme son prochain départ. On comprend que
Domenica aime Anzoletto... Va-t-elle le laisser partir pour la Moscovie en compagnie d'une
vieille brodeuse française nommée Madame Gatteau ? Anzoletto va-t-il préférer sa carrière à
l'amour de Domenica ?
ACTE II. La partie de meneghella
Zamaria apprend que son dessinateur attitré,
Anzoletto, le quitte pour la Moscovie. Avant le
souper, il propose une partie de cartes à ses
invités. À l'instigation de Marta, ce sera une
partie de meneghella (2), un jeu qui se joue par
équipe de deux. Les couples de joueurs se
forment. Tout le monde joue, sauf Zamaria.
Pendant la partie, on échange divers propos...
En fait, c'est surtout d'amour qu'il est question.
Anzoletto propose à Domenica de l'épouser et
de l'emmener avec lui en Moscovie. Mais
Zamaria, le père, y consentira-t-il ? Survient la
vieille brodeuse, Madame Gatteau, qui avoue à
Domenica qu'elle est amoureuse d'Anzoletto...
ACTE III. Le souper
Alba ne va décidément pas bien ; cette fois, c'est le parfum de la Gatteau qui l'incommode !
Polonia est toujours irritée par Momolo. Et voici qu'Anzoletto annonce une bien mauvaise
nouvelle : Zamaria ne veut rien savoir, sa fille ne partira pas en Moscovie, elle ne se mariera
point. Madame Gatteau avoue son amour à Anzoletto qui la rabroue. Elle se rabat sur Zamaria :
il est veuf ; il est "frais, robuste, adorable". Momolo se moque d'elle mais se lamente de n'être
pas marié. Dans la salle à manger, où une table a été dressée, Zamaria place ses invités : il
sépare délibérément Domenica d'Anzoletto, Polonia de Momolo. Dénouement heureux :
l'astucieuse Marta suggère à Zamaria d'accompagner Domenica et Anzoletto en Moscovie...
Momolo, lui, se propose pour gérer les affaires de Zamaria pendant son absence... Polonia
prend le bras de Momolo : oui, elle l'épousera... Zamaria demande à Madame Gatteau d'être sa
femme... Domenica sera celle d'Anzoletto... Trois mariages d'un coup ! Que le bal commence !
(1) La calandre était une machine, formée de cylindres et de rouleaux, qui servait à lustrer ou moirer les étoffes.
(2) La meneghella se jouait avec cinquante-deux cartes. Selon Goldoni, une partie pouvait réunir jusqu'à seize
joueurs (par équipes de deux).

4
L’auteur
Source:
Dictionnaire des Auteurs
, Editions Robert Laffont, Collection dirigée par Guy Schoeller
Carlo Goldoni
Auteur dramatique italien né le 25 février 1707 à Venise, de Giulio
Goldoni et de Margherita Salvioni, mort à Paris le 6 février 1793.
Après trois ans d’études à Pérouse, il s’initia à la philosophie
(1720) chez les dominicains de Rimini, mais une troupe de
comédiens venus jouer dans cette ville l’attira plus que les leçons de
logique du Père Candini, et lui arriva de s’échapper, grâce à la barque
des religieux, qui reliait directement Rimini à Chioggia, où résidait sa
mère. Il y retrouva son père, et ce dernier, qui exerçait la médecine,
tenta de lui en donner le goût en l’emmenant avec lui dans ses
visites aux malades. Ce fut en vain ; le seul résultat de ces
démarches fut d’engager le jeune homme dans une aventure assez
scabreuse dont il se tira à temps. Le médecin décida alors d’orienter différemment les études
de son fils. En 1728, Carlo prit la tonsure et fit son droit au collège Ghisleri de Pavie. Il y demeura
au moins trois ans, partageant son temps entre l’étude et le plaisir, jusqu’au jour où, une cabale
ayant été montée contre lui par quelques étudiants, il fut expulsé et embarqué en direction de
Chioggia. Dans cette ville, puis à Feltre, il mit à profit ses connaissances juridiques comme
adjoint au coadjuteur du chancelier aux affaires criminelles, sans toutefois renoncer aux
distractions de son âge.
Après la mort de son père (1731), Goldoni, ayant soutenu à Padoue sa thèse de doctorat,
commença de professer à Venise. Déjà lui souriait le succès lorsqu’une nouvelle aventure
sentimentale, plus délicate que les précédentes, l’obligea de quitter la ville. Goldoni se rendît à
Milan, emportant avec lui le manuscrit de l’
Amalasunta
, une tragédie lyrique qu’il allait bientôt
livrer aux flammes. En revanche, son
Bélisaire
(petite croix), représenté le 24 novembre 1734 à
Venise, connut un grand succès. La pièce était jouée par la compagnie Imer dont Goldoni
devint sans tarder le poète officiel. Les années suivantes ne furent qu’un prélude dont quelques
épisodes seulement méritent d’être retenus parce qu’ils contenaient en germe cette sorte de
vision comique si particulière à son talent. Suivant la troupe dans un de ses voyages à Gênes, il
y épousa Nicoletta Conio, fille d’un notaire, qui fut l’affectueuse compagne de sa longue vie.
Dans la période qui suivit son mariage, il s’éloigna progressivement de la
Commedia
dell’Arte
, d’abord avec discrétion dans
Momolo, homme accompli
[
Momolo Cortesan
, 1739],
puis d’une façon éclatante dans la
Brave femme
[
Donna di garbo
] dont il donna lecture aux
comédiens en 1743. Une série de déboires, cependant, l’empêchèrent de quitter Venise. Durant
les cinq années qui suivirent, Goldoni erra avec sa femme en Romagne et en Toscane. Puis il
exerça avec succès, pendant trois ans, au barreau, sans que les pandectes lui fissent oublier la
muse, si bien qu’en 1748, à force de plaider pour la troupe Medebac, il en devient le poète
attitré.Dès lors, pour Goldoni s’achevait la période d’initiation. Les quatorze années suivantes
(cinq au Théâtre San Angelo, avec Medebac, et neuf à San Luca, avec Vendramin) furent
décisives. De la première période datent, parmi beaucoup d’autres comédies,
La Veuve rusée
(1748),
La Famille de l’antiquaire ou La belle-mère et la belle-fille
(1749). Il donna ensuite, par
défi, seize pièces en une seule année (1750), notamment
Le Café
[
Bottega del cafè
],
Le
Menteur
,
Les Caquets des femmes
, puis
Les Femmes jalouses
(1752),
La Locandiera
(1753), et
Les Curieuses
[
Le Curiose
]. Ses débuts à San Luca ne furent pas heureux, pour cette raison
surtout qu’afin de complaire au public, attiré par les comédies de l’Abbé Chiari, son rivale, il dut
sacrifier au genre romanesque. Goldoni, pour autant, ne négligeait pas son théâtre de
caractère. Chaque année, en effet, il donnait une de ses comédies dans le goût vénitien

5
populaire, appelées par lui tabernari, comme le Massere, les
Dames de Casa soa
[
Donne de
Casa soa
], le
Campiello
. À San Luca, dans les derniers temps, le poète vit surgir un autre rivale,
plus intelligent et plus dangereux que Chiari, Carlo Gozzi. Ce fut entre eux une guerre à mort et,
comme Gozzi ne daignait même pas épargner Chiari, celui-ci fit alliance avec son ancien
adversaire, Goldoni. Mais la meilleure réponse était celle du génie. Les dernières années à San
Luca furent particulièrement fécondes. Citons :
Les Amoureux
(1759),
Les Rustes
(1760),
La
Folie de la villégiature
(1761),
Todero Brontolon
(1762) et
Les Querelles de Chioggia
(1762).
Cependant, dès le mois d’août 1761, Goldoni avait reçu de la Comédie italienne de Paris une
invitation à se rendre dans cette ville pour y occuper un emploi pendant deux ans. N’étant point
parvenu à se faire, dans sa patrie, la situation à laquelle il prétendait, l’écrivain, à contre cœur,
donna son acceptation. Avant son départ, toutefois, il fit ses adieux à Venise avec la comédie
allégorique
Une des dernières soirées de Carnaval
[
Una delle ultime sere di Carnevale
], et le
public, saisissant l’allusion lui exprima son remords en criant : « Reviens vite ». Mais Goldoni ne
devait plus revenir. Le 22 avril 1762, accompagné de sa femme, de son fils et de son frère, il
partit pour Paris. Une déception l’y attendait. À la Comédie italienne il ne donna que des
scénarios, et de nouveau, dut se plier à une forme de théâtre qu’il avait entièrement dépassée.
Mentionnons seulement
Camille et Arlequin
[
Camilla e Arlecchino
], devenue plus tard
Les
Amours de Zelinda et de Lindoro
et
L’Éventail
, que l’auteur remania avant de la destiner à San
Luc. Les deux ans écoulés, Goldoni demeura à Paris, ayant été nommé professeur d’italien
des filles de Louis XV. Établi à Versailles, il fut attaché à la Cour, mais une série de deuils ayant
frappé la famille royale, les études d’italien passèrent au second plan, ce qui d’ailleurs,
n’empêcha pas le professeur de toucher son traitement. Il quitta Versailles pour Paris et, se
livrant à son inspiration favorite, écrivit en français
Le Bourru bienfaisant
. C’était la dernière
comédie (1771) vraiment digne de ce nom, et
L’Avare fastueux
, donné en 1773, ne fut qu’un
assez faible écho de ses réussites précédentes. En 1776, le poète fut appelé de nouveau à
Versailles pour enseigner l’italien aux sœurs de Louis XVI, mais dès la fin de l’année, craignant
de ne pas s’adapter à l’air de la Cour, il obtint que sa charge fût transférée à son neveu et
s’installa définitivement à Paris.
Des treize dernières années qu’il y vécut on a peu de chose à dire. De 1784 à 1787, il composa
ses
Mémoires
, sa dernière comédie, pourrait-on dire : la comédie de sa vie. Paris lui plaisait de
plus en plus, mais l’Italie était toujours dans son cœur. On eût dit que, de loin, il découvrait en
elle des beautés toujours plus grandes, et jamais il ne laissait passer l’occasion de faire valoir
les ouvrages marquant de la littérature italienne. Ses
Mémoires
terminés, Goldoni vécut encore
six années lourdes d’événements, au milieu desquels cet homme peu habitués aux remous de
la politique devait se sentir un peu perdu. À cela s’ajoutaient une santé précaire et la gêne,
lorsque le nouveau gouvernement l’eut privé de sa pension. Il mourut en sa modeste maison de
la rue Saint Sauveur. Or le lendemain, Marie-Joseph Chénier, ignorant la triste nouvelle,
obtenait que sa pension lui fût restituée.
Si l’on voulait découvrir le très fondamental et révélateur de l’âme de Goldoni, ce serait,
semble-t-il, une tendance à s’accommoder des obstacles que l’existence nous oppose. Sans
doute serait-on tenté d’appliquer à un tel caractère l’étiquette commode de l’optimisme. Mais
alors, ce qu’il y a d’essentiel en Goldoni nous échapperait. Cet homme que ne décourageait
point l’adversité se montrait, au sein du bonheur, accessible à l’inquiétude. En pleine euphorie,
une crise mystique pouvait le surprendre. L’autre aspect de Goldoni, cependant, ne laisse pas
de se manifester, et telle est sa double nature que, s’il acquitte, c’est, au fond, pour condamner.
Il absout, en effet, la nature humaine de ses fautes, pour ne condamner que l’erreur, et autant la
faute est superficielle, autant l’erreur est profonde : il a soin de n’en épargner aucune. Mais il ne
lui suffit pas d’avoir fondé son œuvre sur cette impitoyable domination de l’erreur, il tient à
montrer, en outre, qu’il ne la croit guère curable. Sans doute, dans un moment de crise, peut-il
arriver que le personnage se voie tel qu’il est, mais sa clairvoyance sera de courte durée. Et si,
d’aventure, il nous fait assister à quelque très rare conversion, le poète aussitôt nous fait
comprendre qu’il est le premier à ne pas y croire. Pour cette dénonciation courageuse – en plein
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%