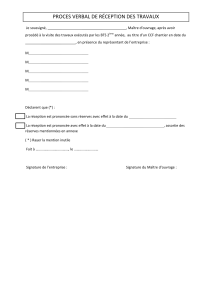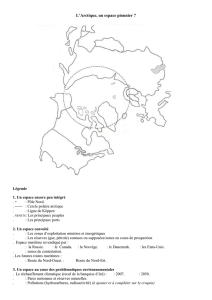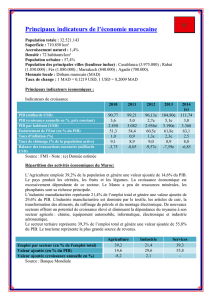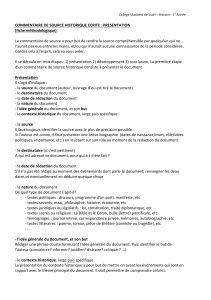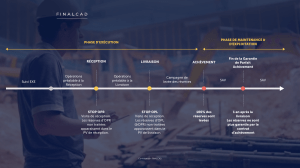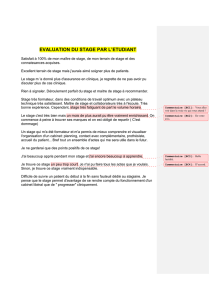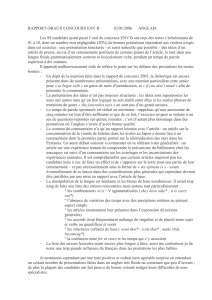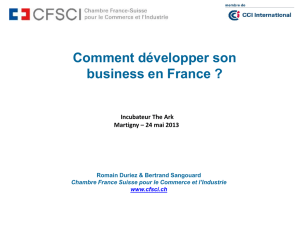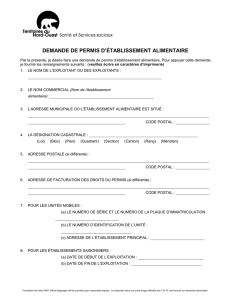PAYS EMERGENTS – L`actualité de la semaine

Études Économiques Groupe
http://etudes-economiques.credit-agricole.com
Hebdomadaire – N°16/088 – 25 mars 2016
PAYS EMERGENTS – L'actualité de la semaine
Éditorial – Réserves de change : le prix de la confiance
En matière de politique monétaire, dans la plupart des pays émergents, il est un indicateur tout aussi
suivi que le taux d’intérêt directeur : les réserves de change. Celles-ci expriment, en effet, le lien
entre une politique monétaire et le risque de change, voire de liquidité, dans un pays. Alors que les
spéculations sur le niveau approprié des réserves chinoises sont de plus en plus fortes, quelle est la
pertinence de l’analyse de ces réserves ?
D’abord la composition, la comptabilité et la lisibilité statistique : les dépôts des banques locales
auprès de la Banque centrale sont-ils mobilisables ? Quid de la prise en compte des fonds
souverains ? Difficile de trancher sur ces questions, car il n’y a pas de consensus fondé sur les
données historiques. Le cas de la Turquie est symptomatique : ses réserves sont de plus de
100 milliards de dollars, mais composées en grande partie de dépôts des banques, dont on ne sait
pas clairement s’ils seront mobilisables assez rapidement en cas de crise de liquidité systémique
(qui toucherait aussi le secteur bancaire)… Le premier problème est donc celui du manque de
transparence, qui pénalise toute tentative de comparaison.
L’utilité des réserves de change est (en apparence) moins sujette à controverse : prévenir une crise
de liquidité et réduire les tensions sur la devise (cf. rubrique Amérique latine). Si les objectifs sont
clairs, la pertinence des indicateurs l’est moins, car les crises de liquidité et les tensions sur la devise
relèvent aussi (surtout ?) de la défiance des acteurs économiques. Dès lors, la pertinence des ratios
dépend de leur capacité à assurer la confiance des agents dans les Banques centrales.
La couverture d’un nombre de mois d’importations ou celle du besoin de financement annuel sont
deux ratios reconnus comme une bonne estimation du niveau suffisant de réserves. Cependant, ces
ratios n’évaluent pas tous les types de risques,
notamment parce qu’ils sont le fruit de l’analyse des
crises passées, et qu’ils captent mal les évolutions
actuelles des comportements financiers. Compléter
l’analyse par d’autres indicateurs met donc en lumière
des risques moins bien perçus. Ainsi, l’indicateur
pondéré d’adéquation des réserves créé par le FMI
prend en compte la masse monétaire M2 (pour
anticiper les potentielles fuites de capitaux) et les
recettes d’exportation (pour prévenir une éventuelle
chute des recettes d’exportation). La perspective est
alors toute autre, et les réserves de change de la
Chine, par exemple, semblent moins confortables (du
fait de l’importante masse monétaire M2 qui représente plus de cinq fois le montant des réserves –
l’existence d’un contrôle des capitaux réduit toutefois ce risque…), de même que celles des pays
pétroliers (puisqu’ils font face à une forte baisse des recettes d’exportation).
Malgré la perfectibilité des indicateurs et les risques liés aux effets de seuils, la trajectoire des
réserves de change demeure donc un bon révélateur de la confiance dans les autorités du pays.
Mais l’assurance apportée par un bon niveau de réserves ne peut pas remplacer celle donnée par
une politique économique lisible. Puiser dans les réserves suffit rarement à rassurer sur la pérennité
d’un change fixe, mais cela permet d’acheter du temps pour réformer (ou se payer le luxe d’attendre
des jours meilleurs…).
Les faits marquants de la semaine
La Pologne réduit son déficit courant. La Russie a
de meilleures statistiques depuis deux mois. Aux
Émirats Arabes Unis, la diversification de
l’économie amortit les effets de la chute du prix du
pétrole. El Niño et la sécheresse auront des effets
en Afrique australe et orientale en 2016. La Chine
accentue ses contrôles sur Internet. En Amérique
latine faut-il se servir des réserves en devises ou
pas ?

Pays émergents : L'actualité de la semaine
N°16/088 – 25 mars 2016
- 2 -
Europe centrale et orientale, Asie centrale
Pologne – Réduction du déficit courant
Le déficit courant polonais est en constante
contraction depuis 2010. Les efforts de com-
pétitivité de l’économie polonaise ont permis
de passer en cinq ans d’un déficit courant de
4% du PIB à pratiquement un équilibre des
comptes extérieurs (-1,5%) en 2015. La
hausse des exportations a été le principal
moteur contribuant à l’amélioration de la
balance commerciale, mais les prix bas de
l’énergie ont également contribué à la baisse
de la facture des importations.
Ces résultats (surtout en ce qui concerne les
exportations) sont le produit d’une stratégie
économique du gouvernement, qui a essen-
tiellement privilégié le développement de
l’industrie, financé par des investissements
directs étrangers. Le faible coût de la main
d’œuvre a été le point fort de cette politique,
renforçant l’attrait du pays pour les grands
groupes de l’équipement automobile.
Commentaire – Le succès du positionnement commercial extérieur de la Pologne est-il
soutenable à long terme ? Les réponses se trouvent soit dans la capacité de la Pologne à
attirer de nouveaux investissements directs étrangers (IDE) pour financer son développement
industriel, soit dans l’augmentation de l’investissement domestique privé et public. Le
contexte politique plus tendu, notamment par l’instauration d’une série de nouvelles taxes et
une moindre indépendance des institutions polonaises, risque de produire une certaine
méfiance des investisseurs étrangers, qui ont aujourd’hui moins de visibilité sur le contexte
institutionnel. Si cette méfiance perdurait, elle aurait un effet négatif sur les flux d’IDE
entrants en Pologne. Quant à la hausse des investissements domestiques, elle risque de se
traduire par une augmentation du niveau d’endettement externe du pays, actuellement à
120% des exportations.
Pour le moment, la politique du gouvernement est plutôt orientée à l’incitation de la
consommation interne, au détriment de l’épargne et donc de l’investissent. L’introduction de
diverses aides sociales, financées par les nouvelles taxes sur le secteur bancaire et sur la
distribution, soutiennent la hausse de la consommation domestique.
Dans tous les cas, pour dynamiser son activité industrielle, la Pologne aura besoin d’inciter
l’innovation afin d’accroître la valeur ajoutée de sa production. La main d’œuvre étant de
moins en moins attractive par son prix, elle devra l’être par la qualification. L’enjeu des
années à venir sera la bonne articulation entre un environnement des affaires favorable et la
relance de la recherche et développement, tout en maîtrisant le niveau d’endettement.
Hongrie – L’agence de notation S&P se
montre prudente : La revue du rating de
l’agence de notation Standard & Poor’s a
laissé inchangé la note du souverain hon-
grois avec une perspective stable. Actuelle-
ment notée à BB+, la Hongrie ne retrouve
donc pas encore «l’investment grade ».
Commentaire – Toutes les agences de
notation évaluent la Hongrie à « non
investment grade », malgré la nette amé-
lioration des fondamentaux macro-écono-
miques. L’explication est plutôt liée au
manque de lisibilité de la politique du
gouvernement de Victor Orban. Une opa-
cité croissante dans le fonctionnement
des institutions comme la Banque centra-
le et la justice affaiblissent la perception
de la démocratie en Hongrie, ce qui n’est
pas sans impact sur le comportement des
consommateurs et des investisseurs.
-7
0
7
14
21
28
35
42
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
T4 10 T4 11 T4 12 T4 13 T4 14 T4 15
Pologne : balance des paiements
Inv. portefeuille (dr.) IDE nets (dr.)
Bal. commerciale Bal. courante
Sources : NBP, Crédit Agricole S.A.
Cumul 1 an, Mds €

Pays émergents : L'actualité de la semaine
N°16/088 – 25 mars 2016
- 3 -
Russie – De meilleures statistiques depuis deux mois
Les statistiques de production industrielle de
février (+1%) sont un peu biaisées par le
nombre de jours travaillés. Mais elles sont
tout de même valables dans la tendance
qu’elles indiquent sur deux mois (janvier-
février), qui montre une moindre contraction
de la production industrielle (0,7% a/a).
Même constat pour les ventes au détail avec
une chute « limitée » à 6,6%. La baisse des
salaires réels est également en train de
ralentir (-2,6% en février, contre -8,4% en
décembre) et ce ralentissement n’est pas
seulement lié à la désinflation, car les
salaires nominaux augmentent (dans un
contexte où par ailleurs le chômage reste
stable à 5,8%). Enfin, le constat est le même
du côté du crédit, avec une meilleure
tendance pour les crédits à la consommation
et surtout pour les crédits aux entreprises.
Commentaire – Ces chiffres sont encourageants et ce d’autant plus qu’ils ne reposent pas
sur une stimulation budgétaire. Ils nous laissent espérer que le point bas de la conjoncture
pourrait enfin être atteint, que l’on avait cru le toucher l’été dernier, mais que cela avait été
retardé à cause de l’effondrement des prix du pétrole. Évidemment, cette tendance est
récente et demande à être confirmée dans les trimestres à venir (la production industrielle
pourrait être à nouveau décevante). Également, il faut que le scénario pétrole tienne.
Mais sous ces conditions, le rouble devrait alors se réapprécier, ce qui sera favorable pour la
stabilisation monétaire des autres devises pétrolières de la région. En effet, le Kazakhstan et
l’Azerbaïdjan, qui ont eu beaucoup de difficultés en 2015 à maîtriser la sortie des pegs
monétaires, sont dans une phase un peu plus stable depuis un mois.
Serbie – Amélioration des indicateurs
« Doing Business ». Les indicateurs
« Doing Business » de la Banque mondiale
regroupent un ensemble de six critères éva-
luant la qualité de l’environnement des affai-
res d’un pays. En un an, la Serbie a gagné
neuf rangs dans le classement général se
situant désormais à la 59e place.
Commentaire – Une certaine stabilisa-
tion sur le plan politique a contribué à
l’amélioration de la gouvernance. Par
ailleurs, le gouvernement a réalisé des
réformes en vue d’améliorer la collecte de
l’impôt et d’accélérer l’obtention des per-
mis de construire, favorisant ainsi la
hausse des investissements, et la pro-
gression du pays dans l’indicateur de la
Banque mondiale.
0
20
40
60
80
100
Octroi de Permis de Construire
Exécution des Contrats
Obtention de Prêts
Raccordement à l’électricité
Paiement des Taxes et Impôts
Protection des investisseurs
minoritaires
Transfert de Propriété
Règlement de l'insolvabilité
Création d’Entreprise
Commerce Transfrontalier
Serbie : Doing business
2010 2016
Sources : Banque mondiale, CA S.A.

Pays émergents : L'actualité de la semaine
N°16/088 – 25 mars 2016
- 4 -
Afrique du Nord, Moyen-Orient
Émirats Arabes Unis – La diversification de l’économie amortit les effets de la chute
du prix du pétrole
Avec une population modeste et une
richesse par habitant parmi les plus élevées
de la planète, les Émirats Arabes Unis (prin-
cipalement Abu Dhabi et Dubaï) disposent
d’une économie assez diversifiée qui leur
permet d’amortir les chocs conjoncturels et
notamment celui créé par la chute du prix du
pétrole de 120 à 37 USD le baril entre mi-
2014 et mars 2016.
La production de pétrole représente un tiers
du PIB, moins de 50% des exportations de
biens et une part plus modeste des revenus
budgétaires. Les Émirats sont donc beau-
coup moins impactés par la chute des prix
des hydrocarbures que les autres pays du
GCC, y compris quand on les compare aux
plus riches que sont le Qatar et le Koweït.
L’activité touristique reste très vigoureuse
(+10% de trafic de passagers à 78 millions
en 2015 à Dubaï), et les activités commer-
ciales restent bien orientées malgré une
décélération.
La chute du PIB pétrolier et les ajustements
macro-économiques vers l’austérité vont
néanmoins avoir des effets de décélération
sur la croissance qui devrait tomber à 1,2%
en 2016, avant un probable rebond à environ
2% en 2017. Cette tendance devrait se pour-
suivre à moyen terme, selon les futures
fluctuations des prix du pétrole.
Le pays ne devrait néanmoins pas profiter en
2016 de la réintégration de l’Iran pour
développer son commerce international avec
ce pays, en raison de l’apparition de nou-
velles tensions avec l’Arabie saoudite et le
GCC. Une relance du commerce pourrait
être repoussée à 2017, voire au-delà.
Commentaire – Afin de contenir les déficits budgétaires et éviter une dérive de la dette
publique, le décalage des investissements et la hausse de la fiscalité initiés en 2015 vont se
poursuivre à moyen terme. De plus, la baisse, même modeste, des subventions (essence,
eau, électricité) et la hausse des impôts vont avoir des effets positifs dans la durée. La dette
publique devrait toutefois progresser avant que la TVA ne soit introduite en 2017 et commence
à produire ses effets.
Algérie – Les recommandations du FMI.
La mission d’évaluation et de conseil
conduite par le FMI à Alger du 1er au 14 mars
a estimé qu’au regard de l’importante dété-
rioration des soldes publics, les autorités
algériennes devront maintenir et prolonger la
consolidation budgétaire et les réformes
qu’elles ont d’ores et déjà initiées.
Plus concrètement, il a été conseillé au pays
de « mobiliser davantage de recettes hors
hydrocarbures, poursuivre la réforme des
subventions tout en protégeant les ménages
pauvres et d’accroître l’efficience de l’inves-
tissement». Des réformes structurelles visant
à améliorer le climat des affaires, diversifier
l’économie et flexibiliser le marché du travail
ont également été préconisées, de même
qu’un recours à l’endettement pour financer
les déficits du pays.
Commentaire – Interrogé au sujet d’un
emprunt obligataire d’État que compte
lancer le pays pour mobiliser l’épargne
interne, le conseiller auprès du FMI, Jean-
François Dauphin, a précisé que l’endet-
tement interne pouvait être efficace, mais
était susceptible d’entraîner un effet d’é-
viction sur l’économie. Au contraire, il a
été jugé que l’endettement extérieur per-
mettait de minimiser cet effet.
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011 2012 2013 2014 2015 2016p 2017p
% PIB
Emirats : soldes commercial
et courant
Solde courant Solde commercial
Sources : EIU, Crédit Agricole SA

Pays émergents : L'actualité de la semaine
N°16/088 – 25 mars 2016
- 5 -
Afrique sub-saharienne
Afrique australe et orientale – Des effets d’El Niño et de la sécheresse en 2016
Les pays de la région connaissent actuelle-
ment une vague de sécheresse qui devrait
s’étendre jusqu’à l’été 2016. Le coupable est le
phénomène cyclique El Niño qui touche l’océan
Pacifique et perturbe particulièrement les
cycles météorologiques de l’hémisphère sud.
En conséquence, les pays de la façade
orientale de l’Afrique connaissent une baisse
de la production agricole et des impacts
conséquents pour les populations via le prix
des biens alimentaires.
Commentaire – Comme le prouve les indicateurs ci-dessus, ce sont les économies les moins
avancées qui subissent le plus les contrecoups d’El Niño et de la sécheresse associée.
L’économie sud-africaine, la plus résiliente de la zone, a eu une contribution négative du secteur
agricole de 0,2 point de PIB en 2015, mais l’impact sur la consommation est limité (7% a/a
d’inflation alimentaire en janvier) et seuls 5% des travailleurs sont dans le secteur agricole.
Pour les économies les plus fragiles, comme l’Éthiopie ou la Zambie, l’enjeu est tout autre : éviter
un fort dérapage des prix, voire une crise alimentaire. De plus, en prenant en compte les effets
sur la production hydroélectrique et l’importance du secteur agricole dans la structure des
exportations, les prévisions officielles du FMI pour l’année 2016 semblent encore assez
optimistes (3,6% de croissance du PIB en Zambie ou 7% en Éthiopie)…
Afrique francophone - Élections prési-
dentielles (plus ou moins) disputées.
Bénin – L’entrepreneur Patrice Talon a été élu
avec plus de 65% des voix lors du second tour
de l’élection présidentielle ce dimanche contre
Lionel Zinsou, dauphin du président sortant
Boni Yayi.
Commentaire – La campagne a été
dominée par les thèmes de l’héritage du
président sortant, mais aussi la question
française, puisque le métis L. Zinsou est
binational et a fait carrière en France. Peu de
discussions de fond malheureusement, alors
que le pays est l’un des plus pauvres du
monde (2 000 USD PPA/habitant en 2014) et
demeure très dépendant du commerce
informel avec le voisin nigérian (estimé à
20% du PIB selon la Banque mondiale).
Niger – Sans surprise, le président sortant
Issoufou Mahamadou a été reconduit pour un
second mandat ce dimanche. Sans surprise,
car le candidat d’opposition Hama Amadou est
emprisonné depuis maintenant quatre mois et
l’opposition, qui a pu empêcher une victoire
annoncée au premier tour, a néanmoins
appelé au boycott.
Commentaire – Le déroulement de la
campagne peut faire sourciller, mais le
climat pacifié de ces élections est bienvenu
tant les défis du Niger sont nombreux : l’IDH
est l’un des plus faibles du monde (0,337),
le revenu par habitant est inférieur à
1 000 USD PPA/habitant et le taux de crois-
sance honorable (4,6% en 2015) a peu de
retombées sur une population en hausse de
4% chaque année.
République du Congo – Grâce à l’adoption
d’une nouvelle constitution mettant fin à la
limite d’un mandat renouvelable et d’âge du
candidat, le président sortant Denis Sassou-
Nguesso a été réélu dès le premier tour ce
dimanche pour un troisième mandat consécutif.
Commentaire – Rappelons simplement
que le Congo, pays à revenu moyen de la
tranche inférieure (6 276 USD PPA/habitant)
est très fortement impacté par la baisse des
cours du pétrole : la croissance n’est
estimée qu’à 1% et le déficit budgétaire a
atteint 10% du PIB en 2015. Le risque poli-
tique demeure donc fort, du fait de cette
élection très contestée et de l’absence de
progrès sociaux.
P opulatio n
active agricole
(% total estimé)
Secteur
agricole
(% du P IB)
Exportations
agricoles
(% des
exportations)
Biens
alimentaires
dans le panier
moyen
(% du total)
Electricité
d’ o rigine
hydroélectrique
(% de l’électricité
totale)
Indicateur
d’ impact
Ethiopie 72 42 67 57 99
Fort
Zambie 52 10 11 53 100
Fort
Kenya 60 30 47 36 52
Moyen
Afrique du Sud 5 2,5 11 25 1
Faible
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%