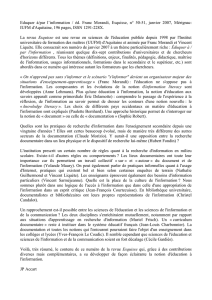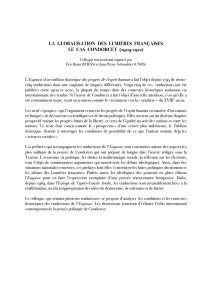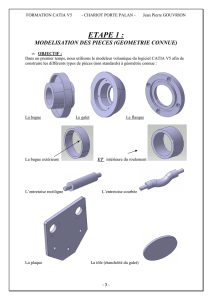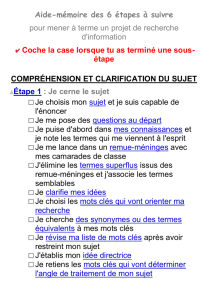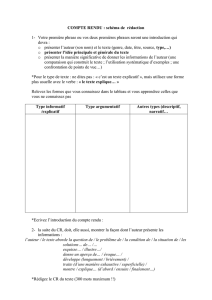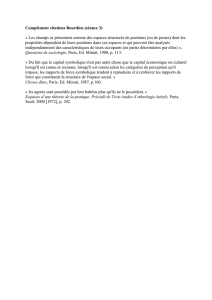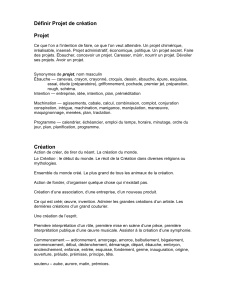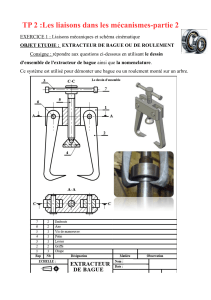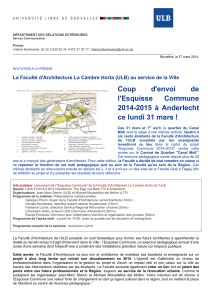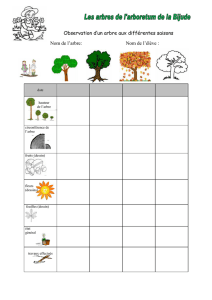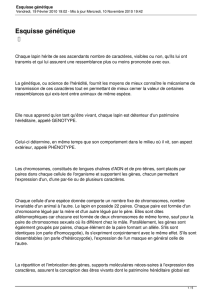Position de thèse - Université Paris

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
École doctorale V : « Concepts et langages »
THÈSE
pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
Spécialité : philosophie
Présentée et soutenue par :
Brigitte Flamand
Le : 15 février 2016
La forme de l’esquisse ou le mouvement du corps et de la pensée.
Approche contemporaine des premiers modes opératoires du processus de création
Sous la direction de :
Jacqueline LICHTENSTEIN
Professeur émérite, Université Paris Sorbonne (Paris IV)
JURY
Madame Lizzie BOUBLI, directeur de recherche (CNRS, ITEM/ENS)
Monsieur Ruedi BAUR, designer, ex. directeur de l’institut de recherche Design2context à la
Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)
Madame Marianne MASSIN, professeur, Université Sorbonne (Paris IV)
Monsieur Pierre-Marc de BIASI, directeur de recherche (CNRS, ITEM/ENS)

En choissant l’esquisse comme objet d’étude, il ne s’agit pas seulement de porter notre attention
sur une forme graphique singulière, cela interroge plus largement le processus artistique et les
conditions de sa matérialité. En cela, cette question s’est progressivement imposée pour cette
recherche, comme si elle était le lieu d’une meilleure compréhension des typologies et de leur
classement plus souvent liés à un déterminisme historique et contextuel, qu’à une réalité objective des
pratiques artistiques. Une des principales raisons qui a porté le choix sur l’esquisse, c’est cette
séparation historique, et peut-être plus spécifiquement en France entre les beaux-arts et les arts
décoratifs, ou plus traditionnellement, la distinction entre les arts dits majeurs et mineurs. Ce clivage
pourtant largement dépassé au sein de la communauté scientifique marque encore profondément nos
représentations et en particulier dans le monde des écoles. Au-delà de ces modèles de classification qui
persitent plus ou moins, la catégorisation de l’esquisse, quant à elle, semble s’affranchir des règles,
genres et typologies.
Précisément, si ce mode de pensée a séparé spontanément les arts relevant des beaux-arts et ceux de
l’ornement dits utilitaires, la détermination matérielle, technique et d’usage semble avoir aussi été le
critère pour positionner le statut et la place dans le champ de l’histoire de l’art et de la philosophie.
Ainsi l’esquisse s’est trouvée naturellement du coté des beaux-arts, alors qu’il semble que sa raison
d’être réponde autant aux uns qu’aux autres.
Nourrie par plusieurs domaines que sont les arts plastiques, les arts appliqués et l’histoire de l’art,
la philosophie chacun d’entre eux ont construit un parcours qui a participé à penser autrement, c’est à
dire sans considérer les différentiations catégorielles lorsqu’il s’agit de penser le processsus de
création. Ce positionnement pose en priorité un regard sur les pratiques plus que sur l’objet fini et
induit d’autres modes d’observation et de compréhension des champs artistiques et des disciplines
connexes telles que l’architecture, les beaux-arts, les arts décoratifs, les arts appliqués, le design. De ce
constat liminaire, il est apparu alors évident d’inscrire cette recherche, non dans une approche
théorique, mais fondée sur les raisons et les contingences matérielles. Considérer l’analyse de la
matérialité comme un mode d’appproche à part entière, c’est envisager qu’elle participe autant au
moment inaugural du processus de création dans sa réalité pratique et physique que dans son
acceptation historiciste. Précisément la dimension pratique s’est donc imposée, et par cette analyse de
la pratique et de ses caractéristiques matérielles, le besoin de s’approprier une autre manière de
regarder la forme inscrite.
Ainsi d’une approche initialement consacrée au dessin, l’étude s’est resserrée à la seule pratique de
l’esquisse comme étant le phénomène supposé le plus symptomatique du surgisssement de l’idée qui
devient signe graphique et donc forme.
Par ce procédé de lecture, il pourrait apparaître assez légitime de penser que depuis
l’antiquité jusqu’à la Renaissance, et probablement dès les premières traces inscrites sur les parois des
grottes préhistoriques, la première forme graphique est avant tout celle d’une unité composée d’une
idée qui surgit en une forme visuelle.
Dans les Vite de piu eccellenti Pittori, Scultori e Architettori édité en 1550, Vasari qualifie le dessin de
"père de nos trois arts" : "Celui-ci est comme la forme ou idée de tous les objets de la nature, toujours
originale dans ses mesures […] ». Cette raison engendrée par l’esprit donne ainsi forme à l’objet
imaginé. Cette trace est composée de signes graphiques se présentant sous différents états et celui qui
nous intéresse, l’esquisse, est un préalable dans le processus de création dont les spécificités lui
confèrent cet état si particulier. Cette esquisse surgit grâce à l’idée, un fragment de la pensée, en
somme une première pensée, « il primo pensiero », cette notion renvoie à un état premier, tout en
amont du processus de recherche, en somme le premier jet, la première forme, la première idée. Elle
n’est pas à confondre avec des exercices plus avancés du processus artistique qui vont au-delà de la
première pensée, car déjà engagé dans le déploiement de l’idée et non plus dans son seul surgissement.
Par exemple, l’étude, la répétition, il modello, sont autant de modes opératoires que Lizzie Boubli a
identifiés sous l’appelation de variante
1
variazione, soit des feuillets d’études où s’accumulent les
ébauches de mêmes figures et de compositions en devenir. Ces différents états étaient l’occasion de
mémoriser les multiples formes de la pensée. Mémoire de l’atelier, ces feuillets et ces carnets où les
formes des corps, leurs mouvements, les agencements imaginés, étaient autant de répétitions
consignées avant leur réemploi le plus juste, le plus harmonieux dans l’œuvre définitive. Ces variantes
1
Lizzie Boubli, L’atelier du dessin italien à la Renaissance- variante et variation, Paris, CNRS, 2003, p. 162.

généralement pratiquées comme des exercices par l’élève formaient l’œil et exerçaient l’agilité et la
légèreté de la main comme autant de gammes qu’il fallait répéter chaque jour. À contrario, l’esquisse
était une mise à l’épreuve de la pensée et donc de l’imagination du maître qui la pratiquait, non
comme un exercice, mais comme le besoin d’exprimer, de consigner les idées qui lui traversaient
l’esprit, comme le signe de ses pensées. Cette pratique a souvent été confondue avec d’autres formes
graphiques alors qu’elle est spécifique. Agnés Callu
2
considèrent par exemple, que les formes
graphiques de l’esquisse intègrent autant le tracé, le brouillons, le plan, le dessin, le schéma. À
contrario, son état nous apparaît bien distinct, singulier, et son usage souvent indéterminé car sa
fonction n’est pas advenir mais d’être. Ce moment du processus de création ne s’est pas démenti dans
les pratiques artistiques contemporaines, il suffit de regarder les inscritions graphiques de Giuseppe
Penone, Cy Tombly, Baselitz, Jean Nouvel et d’autres encore.
L’esquisse est la projection graphique de la première pensée. Elle se trouve naturellement soumise aux
contingences matérielles d’un support, d’un outil, d’un médium et enfin d’un geste dans lequel préside
un rythme, une pression, un mouvement
3
, une durée. Ces conditions matérielles sont souvent peu
observées, alors qu’elles ont pourtant une incidence réelle sur la forme à regarder et la qualification de
son état.
Dans les siècles passés, la distinction entre les différentes formes de dessins semblait se faire aisément
même si leurs différences se rassemblaient tout autant sous la seule bannière du primat du dessin
comme étant l’idée et sa transcription visible. On retrouve cette double construction dans son
étymologie latine – designarer : de/sign – préposition/de et signum/signe – signifiant dé-signer. De
même le mot allemand pour dessin, Zeichnung vient de Zeichnen (marquer, signer), et se rapporte au
signe, lui aussi. Ainsi l’usage du terme disegno
4
, c’est à dire : « una figura accentuata con linee, per
rappresentare con signi cosa gia fatte o da tardi
5
» signifie à la fois l’intention, l’idée, mais aussi la
ligne, le signe et le geste, l’acte de faire. Faire signe ou désigner quelque chose ne précise pas pour
autant la forme, la qualification de son état et le mécanisme cognitif que cela a convoqué.
Ainsi le dessein serait l’équivalent français du disegno, un terme qui exprime la pensée et la forme.
Pierre Richelet définit le dessein
6
ainsi : « C’est une expression apparente, ou une image visible des
pensées de l’esprit et de ce qu’on s’est premièrement formé dans son imagination. ». Si l’esquisse est
un dessein encore informe, nous dit Pierre Richelet ou « Un premier craïon, ou une légère ébauche
d’un ouvrage qu’on médite ». Il qualifie explicitement l’esquisse ainsi « les desseins qui ne sont tracés
que grossièrement avec la plume ou le craïon, sont appelés esquisse… ».
Dans cette définition de la fin du XVII
ème
siècle, on perçoit clairement que le dessein est donc bien le
synonyme de disegno, et qu’en Italie tout comme en France, la forme brève du dessein nommée
esquisse à son equivalent en Italie avec le terme de schizzo. L’étymologie de l’esquisse ou « schizzo –
lat. schedius (fait sur le champ) ; du grec (faire à la hâte) « σχέδιος» grec et non« σχίζειν » (schizein),
signifie le fractionnement et la racine de schizophrène, « φρήν » (phrèn), désignant l’esprit, soit le
fractionnement de l’esprit qui n’est pas à confondre avec ce dernier. Le schizzo a une place singulière
et il s’exécute à la hâte avec une main libre. Cette forme inachevée, brève est un jaillissement du geste
et simultanément de la pensée. Elle se dit encore designare alla grossa qui indique par le trait,
l’intention de la grande œuvre et qui n’est pas à confondre avec cet état supérieur du dessin arrêsté
que décrit Vasari. L’esquisse ou le schizzo se manifeste systématiquement par une pensée brève,
fugace faisant surgir un tracé graphique d’une extrême rapidité, son apparence est toujours très
singulière du fait de la rapidité de l’exécution et bien différentiable de tout autre forme de dessins. Par
exemple, la trace de l’outil forme une unité sans retours, ni repentirs, ni corrections. Elle varie sans se
soucier des usages et des règles pour faire surgir un tracé souvent informe où la rapidité du geste se
plie aux contraintes matérielles et à l’urgence de son exécution. Rien de commun entre un rapide tracé
de quelques secondes et un tracé abouti pratiqué avec maîtrise et expérience donnant à voir une image
stabilisée souvent exécutée en plusieurs étapes.
2
Agnès Callu, [En ligne], URL : http://equipe-histara-ephe.fr/agnes-callu ; http://calenda.org/297142 ;
http://labexcap.fr/seminaire/anthropologie-comparee-de-lesquisse/.
3
David Rosand, la trace de l’artiste , conférence donnée en 1984 au Kansas, publication française, Paris, Gallimard, 1983.p. 59.
4
Jacqueline Lichtenstein, Du Disegno au dessin , dans du dessin au dessein, Bruxelles, essais la lettre volée, 2007, p : 17.
5
Vocabulaire degli accademici della Crusca, Florence, Domenico Maria Manni, 1739, p. 128.
6
Pierre Richelet, Dictionnaire de la langue Françoise ancienne et moderne, Genève, Jean Herman Widerhold, 1680.

L’esquisse n’est pas à confondre avec d’autres formes dessinées. Cette différence d’état se joue
précisément sur le temps de mise en œuvre. Ce temps de la fabrique se distingue dans les différents
états du processus de création. Par exemple, le dessin d’étude relève de l’observation d’une chose vue
ou ayant été vue. Le dessin de croquis quant à lui est la recherche d’une forme ou d’une composition
et la précipitation n’est pas ce qui le caractérise. Si l’un et l’autre représentent ou convoquent un objet,
une figure, une scène situé devant soi, ni l’un ni l’autre ne font appel à cet accident mental dont les
premiers écrits d’artistes témoignent explicitement. Cet accident mental serait la manifestation
de l’esquisse comme un état inaugural affranchi des codes de représentations et donc libre d’exprimer
un état premier de la pensée. Un moment suspendu dans le processus de création ou la structuration
conceptuelle et formelle se retrouve arrêtée dans son élan, en quelque sorte en suspens. Une époke
7
de
l’esprit et du geste. Un surgissement d’une idée qu’il faut arrêter dans sa brièveté et qui justifie son
état très approximatif, informe, voir parfois illisible.
Le surgissement d’une idée se rapporte au concept, entendu comme le concetto, le progetto, soit la
projection de l’idée est donc un des ressorts du processus de création. Il se manifeste explicitement
dans la pratique de l’esquisse et son état est toujours soumis à des contingences matérielles qu’il faut
tenter d’observer et de comprendre.
Signe d’une pensée ou signe bref d’une forme, l’esquisse pourrait donc avoir sa propre autonomie
matérielle et intentionnelle.
La disparition du terme dessein au profit de celui de dessin se fait progressivement au XVIII
ème
siècle
et le terme esquisse quant à lui suit les aléas naturels des définitions du dessein vers celles du dessin
pour s’imposer non plus comme un mode de pensée mais plus banalement comme pratique courante et
nécessaire pour l’artiste. Le primat du dessein et de toutes ces formes, et il en est ainsi aussi pour
l’esquisse, abandonne le magistère des idées et de l’imagination pour se retrouver consigner à une
pratique qui se confond avec l’étude, le croquis d’observation et cela jusqu’à la première moité du
XX
ème
siècle.
La classification des typologies des formes dessinées, ainsi que les noms qui y sont associés laissent
plus souvent place à des termes dont l’identité et le sens abandonnent les qualités et les spécificités de
certains usages jusqu'à lors identifiés et énoncés précisément dans différents recueils ou écrits
d'artistes à la Renaissance. Cette évolution naturelle de la terminologie semble s’être confondue avec
l'évolution des pratiques et des formes qu’elle a fait émerger.
L’esquisse n’a donc pas échappé à ce sort et a évolué vers une terminologie aux contours de plus en
plus approximatifs et le plus souvent associés à un support fragile tel que le papier. Pourtant
l’existence même de cette forme graphique très singulière semble toujours perpétuer le même mode
opératoire qui est celui du surgissement bref d’une pensée et d’une pratique associée. La contraction
du temps entraîne le mouvement de l’idée et celui du corps. La main n’agit pas en deçà de la
conscience, mais se combine à l’esprit pour faire trace. La rapidité du geste est l’expression de la
fulgurance de l’esprit, l’un et l’autre indissociables. L’idée prend forme, tout autant que la main fait
idée. Une action simultanée qui pourrait être la condition d’apparition de cet état particulier que l’on
nomme l'esquisse.
Entre l’esquisse, l’étude, le croquis la terminologie semble s’échapper vers des dénominations dont la
proximité est parfois confondante. Pourtant un point majeur diffère l’esquisse de tous les autres états,
sa brièveté d’exécution dans un seul mouvement et sans retours. Elle oblige l’artiste à fixer la forme de
son idée au plus vite. Une sorte de précipitation qui se mesure dans une gestuelle souvent brutale et
sans arrêt du mouvement. Il peut être heurté, accidenté mais il s’inscrit dans le continuum d’un
mouvement fait d’un début et d’un arrêt aussi précipité que son commencement. Un agencement de
lignes, de signes brefs, comme une matière informe soumise à la seule pulsion mentale et physique de
l’artiste, une trace mémorielle qui n’est pas à confondre avec l’ébauche, le croquis ou l’étude qui
procèdent d’une trajectoire plus accomplie qui engendre déjà les prémisses d’une composition.
Passé ce temps fugace de l’esquisse, le tracé reprend le contrôle de la ligne par de multiples reprises
pour donner à voir des combinaisons plus complexes qui se nomment alors étude ou croquis. Leur
forme sont alors plus élaborées, plus abouties tout en restant encore incertaines.
7
Cf définition de époche : une pensée en suspens

Il peut apparaître assez aisé de définir les contours de l’esquisse de la Renaissance jusqu’au début du
XX
ème
siècle, il en est autrement pour les pratiques artistiques contemporaines. Elles ont sans aucun
doute favorisé la complexité de l’appréciation des catégories et des divers modes d’expression
graphique couvrant toutes les variations du point à la ligne. Les typologies déjà altérées sont devenues
encore moins précises et il n’est pas rare qu’aujourd’hui soit appelé dessin, et sans distinction
spécifique, toute forme tracée graphiquement. Pourtant si l’on y regarde de plus près, et si l’esquisse
est bien le surgissement d’une idée qu’il faut jeter sur le papier, il semblerait qu’un grand nombre de
pratiques comtemporaines dessinées soient plus proche de l’esquisse que du dessin. Pour cette
recherche l’analyse s’appuie donc sur un corpus d’esquisses allant d’une période où émerge le concept
d’esquisse jusqu’à nos jours. Le nombre d’artistes est volontairement restreint afin de tenter de saisir
objectivement les points de convergences et de différences qui constituent un possible protocole pour
identifier ce qui qualifie et caractérise l’esquisse.
Trois registres méthodologiques fondent et structurent les modes d’analyse de cette recherche. Tout
d’abord une observation du mode opératoire depuis son usage le plus ancien jusqu’à nos jours. D’autre
part se pose la question du langage et des usages de ce terme dans les premiers écrits d’artistes. Enfin,
l’observation d’un corpus d’esquisses, une vingtaine, permet une analyse des caractéristiques
matérielles. Par exemple, la question des similitudes dans la rapidité d’exécution, l’impératif qu’il n’y
ait pas de repentir et que s’impose un mouvement bref et continu. Ainsi, l’esquisse aurait pour
caractéristique d’être toujours la forme d’une pensée fragmentaire non stabilisée. La pensée est encore
en mouvement, un mouvement continu qui se fixe partiellement dans une trace inachevée. L'esquisse
en est donc l’empreinte visuelle et matérielle. Cette pensée en mouvement n'est pas seulement la
condition de l'esquisse, elle témoigne d'un état préliminaire dans le processus de création. Elle n'est
pas à confondre avec les formes de la répétition de la variation, ou autres croquis qui relèvent de
l’étude, de l’observation, de l'exercice. L'esquisse n'est donc pas un exercice, elle ne copie pas ou ne
cherche pas à transcrire l’existant d'un corps, d'un bras, d’un paysage ou la combinaison d´éléments
divers vus, elle pense de l’intérieur. Manifestation d'un fragment d'image intérieure, une image
mentale, une intuition, un instant de l’imagination, un état incomplet de l'idée qui préfigure le
processus de création.
Cette recherche a pour objectif de définir et de circonscrire le sens de l’esquisse, mais aussi les
conditions de sa présence et de sa matérialité par l’observation de sa pratique et son économie. Enfin,
il s’agit de replacer l’esquisse dans le processus artistique afin qu’elle devienne éventuellement le
prétexte d’un questionnement sur les notions essentielles qui fondent les premiers modes opératoires
de ce même processus.
Cette recherche interroge donc la manière de nommer, de penser et de pratiquer l’esquisse dans son
processus matériel et conceptuel. Elle tente surtout de questionner ce moment singulier dans ce qu’il
signifie dans le champ de philosophie de l’art dans une approche matérialiste. Si la corporéité est la
reconnaissance, autant d'une corporalité de la conscience que d'une intentionnalité corporelle
8
, il s’agit
de comprendre comment l’esquisse met à l’œuvre par sa brièveté l’action de cette combinaison
irréductible de la volonté de l’esprit et du corps.
Cette recherche participe à une réflexion plus globale nourrie par une analyse qui se veut d’abord
matérielle avant d’être conceptuelle. L’acte de faire est privilégié et donne accès à une lecture
particulière de la forme et à un système de différenciation qu’il s’agit de démontrer par une pratique
mise au service d’une pensée et non l’inverse.
Intuition, invention, imagination, idée, concept, qu’elle que soit la manière dont on qualifie ce
moment, la nécessité pour l’artiste est d’attraper et de fixer par une forme brève cette première pensée
qui surgit et repart. Cette pensée et ce corps en mouvement se rendent visibles et se matérialisent
précisément peut-être dans cette figure particulière que serait l’esquisse.
8
Michela Marzano, Philosophie du corps, Presses Universitaires de France, collection « Que sais-je ? », 2007, pages 46-48 ; et Kurt
Duaer Keller, Intentionality in Perspectival Structure, dans Chiasmi International ; Publication trilingue autour de la pensée de
Merleau-Ponty, nouvelle série, numéro 3, p. 375-397.
1
/
5
100%