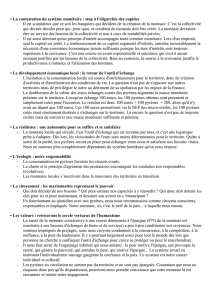la monnaie dans l`economie resume

LA MONNAIE DANS L’ECONOMIE
GILLES JACOUD
RESUME
6 parties:
1. Qu'est-ce que la monnaie?
Fonctions de la monnaie
Différentes formes de monnaie
Instruments de mesure
2. La création monétaire
Rôle des banques
Banque centrale
Extérieur et Trésor
Multiplicateur de crédit
Contreparties de la masse monétaire
3. La politique monétaire
Objectifs
Instruments
Financement de l'économie
4. L'organisation monétaire à l'échelle internationale
· L'étalon-or
· Le SMI de Bretton Woods
· Instabilité des changes
· Intégration monétaire européenne
· Paiements, financements, endettement
5. Monnaie et prix
· Les pré-classiques . Les classiques et la théorie quantitative de la monnaie
· Equilibre walrasien et équation de Fisher
· L'équation quantitative de Cambridge
· Don Patinkin
· Milton Friedman
6. La monnaie au cœur du réel
· Keynes
· Les néo-keynésiens
· Le diagramme IS-LM
· La monnaie comme fait social
Le présent ouvrage propose une découverte fondie de la monnaie. Sont ainsi successivement abordés: la définition de la
monnaie, la création monétaire, la politique monétaire, l'organisation monétaire à l'échelle Internationale, le lien entre monnaie et
prix et, plus largement, les effets de la monnaie sur l'activité économique analysés par les différents théoriciens de la monnaie.
Se voulant accessible à tous les apprentis économistes, l'auteur a opté pour une démarche progressive allant des phénomènes
concrets aux analyses théoriques. De plus, les apports Indispensables d'autres disciplines, comme l'histoire, la comptabilité ou
les mathématiques, sont clairement expliques.
Par ses qualités pédagogiques, ce manuel s'adresse ainsi à tous ceux qui sont Intéresses par la compréhension des
phénomènes monétaires, qu'Ils soient lycéens, étudiants, professeurs ou, plus largement, personnes désireuses d'étendre leur
culture économique.
Comment utiliser ce livre ?
§ En page de droite se trouve la leçon développant le contenu du chapitre.
§ En page de gauche sont réunis:
Les définitions des termes les plus Importants ou les plus difficiles ;
· U n contrepoint: approfondissement d'un thème évoqué dans la "leçon", développement complémentaire,
schéma explicatif, graphique, tableau, etc.
§ Un Index de près de 1 000 entrées et une table des 1118t1ir détaillée permettent de trouver directement l'explication
recherchée..
Les bases de l'économie accessibles a tous

SOMMAIRE
Intitulés
Des parties, chapitre et sections-Thèmes correspondants
Introduction
I. QU'EST-CE QUE LA MONNAIE? 11
g1. LES FONCTIONS DE LA MONNAIE
La monnaie, unité de compte (La référence à une marchandise)f 13
La monnaie, instrument de paiement (La monnaie, réserve de valeur?) 15
g2. LA MONNAIE METALLIQUE
monométallisme (Les inconvénients du monométallisme) 21
g3. LA MONNAIE DE PAPIER
Le papier-monnaie (Les expériences étrangères de papier-monnaie) 23
Le billet de banque (La Caisse d'escompte) 25
Approches théoriques de l'émission des billets27(La conception d'Adam Smith) 25
Le cas français: de la concurrence au monopole
d'émission (Une diversité initiale d'émetteurs) 29
g4. LA MONNAIE SCRIPTURALE
Qu'est-ce que la monnaie scripturale? (La variation de l'avoir en compte) 31
La logique du transfert de la monnaie scripturale (La représentation
comptable du Transfert) 33
g5. DE LA MONNAIE AUX ACTIFS FINANCIERS
Les instruments de paiement et les autres liquidités (Les comptes d'épargne
et bons en francs) 35
Les autres instruments de placement (Un problème de frontière) 37
Les instruments de financement (Crédit interentreprises, escompte
et réescompte) 39
g6. LES INSTRUMENTS DE MESURE
Les agrégats utilisés (Billets et pièces dans la masse monétaire) 41
D'une logique de stocks à une logique de flux (L'élaboration d'un compte financier) 43
Le tableau des opérations financières (L'architecture du TOF) 45
II. LA CREATION MONETAIRE 47
g1. DE LA MONNAIE SCRIPTURALE
A LA MONNAIE CENTRALE
La création de monnaie scripturale par une banque (La représentation
comptable de la création monétaire) 49
Le refinancement (Les incidences comptables du refinancement) 51
La fourniture de billets à la clientèle de la banque53Le reflux des billets
g2. LA CREATION MONETAIRE
DANS UN SYSTEME
A PLUSIEURS BANQUES COMMERCIALES
Les fuites à l'intérieur du système bancaire (La transformation de la monnaie
Créée) 55
La compensation (Incidences comptables du refinancement et de la
compensation) 57
Les effets d'une inégalité entre la proportion des dépôts incidences comptables
d'une gérés et celle des crédits accordés (compensation partielle) 59
g3. LE ROLE DE L'EXTERIEUR ET DU TRESOR
Relations avec l'extérieur et création monétaire (Incidences comptables des
relations avec l'extérieur) 61
La création monétaire directe par le Trésor (Le statut ambigu du Trésor) 63
La création monétaire par les banques au profit (Trésor: où est la création
du Trésor monétaire?) 65
g4. LE MULTIPLICATEUR DE CREDIT
Le mécanisme du multiplicateur (Le va-et-vient entre crédits et dépôts) 67
La formule simplifiée du multiplicateur (Le multiplicateur, mécanisme
essentiel dans la science économique) 69

La prise en compte des réserves en monnaie centrale
(Les insuffisances de la version dans le multiplicateur simplifiée) 71
g5. DU MULTIPLICATEUR AU DMSEUR DE CREDIT
Les limites du mécanisme du multiplicateur (Effets monétaires et non
monétaires de l'utilisation d'un excédent de liquidité par une banque) 73
Multiplicateur et hypothèses relatives à l'excédent
de monnaie centrale (Le diviseur de crédit) 75
g6. LES CONTREPARTIES DE LA MASSE MONETAIRE
Les créances sur l'extérieur77(La notion de contrepartie) 75
Le crédit interne (Le montant des contreparties) 79
III. LA POLITIQUE MONETAIRE DANS UNE ECONOMIE EN MUTATION81
g1. LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE MONETAIRE
Les différentes catégories d'objectifs (Trois catégories d'objectifs) 83
Pouvoir politique, autorités monétaires et banque centrale: l'exemple français
(Vers une plus grande indépendance de la Banque de France) 85
La situation des banques centrales à l'étranger (Qu'est-ce que l'indépendance
d'une banque centrale?) 87
Le contrôle des taux d'intérêt (L'influence des variations de taux
sur les comportements) 89
Le contrôle des agrégats (Objectif final: le carré magique) 91
g2. LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE,MONETAIRE
La fourniture directe de monnaie centrale aux établissements de crédit
(La procédure des appels d'offres) 93
L'action sur le marché monétaire et les réserves obligatoires
(La politique d'open market) 95
La sélectivité et l'encadrement du crédit (Une diversité de taux) 97
g3. LA LOGIQUE DU FINANCEMENT
Du financement interne au financement externe (Différentes modalités de
Financement) 99
Du financement direct au financement indirect (L'intégration du financement
dans le circuit économique) 101
Du financement non monétaire Les deux logiques de financement
au financement monétaire (externe indirect) 103
g4. L'ECONOMIE FRANÇAISE AU DEBUT DES ANNEES 80 : UNE
ECONOMIE D'ENDETTEMENT
Un financement par le système bancaire (Le développement des opérations
sur les marchés financiers à partir des années 80) 105
Des marchés de capitaux réduits et cloisonnés (Inflation et allégement de la dette) 107
Les conséquences du financement bancaire un mode de financement des
et du cloisonnement des marchés (entreprises inflationniste) 109
g5. UN CONTEXTE DES ANNEES 80 FAVORABLE AUX MUTATIONS
L'environnement économique (Institutions financières et Trésor
Public) 111
L'évolution du comportement des agents (Bilan d'une année boursière:
l'exemple de 1993) 113
Les contraintes du système bancaire (Les autorités bancaires) 115
g6. UN DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE CAPITAUX IMPULSE
PAR L'ETAT
Le décloisonnement des activités bancaires (La classification établie par la loi
bancaire de 1984) 117
Du décloisonnement à la réorganisation L'évolution de la structure du
des financements (bilan des banques) 119
Le développement du marché financier (Le nouveau visage d'un marché

financier plus diversifié) 121
Un exemple de nouveau marché: le MONEP (Le MONTIF) 123
IV. L'ORGANISATION MONETAIRE À L'ECHELLE INTERNATIONALE 125
1. ETALON-OR ET PAIEMENTS INTERNATIONAUX
Etalon-or et stabilité des changes:
la théorie des points d'or (Arbitrage et stabilité des changes) 127
Etalon-or et équilibre des balances commerciales (Le mécanisme de retour à
l'équilibre) 129
g2. LA NECESSITE DE S'AFFRANCHIR DU METAL
Un nouveau contexte après la Première Guerre mondiale
(Divers niveaux de convertibilité) 131
Les tentatives de rattachement au métal pendant l'entre-deux-guerres
(L'échec du retour à la convertibilité de la livre) 133
g3. LE SMI DE BRETTON WOODS
Les règles de fonctionnement du système Parités fixes et marges
de Bretton Woods (de fluctuation) 135
Les déséquilibres engendrés Asymétrie et contradictions du par le système
de Bretton Woods (système) 137
L'effondrement du système de Bretton Woods
(Les avantages des changes) 139
Flottants)
g4. LA DIFFICILE STABILITE DES CHANGES
Taux d'inflation et taux de change (La couverture du risque de Change) 141
Taux d'intérêt et taux de change (Marchés de capitaux et marché
des changes) 143
Mouvements de biens et services et taux de change (Emprunter des devises
pour assurer un financement en francs) 145
g5. LA TENTATIVE D'INTEGRATION MONETAIRE EUROPEENNE
Le serpent monétaire (La réduction des marges de fluctuation par le serpent) 147
Le système monétaire européen (SME) (Ecu, cours pivot et marges de
Fluctuation) 149
Vers une monnaie unique (Risques et avantages de la monnaie unique) 151
g6. PAIEMENTS, FINANCEMENTS ET ENDETTEMENT
Les mouvements de capitaux â long terme dans la balance des paiements
(De la balance commerciale à la balance des transactions courantes) 153
Les mouvements de capitaux â court terme
dans la balance des paiements (La balance des paiements de la France) 155
La globalisation financière (Une autonomisation de la sphère financière?) 157
La montée de l'endettement international (Les tentatives de solution
au sur endette ment des pays en développement) 159
V. MONNAIE ET PRIX 161
g1. L'AFFIRMATION D'UNE LIAISON ENTRE MONNAIE ET PRIX
CHEZ LES PRE-CLASSIQUES
L'explication de la hausse des prix
par M. de Malestroit au XVI- siècle (L'illusion du renchérissement) 163
La réponse de Jean Bodin â Malestroit : l'ébauche du raisonnement quantitatif
(Les mercantilistes et la monnaie) 165
L'analyse de Richard Cantillon (La contestation du mercantilisme: physiocratie
et économie classique) 167
g2. LA FORMULATION DE LA THEORIE QUANTITATIVE PAR
LES CLASSIQUES

Une réalité à découvrir derrière le voile monétaire (La loi des débouchés) 169
Quantité de monnaie et niveau des prix (Les apports complémentaires de
John Stuart Mill) 171
g3. EQUILIBRE WALRASIEN ET EQUATION DE FISHER
L'intégration de la monnaie dans l'équilibre général
(La naissance de l'école néoclassique) 173
De l'équilibre général à la théorie quantitative (L'intégration des nouvelles
formes monétaires) 175
L'équation d'Irving Fisher (M, seule variable à agir sur P) 177
g4. LA DEMANDE DE MONNAIE DANS L'EQUATION QUANTITATIVE
DE CAMBRIDGE
La prise en compte de la demande de monnaie par Alfred Marshall
(De Marshall à Pigou) 179
La formulation de l'équation quantitative De Fisher à Pigou :
de Cambridge par Arthur Cecil Pigou (la compatibilité des équations) 181
Une formulation de la théorie quantitative par John Maynard Keynes
(De Pigou à Keynes) 183
Une approche critique de John Maynard Keynes
dans le Traite sur la monnaie (L'autocritique de Keynes) 185
g5. L'APPORT DE DON PATINKIN
« Une critique de la théorie monétaire néo-classique"Au-delà de la simple
relation par Don Patinkin (entre M et P) 187
La théorie quantitative renforcée par le mariage le mécanisme de l'effet
du réel et du monétaire: l'effet d'encaisse réelle (d'encaisse réelle) 189
g6. L'APPORT DE MILTON FRIEDMAN
La demande de monnaie analysée par Milton Friedman
(La mesure du rendement des différentes formes de richesse) 191
Vers une nouvelle version de la théorie quantitative (De la richesse totale au
revenu Permanent) 193
L'analyse monétariste de l'inflation (La courbe de Phillips analysée par
Friedman) 195
VI. LA MONNAIE AU CŒUR DU REEL 197
g1. LA THEORIE QUANTITATIVE MISE A MAL
L'école suédoise: Knut Wicksell et la nécessité
de raisonner sur une économie monétaire (L'impact de la monnaie sur le réel) 199
L'école française: Bertrand Nogaro et les effets Des idées novatrices et un
de la monnaie sur l'activité économique (affinement tardif) 201
L'école française: Albert Aftalion et la relation de causalité entre monnaie et
prix (La critique des équations de la théorie quantitative) 203
L'école autrichienne: De Ludwig von Mises à Friedrich von Hayek
(Les effets d'une augmentation des crédits à la consommation) 205
g2. LA THEORIE GENERALE DE JOHN MAYNARD KEYNES
Une demande de monnaie expliquée par la préférence
pour la liquidité (La détermination de l'épargne) 207
Les motifs de la préférence pour la liquidité (La relation inverse entre
l'évolution du taux d'intérêt et celle du cours des obligations) 209
La détermination du taux d'intérêt par confrontation (Détermination graphique du
taux entre offre et demande de monnaie d'intérêt) 211
De la monnaie à l'emploi (Le schéma keynésien) 213
g3. LES DEVELOPPEMENTS NEO-KEYNESIENS
SUR LA DEMANDE DE MONNAIE
William Baumol et l'intégration du taux d'intérêt
dans l'analyse de l'encaisse de transactions (La démonstration de Baumol) 215
James Tobin: la préférence pour la liquidité expliquée par le comportement
face au risque (Les effets des prévisions sur les (taux d'intérêt) 217
 6
6
1
/
6
100%