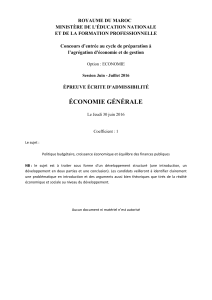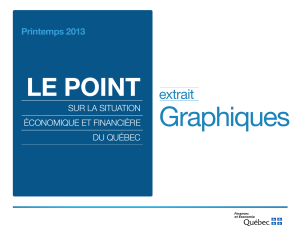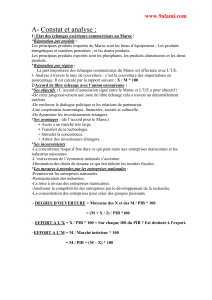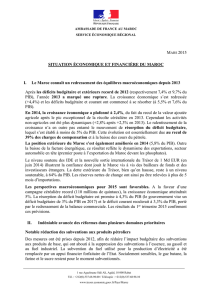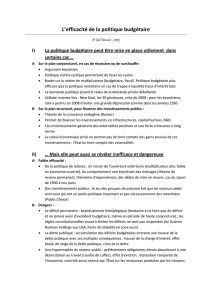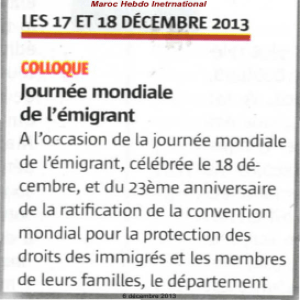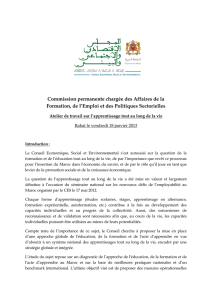Revue économioque du 24 avril au 1er mai 2011

Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération
Direction de la Communication
Revue Économique hebdomadaire
N°17 du 24 avril au 1er mai 2011
Pékin et Tokyo resteront
bien présents sur la
dette américaine
Analyse:
Les déséquilibres
globaux sont de retour
Maroc/Espagne :
des gisements de
croissance et de contrats
Finance :
Le CAC 40 à
la loupe.
[SOMMAIRE]
Presse économique nationale
Presse économique internationale
Page Finances
Brèves Eco
Eco zoom
07
Zoom national
05
09
09
Zoom international
02 Fissure
02 Risqué!
02 La Vie Eco répond à Al Alam
03 Déficit budgétaire: tensions sans précédent
03 Le luxe agonise
04 Peut-on contrôler les déficits?
04 Bourse: l’étonnante résilience
05 Les déséquilibres globaux sont de retour
05 Le secteur pétrolier à l’épreuve de la transpa-
rence
06 La main invisible du marché– patience et lon-
gueur de temps
06 Les deux visages de l’Amérique latine
07 Prix du pétrole et récessions mondiales
07 Le CAC 40 à la loupe
07 Les sociétés cotées distribuent les 2/3 de leurs
bénéfices en dividendes
08 Le spectre de la pénurie du carburant plane sur
la Russie
08 L’Irlande, la Grèce ou le Portugal pourraient ne
plus être notés
08 Le Maroc et l’Algérie s’entendent sur la coopé-
ration agricole
08 Le Japon va devoir s’endetter pour se recons-
truire
08 L’économie marocaine est en bonne santé, selon
le FMI
09 Maroc/Espagne: des gisements de croissance et
de contrats
09 Pékin et Tokyo resteront bien présents sur la
dette américaine

Fissure
L’état des finances publiques com-
mence à inspirer de
sérieuses inquiétudes.
L’année dernière s’est
terminée sur une explo-
sion du déficit. Il s’est
situé à 35 milliards de
DH. Pour l’année 2010, on espérait
maintenir le déficit du Trésor par
rapport au PIB aux alentours de
4%, ce qui est déjà au-dessus du
niveau cible. C’est donc raté. Pour-
tant, c’est le démarrage de l’année
2011 qui suscite le plus d’inquié-
tude. Effectivement, l’expansion
des dépenses publiques ordinaires
se poursuit. Avec un chiffre ren-
versant: plus 19% sur un seul
mois! Le premier poste d’explo-
sion est bien évidemment celui des
subventions à la consommation. Le
malheur est que cette première
explosion en cache une autre, celle
des dépenses ordinaires. A elles
seules, ces dépenses ordinaires ont
bondi de plus de 10%. Il s’agit
autant de matériel et fournitures
que de salaires et frais associés. Et
tout cela, alors que le dialogue
social n’avait pas commencé.
Tout cela, alors que la pression
politique du 20 février n’avait pas
commencé non plus. Les dépenses
publiques du Maroc sont
comme un accident de
centrale nucléaire: une
fissure, une fuite, la sur-
chauffe et l’explosion…
laquelle lance le même
processus de fuite et d’explosion
dans le réacteur d’à-côté. Pourtant,
on voit la reprise du ciment, de
l’appel électrique; on aura une
bonne récolte; les exportations
aujourd’hui sont classées dans la
rubrique «miracle». Et pour cou-
ronner le tout, le Maroc décroche
une super notation, dans laquelle la
composante politique est forte
alors que ce pays se croyait nul en
la matière. Nous avons donc un
divorce profond entre l’économie
réelle, celle des champs et des usi-
nes, et celle de l’État. La compen-
sation n’y joue qu’un rôle aggra-
vant. Le cœur du problème est bien
la gestion de la fonction publique
et des missions de l’État. En un
mot comme en cent, les dépenses
publiques sont hors contrôle.
L’Économiste
Revue Nationale: Éditoriaux et Chroniques
P 2
La fébrilité affichée par le Gouvernement
en ces temps de dialogue social n’a d’égale
que la maladresse avec laquelle certaines
plumes tentent de défendre son Premier
ministre. Dans son édition du 15 avril, La
Vie éco avait titré en une: «Salaires : Ab-
bas El Fassi a-t-il les moyens de ses pro-
messes ?». Quatre jours plus tard, la presse
économique a eu les honneurs d’un tir en
bonne et due forme de la part de notre
confrère Abdellah Bekkali rédacteur en
chef d’Al Alam, le journal du parti. On
présente notre ligne éditoriale comme celle
d’une «dérive dans la défense de l’intérêt
des entreprises » et on nous prie d’arrêter
notre «militantisme visant à faire échouer
le dialogue social». Si le commentaire est
libre, si le débat est bienvenu, les accusa-
tions, elles, appellent réponse. Il convient
de dire à notre confrère de relire un peu
plus attentivement ce que nous avons écrit
et de prendre le temps de se détacher de sa
logique populiste pour endosser sa cas-
quette de citoyen marocain. Dans notre
article, nous avons mis le doigt sur le fait
qu’avant même que le dialogue social ne
démarre officiellement, le Premier Minis-
tre a déjà engagé les finances de l’État à
hauteur de 5,8 milliards de DH de surplus
annuel, correspondant à la hausse de la
masse salariale dans la fonction publique.
Où est la «défense des intérêts de l’entre-
prise» dans ce cas? De quelle entreprise
parlons-nous? Nous parlons de l’État et
des finances publiques, nous parlons d’en-
gagements pris dans la précipitation et qui
risquent d’hypothéquer l’avenir. Défendre
la hausse des salaires pour compenser la
cherté de la vie c’est bien, mais que dire
quand, en six ans, la masse salariale dans
la fonction publique augmente de 35%
alors que dans le même temps le coût de la
vie, lui, n’a progressé, très exactement que
de 12,7%? Pire, pendant ce temps-là, la
productivité du fonctionnaire n’a pas aug-
menté dans les mêmes proportions que les
salaires. Pire, pendant ce temps-là, les
coûts de la compensation explosent. Pire,
en 2010, le Maroc a connu son plus lourd
déficit depuis 2005, et en 2011 on se dirige
vers le même chiffre. Voilà donc les véri-
tés que nous disons, cher confrère, et elles
sont mues par l’intérêt national, car la dé-
rive budgétaire est le plus dangereux des
ennemis. Regardez la Grèce, le Portugal et
l’Espagne. Mais peut-être que vos soucis
actuels sont plus terre à terre: la défense
des décisions du Premier Ministre, votre
camarade militant, fût-ce au détriment de
l’intérêt de l’État.
La Vie Eco
Risqué!
Qu’est-ce qui rend l’investissement si
excitant? La quête continue du profit ?
Trop facile, comme réponse. Il y a
mieux! Le risque. Cela a été démontré par les spécialistes
du management et de l’entreprise. Le risque, cette notion
si complexe, chaque businessman y fait face et la gère à sa
manière. Du coup, les grilles d’évaluation diffèrent au
moment de franchir le cap. Du flair, il en faut certes, mais
un homme d’affaires mal entouré et mal outillé, ne peut
prétendre réussir son investissement en limitant au maxi-
mum les risques d’un échec certain. Chez nous, la gestion
du risque entrepreneurial mérite bien une grande enquête,
mêlant à la fois les facteurs psychologique et économique.
À défaut de disposer d’une radioscopie en bonne et due
forme du degré de risque que supporte l’investisseur maro-
cain, il est intéressant de s’attarder sur les indicateurs dé-
voilés par l’étude commanditée chaque année par les in-
vestisseurs en capital. À priori, la situation est rassurante.
On parle même d’une tendance haussière, avec une mon-
tée en puissance des fonds sectoriels. Et le capital risque
dans tout cela? Pas de quoi sauter au plafond. En un mot,
les propriétaires des fonds ne veulent pas trop risquer leurs
billes et privilégient des investissements plus «sûrs». Bien
évidemment, une telle approche fait des victimes, à com-
mencer par les PME. Entre le manque de cran de nos jeu-
nes investisseurs et la frilosité des fonds destinés à leur
donner un coup de pouce, il y a de quoi se poser des ques-
tions. Nos PME, qui représentent quand même 95% du
tissu économique, sont elles risquées à ce point ?
Les Échos (Maroc)
La Vie Eco répond à
Al Alam

Déficit budgétaire: tensions
sans précédent
Toutes les administrations et entreprises
publiques ont été averties par le Gouverne-
ment: ne dépensez que 80% du budget qui
vous a été octroyé par la loi de Finances!
D’ordinaire cette demande n’arrivait qu’en
été. Jamais mars avril. Ça s’annonce donc
plutôt mal pour les caisses de l’État en ce
début 2011. Rien qu’en janvier, le déficit
ressort à 3,4 milliards de DH. C’est 1 mil-
liard de DH de plus qu’à la même période
de 2010. Ce ne serait pas Abdellatif Jouahri,
Gouverneur de Bank Al-Maghrib qui dirait
le contraire. En effet, il a mis en garde le
Gouvernement, lors du denier conseil de la
banque en mars dernier, sur l’importance de
renforcer «la vigilance» et d’assurer «une
soutenabilité du déficit». Cette soutenabilité
se traduit par un déficit se situant entre 3 et
4% en fonction de la conjoncture, associé à
un niveau d’endettement public ne dépas-
sant pas 60% du PIB. Sur ce dernier point,
nous avons encore un peu de marge. «Le
déficit doit être contenu dans des limites
acceptables qui puissent permettre à l’État
de le financer sans recourir de manière exa-
gérée au monétaire», disait Jouahri. Cela
risque de mettre le finan-
cement du secteur privé
en résiduel et par consé-
quent, affecter la crois-
sance et pousser vers
l’augmentation des taux.
La soutenabilité du défi-
cit est, également, un pré
requis essentiel pour la
promotion de la place
financière de Casablanca
dont le road show est
programmé pour la ren-
trée prochaine. En atten-
dant, la situation du défi-
cit est plutôt critique.
Prenant compte de la
réduction du stock des arriérés de paiement
de 2,7 milliards de DH, le besoin de finan-
cement du Trésor s’est hissé à plus 6 mil-
liards de DH. Pour combler ce manque, le
Trésor a mobilisé 5,4 milliards de DH sur le
marché intérieur et 717 millions de DH de
flux net extérieur. Dans la foulée, les dépen-
ses se sont inscrites à la hausse (+8%) à plus
de 19 milliards de DH en un an. A elles
seules, les dépenses ordinaires (les salaires,
le fonctionnement, le train de vie de l’É-
tat…) bondissent de près de 19% atteignant
18,5 milliards de DH. Selon les Finances,
«cet alourdissement pro-
vient de la hausse de
5,4% des dépenses du
personnel et de 4,6% de
celles des autres biens et
services». Ce qui donne
un plus de 10% pour les
dépenses de fonctionne-
ment plus donc que pour
la compensation elle-
même. Les charges en
intérêts, pour leur part,
marquent un bond de plus
de 62%, sous l’effet de
l’alourdissement de
58,4% du service de la
dette intérieure et de
120,8% de celui de la dette extérieure. Les
dépenses de compensation restent le talon
d’Achille du budget. Elles bondissent de
plus de 80% pour s’élever à 3,4 milliards de
DH juste pour un seul mois en raison de la
flambée du pétrole. Les dépenses d’inves-
tissement progressent également pour at-
teindre 7,3 milliards de DH pour un taux de
réalisation de 15,2%. Ce qui est un bon si-
gne, sauf si dans ces dépenses se cachent de
vraies dépenses de fonctionnement reclas-
sées avec un programme d’investissement.
L’Économiste
P 3
Analyses
Le luxe agonise
Rareté du foncier, inadéquation
entre offre et demande... et
printemps arabe pour enfoncer
le clou. L’immobilier est dans
une bien mauvaise passe. Cer-
tes, le Ministère de l’Habitat a promis que
l’année 2011 serait une année de relance,
principalement pour le logement social et le
moyen standing. Aujourd’hui, pourtant, le
haut standing vit une morosité particulière,
qui est venue rompre avec plusieurs années
d’euphorie. «Nous avons effectivement
constaté un effondrement des prix » recon-
naît Ahmed Taoufiq Hejira, Ministre de
l’Habitat. En fait, depuis le mois de janvier
dernier, les promoteurs immobiliers font
face à un brusque renversement de ten-
dance, qui met le secteur dans une situation
peu commune. Pour des riads qui valaient
3,5 à 4 MDH il y a cinq mois, les propriétai-
res se retrouvent aujourd’hui obligés de
baisser leurs prix d’au moins 20% pour li-
quider leur bien. C'est idem pour les appar-
tements. Qu’est ce qui explique donc ce
marasme? Pour les profession-
nels, la raison en est toute sim-
ple. Ce qui se passe dans les
rues arabes a un impact indé-
niable. Nous avons moins d’a-
cheteurs pour les projets golfi-
ques, ce qui a freiné la ten-
dance haussière du marché et cela en dit
long sur la non résilience du marché du lo-
gement de luxe au printemps arabe. Même
dans le cas où des acheteurs potentiels, flai-
rant la bonne affaire dans le contexte actuel,
veulent franchir le pas, «cela prend beau-
coup plus de temps pour conclure la tran-
saction que cela n’était le cas auparavant, en
raison justement de l’hésitation», explique
un agent immobilier. Dans ce contexte, c’est
toute l’industrie du résidentiel de luxe qui
s’en trouve pénalisée. Or, du moment que
les transactions piétinent, le fond de roule-
ment des opérateurs et leur capacité de rem-
boursement des échéances de prêts contrac-
tés auparavant piétine aussi. Quelle solu-
tions? Interpellé à ce sujet, Hejira annonce
que le département de tutelle s’attelle déjà à
résoudre ces questions. Dans un premier
temps, il s’agit de réunions entreprises par
le Ministère, en incluant les opérateurs, afin
de les convaincre de baisser davantage leurs
prix de ventes. «Il s’agit de réduire de 30 à
35% les prix de vente, afin de liquider au
maximum les unités invendues», insiste le
Ministre. L’autre mesure proposée par Heji-
ra est le dialogue avec les établissements
bancaires. Le Ministre recommande en effet
de négocier un rééchelonnement des dettes
antérieures, afin de libérer plus de lignes de
financement pour les promoteurs. Or, à ce
niveau, il s’agit avant tout de trouver le
moyen de convaincre les banques de faire
un geste envers le secteur, chose qui n’est
pas acquise d’avance, lorsque l’on sait que
la logique veut qu’un secteur en mal de
chiffre d’affaires est un secteur très risqué.
Cela dit, même en ayant le soutien des ban-
ques, il est bien clair que ces deux solutions
ne permettent pas de résoudre le problème
structurel qui est l’absence de clients, sans
lesquels le chiffre d’affaires ne peut
se réaliser.
Les Échos (Maroc)
Ce creusement du déficit est le
résultat d’une hausse plus mar-
quée des dépenses, tirée par
l’augmentation des charges de
compensation.

Bourse: l’étonnante résilience
Résilience: capacité à surmonter les chocs traumatiques, selon la
définition du « Petit Robert ». Ce mot, remis à
la mode par le psychologue Boris Cyrulnik,
s'applique aussi... à la Bourse. Qu'on en juge:
ces derniers mois, les marchés se sont pris sur la
tête rien de moins que la révolte dans les pays
arabes qui fait flamber les prix du pétrole, la
catastrophe japonaise (séisme + tsunami + acci-
dent nucléaire) qui remet en cause toute l'équa-
tion énergétique mondiale et pourrait peser sur
la croissance de l'archipel, troisième économie
de la planète, la crise de la dette des pays fragiles de la zone euro
et, désormais, les mises en garde sur la dette américaine. On serait
fragilisé à moins. Et pourtant, vaille que vaille, avec certes des
soubresauts, le CAC 40 et ses camarades Dow Jones, Footsie ou
DAX résistent. Pas de krach, de simples baisses suivies rapide-
ment de rebonds, le tout dans des volumes honorables. Une capa-
cité d'encaisse digne des plus solides boxeurs. Il y a au moins
deux raisons, d'ailleurs complémentaires, à ce phénomène rassu-
rant pour les actionnaires. D'abord, il existe encore d'énormes
liquidités qui cherchent à se placer. Reste à sa-
voir où, se demandent les investisseurs. Les
obligations d'États? On le voit, leur ratio risque/
rendement tend à se détériorer. L'immobilier? Il
paraît plus en phase de stabilisation voire de
baisse que désireux de poursuivre sa folle envo-
lée des dernières années. Les matières premiè-
res? Beaucoup sont en plein essor - à commen-
cer par l'or et l'argent - mais restent très volati-
les et pas toujours faciles à matérialiser sous
forme de véhicule financier. Les actions alors? Et pourquoi pas?
D'autant - et c'est la deuxième raison à la résilience boursière ac-
tuelle - qu'en ce moment les entreprises cotées annoncent presque
toutes de bons résultats, tirés notamment par leurs succès dans les
pays émergents.
La Tribune
P 4
Revue internationale: Éditoriaux et Chroniques
Peut-on contrôler les défi-
cits?
Depuis sa prison, le célè-
bre escroc Bernard Ma-
doff a récemment affirmé
que « les Gouvernements
font des pyramides de Ponzi ». Peut-être
était-ce là la déclaration d'un homme pre-
nant ses rêves pour la réalité, alors qu'il
mourra en prison à la suite de l'effondre-
ment en 2008 de son propre système pyra-
midal de 50 milliards de dollars. Mais on
peut effectivement se demander quels sont
exactement les projets budgétaires de Gou-
vernements confrontés à la combinaison
mortelle d'un endettement insoutenable,
d'engagements financiers sans précédent
pour les caisses de retraite et d'une réduc-
tion de la croissance. La dette publique aux
États-unis - fédérale, des États et munici-
pale -a maintenant dépassé le record de
120 % du PIB de la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Le Japon est dans une
situation pire encore avec une dette de plus
de 200 % du PIB, sans compter les coûts
massifs de reconstruction après le tsunami.
Et de nombreux autres pays sont dans une
mauvaise passe. Il n'y a pas de solution
facile. Pour l'instant, les taux d'intérêt mon-
diaux faibles limitent les coûts du service
de la dette. Cependant, les niveaux de dette
ne peuvent être réduits que très graduelle-
ment sur des longues périodes. L'impact le
plus immédiat serait de maîtriser les dépen-
ses en s'opposant aux prévisions de crois-
sance et de recettes fiscales de Gouverne-
ments insouciants. En principe, un Conseil
budgétaire indépendant, et respecté, pour-
rait forcer les Gouvernements à reconnaître
les coûts cachés liés aux garanties et dettes
hors budget. Il est grand temps de considé-
rer de nouvelles approches. Bien sûr, aucun
changement simple n'éliminera les dépen-
ses sans frein. Et aucun changement simple
n'empêchera le risque de futures crises de
la dette ou de l'inflation. De nombreux pays
nécessitent des réformes en profondeur. La
création récente de conseils budgétaires
indépendants est un début institutionnel
encourageant. Plusieurs pays, dont le Dane-
mark, les Pays-Bas, les États-unis et la Bel-
gique ont des agences de contrôle budgé-
taire. Cependant, bien que ces institutions
se soient révélées extrêmement utiles, elles
sont très limitées dans leur critique des
politiques budgétaires. Des pays comme la
Suède, le Royaume-Uni, la Slovénie et le
Canada, envisagent la création d'organis-
mes budgétaires disposant de plus d'indé-
pendance à l'égard du pouvoir, à l'image
des banques centrales. On ne peut cepen-
dant pas s'attendre à ce que ces nouvelles
institutions deviennent aussi importantes ou
puissantes que les banques centrales. Bien
sûr, des institutions de prévisions et de
contrôle budgétaire ne sont pas suffisantes.
Il restera toujours très tentant pour chaque
génération de dire: « Mes petits-enfants
seront deux ou trois fois plus riches que
moi, quel est donc le problème s'ils doivent
payer un peu de dette ? » De plus, les cy-
cles électoraux tendent à encourager les
dépenses budgétaires au prix d'un endette-
ment caché et d'une réduction des investis-
sements. Pour résister à ces pressions puis-
santes, il sera nécessaire que les agences
budgétaires indépendantes soient soumises
à des audits réguliers d'institutions multila-
térales comme le FMI. Sans aucun doute,
Madoff peut encore avoir raison et le mon-
tant de sa pyramide de Ponzi peut encore
être dépassé. Mais une plus grande transpa-
rence et une évaluation indépendante plus
systématique des politiques des Gouverne-
ments pourraient contribuer à trouver une
solution à l'énigme permanente des déficits
budgétaires démesurés.
NB: la pyramide de Ponzi est un circuit
frauduleux qui consiste à rémunérer les
investissements effectués par les clients,
au moyen essentiellement des fonds pro-
curés par les nouveaux entrants, le sys-
tème étant découvert et s'écroulant
quand les sommes procurées par les nou-
veaux entrants ne suffisent plus à cou-
vrir les rémunérations des clients.
Les Échos (France)

Analyses
Les déséquilibres globaux
sont de retour
Pour rééquilibrer l'économie mondiale, la
Chine devrait stimuler sa consommation,
l'Allemagne engager une relance de sa
demande intérieure et les États-unis remé-
dier à la faiblesse de leur épargne. Le
moyen le plus simple d'y parvenir serait de
s'entendre pour jouer sur les taux de
change, mais pour l'instant ça bloque. Une
batterie d'indicateurs. C'est ce à quoi se
résument les résultats du G20, réuni en
février à Paris pour promouvoir entre
autres un rééquilibrage de la croissance
mondiale. Pas un mot sur les taux de
change, ni sur les réserves de change: le
barrage chinois à toute référence suscepti-
ble de placer les pays qui dégagent des
excédents commerciaux en position d'accu-
sé a tenu bon. En matière commerciale,
comme dans le domaine financier, un désé-
quilibre met toujours en cause deux parties.
Les excédents chinois ne seraient pas pos-
sibles sans les déficits américains et inver-
sement. L'Espagne ne serait pas tant défici-
taire dans ses échanges extérieurs si l'Alle-
magne n'était pas tant excédentaire. Aux
griefs américains sur le caractère mercanti-
liste de la politique chinoise, répondent les
réprimandes chinoises, à forte connotation
morale, sur l'endettement inconsidéré des
Américains, qu'il s'agisse des citoyens ou
de l'État. Insoluble à court terme. Les
deux parties sont dans le vrai, mais les
moyens préconisés par chacune d'entre
elles, par-delà leur symétrie apparente, ne
produisent pas du tout les mêmes résultats.
Si la raison des créanciers devait l'empor-
ter, comme c'est le cas en Europe, la ré-
sorption des déséquilibres sera de nature
récessive pour tous, la contraction de la
demande dans les pays endettés freinant la
croissance globale. Si la raison des débi-
teurs l'emporte, la résorption des déséquili-
bres pourra se faire dans la croissance des
uns et des autres. La Chine et avec elle
l'Allemagne ont donc tort. Le problème est
qu'elles ont tort du point de vue de la
bonne marche de l'économie mondiale,
mais pas de leurs points de vue particuliers.
La Chine pourrait difficilement stimuler sa
consommation sans attiser une inflation
qui, déjà, fait mine de s'envoler. Elle évo-
que ouvertement la nécessité de rééquili-
brer son modèle de croissance, mais sait
que cela ne se fera que sur la durée, tandis
qu'à court terme, tout ralentissement de ses
exportations menace l'emploi et la stabilité
sociale. Et l'Allemagne, qui digère encore
la réunification et dont la dette publique
dépasse 80 % de son produit intérieur brut
(PIB), se voit mal faire de la relance bud-
gétaire pour rééquilibrer sa croissance.
Plutôt que laisser son taux de change s'ap-
précier, la Chine quant à elle absorbe l'of-
fre excédentaire de devises sur le marché.
Elle a ainsi accru ses réserves de change de
2 500 milliards de dollars entre 2002 et
2010. Pour éviter de lui céder des parts de
marché, les autres pays émergents freinent
à leur tour l'appréciation de leur taux de
change vis-à-vis du yuan, et donc du dollar.
De 1,7 trillion (1,7 milliard de milliards) de
dollars en 1995, les réserves de change
mondiales sont ainsi passées à près de 9
trillions en 2010, dont 6 dans les écono-
mies émergentes et en développement en
incluant Taiwan, la Corée du Sud, Singa-
pour et Hongkong). Risque de conflit. A
trop sous-estimer les problèmes posés par
les déséquilibres des échanges, on risque
d'encourager leur résorption par des voies
conflictuelles. En refusant la réévaluation
de sa monnaie, la Chine n'attise pas simple-
ment l'inflation et les bulles spéculatives
chez elle, elle pousse aussi les États-unis à
promouvoir le redressement de leur écono-
mie par une poursuite de la détente moné-
taire et la baisse du dollar. Ce qui, en fai-
sant monter l'euro, attise la crise en Eu-
rope, et suscite les accusations de guerre
monétaire. De quoi encourager le G20 à
redoubler d'effort.
Alternatives Économiques
Le secteur pétrolier à
l’épreuve
de la transparence
Le monde arabe est en ébullition. Question:
Y’a t-il un danger de nationalisation et d'un
retour au «nassérisme»? «Quasi nul », ré-
pondent les spécialistes de la zone. «Les
nouveaux Gouvernements égyptien et tuni-
sien n'ont pas le choix: ils dépendent totale-
ment des investissements étrangers pour
accroître la production pétrolière, essen-
tielle pour leurs recettes budgétaires », ex-
plique le directeur financier d'une petite
compagnie opérant en Égypte. Un scénario
risque toutefois d'écorner les ambitions
égyptiennes des compagnies pétrolières:
l'opinion publique pourrait réclamer davan-
tage de gaz pour le marché domestique.
« Lors de la négociation de futurs contrats,
on peut imaginer des pressions pour que la
part des exportations soit un peu réduite au
profit de l'approvisionnement du marché
égyptien», spécule Francis Perrin, directeur
de la revue Pétrole et gaz arabes. En cou-
lisse, l'atmosphère n'est donc pas si sereine.
Car une déstabilisation progressive des
États du Golfe aurait un impact considéra-
ble sur les énergéticiens. Or, dans cette
région qui recèle les deux tiers des réserves
mondiales d'or noir, de nombreux indices
montrent que la paix sociale n'est plus ga-
rantie: annonce subite de 25 milliards d'eu-
ros d'aides sociales en Arabie saoudite,
envoi de troupes à Bahreïn, manifestations
sanglantes au Yémen…Ce nouveau
contexte pourrait aussi accroître les pres-
sions des opinions publiques en faveur
d'une plus grande transparence du marché
pétrolier. «L'évolution des pays arabes vers
la démocratie devrait s'accompagner de
revendications locales visant à une meil-
leure distribution des recettes pétrolières»,
juge François Valérian, chargé des pro-
grammes privés de l'ONG Transparency
International. Les compagnies pétrolières
déclarent vouloir progresser dans ce do-
maine, adhérant ainsi à l'Initiative pour la
transparence des industries extractives.
Mais il faudra aussi que leurs interlocuteurs
locaux acceptent de lever l'omerta.
L’Expansion
P 5
Taux d’épargne en % du PIB
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%