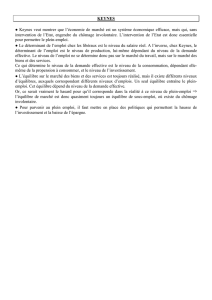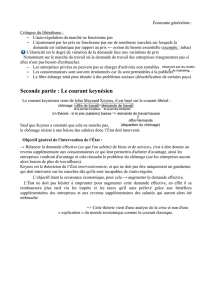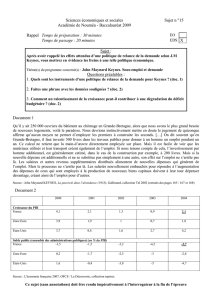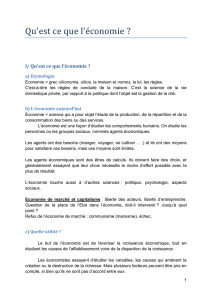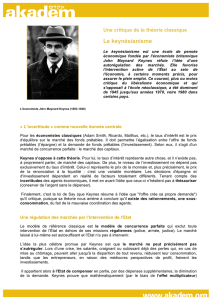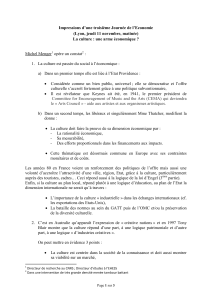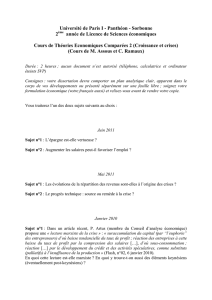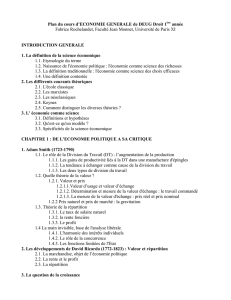Questions pour un keynésien

1
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS
Année 2004-2005
Premier cycle, première année - deuxième semestre
Conférence de Mademoiselle Annick STETA
Milène Gréhan
Point d’histoire de la pensée économique :
KEYNES ET LES CLASSIQUES
Questions pour un keynésien
Présentateur : Poursuivons notre jeu avec des questions sur Keynes et les classiques.
Première question : Qui peut me dire qui sont les classiques selon Keynes ?
Joueur 1 : Les classiques ? Ce sont les économistes comme Smith, Ricardo, Mill, Say,
Malthus, des économistes de la fin du XVIIIème siècle, contemporains de la révolution
industrielle. Ce sont les fondateurs de l’économie en tant que science dans la mesure
où ils ont cherché des lois, des explications rationnelles pour comprendre les
phénomènes économiques.
Joueur 2 : Certes, c’est la définition que l’on retient généralement pour les
économistes classiques, mais quand Keynes parle des classiques, il évoque un
ensemble plus large qui regroupe tous les économistes croyant en un système
économique qui s’autorégule : ses précurseurs qui acceptent la loi des débouchés de
Say.
Présentateur : Oui, tout à fait, la Théorie générale contient non seulement la théorie de
Keynes mais aussi une attaque contre les économistes que Keynes nomme les
classiques. Il s’agit en effet d’un ensemble hétérogène qui regroupe ses maîtres. Ce
qu’on peut également noter, c’est que pour mieux pourfendre cet adversaire, Keynes
en donne dans son œuvre une image tout à fait caricaturale : il réduit leur théorie à
quelques principes fondamentaux, à quelques grandes lignes qu’aucun économiste,
dans la réalité, n’a vraiment assimilées au fonctionnement concret de l’économie.
D’une certaine manière, on peut dire qu’il a créé son adversaire pour mieux l’attaquer.
Sa critique en est plus virulente et plus efficace.
Deuxième question : Vous parliez de la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say. Qui
pourrait me dire en quoi consiste cette loi ?
Joueur 1 : La loi de Say précise que l’offre crée sa propre demande, c'est-à-dire que
tous les revenus distribués à l’occasion de la production sont forcément dépensés pour
l’achat de cette même production ; l’offre égale la demande. Selon cette loi, il ne peut
y avoir de surproduction.
Présentateur : Tout à fait ; on peut résumer la loi des débouchés par le schéma
suivant :

2
Offre (production) Demande
Revenus (profits, salaires) Consommation
Epargne Investissement
Présentateur :
Troisième question : Continuons sur la loi de Say : que dire de la vision de Keynes à
ce sujet ?
Joueur 2 :
Au sujet de la loi des débouchés, Keynes écrit dans la Théorie Générale qu’ « il est
évident qu’une théorie fondée sur une telle base ne saurait convenir à l’étude des
problèmes se rapportant au chômage et au cycle économique ». Keynes admet que
toute la production est distribuée sous la forme de revenus, mais il critique l’idée selon
laquelle l’épargne est intégralement investie (ce sont les problèmes de thésaurisation,
des provisions financières, de tout l’argent qui est sorti du système économique). A
partir de là, si l’épargne excède l’investissement, la demande va être inférieure à
l’offre et il y aura surproduction.
Présentateur :
Quatrième question. Oui tout à fait, et en ce qui concerne la loi de Walras ? Plus
largement, que dire de l’équilibre de Keynes par rapport à celui des classiques ?
Joueur 1 :
De manière générale, on l’a vu, Keynes prend le contre-pied des classiques. C’est
encore plus nettement le cas en matière d’équilibre économique. En effet, selon
Keynes, l’équilibre de l’économie n’est pas le produit de mécanismes automatiques
mais la résultante de l’addition de plusieurs fonctions de comportement. L’équilibre
obtenu, si on laisse jouer les mécanismes, n’a, selon Keynes, que peu de chances
d’être de plein emploi : Keynes parle d’équilibre de sous-emploi.
Joueur 2 :
Keynes dit qu’« on a commis des erreurs graves en étendant au système pris dans son
ensemble des conclusions qui avaient été correctement établies en considération d’une
seule partie du système prise isolément ». Il critique par là la loi d’équilibre général de
Walras.
Présentateur : Vos réponses sont justes, mais ce que j’attendais surtout, c’était que la
théorie de l’équilibre de Keynes était axée sur la notion de demande globale ; on
qualifie les keynésiens d’économistes de la demande par opposition aux classiques,
économistes de l’offre. Pour lui, ce sont les flux des dépenses qui déterminent le
niveau de l’activité économique, et donc celui de l’emploi. Pour Keynes, « la théorie
de Walras et les autres du même style ne sont pratiquement qu’un tissu d’âneries ».
Cinquième question : Nous allons passer à la question de la détermination de
l’emploi. Avant toute chose, êtes vous capables de me rappeler les postulats de
l’économie classique à ce sujet ?

3
Joueur 1 : Très rapidement, on peut dire que, selon les classiques, l’employeur a
intérêt à embaucher tant que le salaire est inférieur à la productivité marginale du
travail, c'est-à-dire à ce que produit le dernier salarié embauché, car le coût du travail
est inférieur à ce qu’il rapporte ; en revanche, dès que le salaire devient supérieur à la
productivité marginale du travail, le coût du dernier salarié embauché devient plus
élevé que ce qu’il rapporte, donc l’employeur n’embauchera pas ce salarié.
L’embauche est donc « rentable » jusqu’à ce que la productivité marginale du travail
égale le salaire : c’est le salaire d’équilibre, clef de voûte de l’équilibre sur le marché
du travail selon les classiques.
Joueur 2 : A partir de là, les classiques avancent que le chômage ne peut être que de
frottement, c'est-à-dire frictionnel : un chômage de court terme lié aux délais
d’ajustement, ou bien volontaire quand les travailleurs refusent de travailler pour le
salaire de marché. En dehors de ça, le chômage est, selon eux, absolument impossible.
Présentateur : En fait, la théorie classique repose sur deux fonctions : la demande est
une fonction décroissante du salaire, ce qui signifie que s’il y a baisse du salaire, il y
aura hausse de l’embauche (d’où l’idée qu’il faut laisser les salaires fluctuer et ne
surtout pas intervenir, ce qui, en rigidifiant les salaires, entraînerait du chômage) ; les
travailleurs acceptent d’offrir leur travail tant que leur salaire est supérieur au sacrifice
correspondant au renoncement au loisir : l’offre de travail est une fonction croissante
du salaire.
Sixième question : En quoi consiste la critique keynésienne de ces postulats
classiques ?
Joueur 1 : Les classiques raisonnent en terme de salaire réel, c'est-à-dire que les
ménages s’intéressent à l’évolution de leur pouvoir d’achat ; leur rationalité est grande,
ils ne sont pas sensibles à l’illusion monétaire. Keynes considère que la rationalité des
ménages est limitée, que les ménages ne sont sensibles qu’à l’évolution de leur salaire
nominal, qu’ils subissent l’illusion monétaire. Pour Keynes, raisonner en termes de
salaire réel suppose que l’offre de travail varie chaque fois que les prix évoluent, ce
qui, selon lui, ne correspond pas à la réalité. Tout ceci pour dire que selon Keynes, le
niveau de l’emploi ne dépend pas du marché du travail et donc ne dépend pas du
salaire : le niveau de l’emploi est indépendant du salaire réel, le marché du travail ne
fonctionne pas comme les autres marchés.
Joueur 2 : Pour Keynes, la demande de travail dépend de la demande anticipée en
biens et services de consommation et d’investissement. Il n’y a aucune raison pour que
cette demande de travail coïncide avec l’offre de travail. Si la demande est insuffisante,
il y aura sous-emploi, c'est-à-dire chômage involontaire, ce que les classiques
n’envisageaient pas.
Présentateur : Oui. Pour résumer, on peut dire que, selon Keynes, le volume de
l’emploi dépend de la quantité à produire, qui elle-même dépend de la demande
anticipée (consommation des ménages et investissement des entreprises). On peut
illustrer cela et « l’équilibre de sous emploi » par le schéma suivant :

4
Production
D
T en t1
Septième question : Pouvez-vous m’expliquer ce schéma ?
Joueur 1 : Le graphique du bas illustre la situation du marché des produits. La
demande anticipée va déterminer une quantité de travail nécessaire pour produire telle
quantité. C’est la quantité Dt1.
Cette quantité de travail nécessaire va être demandée sur le marché du travail
représenté sur le graphique au dessus. Mais elle ne correspond pas à l’offre de travail
(la droite noire). L’écart entre les deux droites représente le chômage.
Présentateur :
Huitième question : Oui, et que propose Keynes pour rapprocher ces deux droites,
pour résorber le chômage ?
Quantité de travail
Marché du travail
Demande de travail Offre de travail
Off de travail > Dem de travail
Equilibre de sous-emploi
(chômage)
D
T
en t
1
Offre de travail
Quantité de travail
Quantité de travail
Marché des produits
Salaires
Production
P
1
Demande
effective

5
Joueur 1 : Tout d’abord, Keynes explique que si l’on applique la solution des
classiques, à savoir laisser les salaires fluctuer à la baisse, il va se produire une crise :
la baisse des salaires va provoquer une baisse du pouvoir d’achat qui va entraîner une
baisse de la consommation suivie d’une baisse de la production et donc d’une hausse
du chômage (offre de travail > demande de travail) qui va conduire à encore réduire
les salaires : un cercle vicieux commence, la crise va s’accentuer.
Joueur 2 :
Quant à sa solution, il faudrait entrer dans de longues explications, mais on peut
résumer en disant que le retour au plein emploi nécessite une intervention de l’Etat
pour stimuler la demande (par des hausses de salaires, des politiques de grands travaux
pour stimuler l’investissement et donc la demande en biens de production, ou encore
en jouant sur le taux d’intérêt).
Présentateur :
Neuvième question : Justement, continuons, en quoi dans sa Théorie générale Keynes
s’oppose-t-il à la théorie classique du taux d’intérêt ?
Joueur 1 : Dans la Théorie générale, Keynes essaie de se dégager de la théorie
classique concernant le taux d’intérêt. D’ailleurs, il consacre tout un chapitre à cette
théorie dans lequel il expose les principes classiques afin de mieux en souligner les
erreurs (selon lui bien sûr). Le reproche que fait Keynes aux classiques, à Ricardo par
exemple, c’est d’élaborer une théorie bien trop éloignée de la réalité. Ricardo conçoit
en effet qu’à long terme, il n’y a qu’une seule valeur du taux d’intérêt compatible avec
le plein emploi. Or il existe plusieurs positions d’équilibre de plein-emploi en longue
période du fait des politiques de taux d’intérêt adoptées par l’autorité monétaire, ce
que ne prend pas en compte Ricardo.
Joueur 2 : De plus, selon les classiques, le taux d’intérêt résulte de la confrontation de
l’épargne et de l’investissement. Pour Keynes, le taux d’intérêt dépend d’un plus
grand nombre de facteurs : l’efficacité marginale du capital, la propension
psychologique à épargner, le degré de préférence pour la liquidité (le taux d’intérêt est
en effet, selon Keynes la récompense de la renonciation à la liquidité), la quantité de
monnaie offerte.
Présentateur : Bien, pour résumer, il faut retenir que le taux d’intérêt est finalement la
récompense attribuée au fait de renoncer à la liquidité.
Dixième question : À la lumière de ces différents points, peut-on dire que Keynes
rompt totalement avec le modèle classique ?
Joueur 2 : Dans toute sa Théorie générale, Keynes s’oppose et s’attaque aux
classiques. Cependant, quand on regarde de plus près, on s’aperçoit que Keynes reste
dans une perspective, dans un mode de raisonnement classique puisqu’il utilise la
statique comparative et puisqu’il reprend des définitions et des postulats classiques. Il
semble donc abusif de présenter les « principes de l’économie classique » comme
opposés à « une théorie de la production et de l’emploi dans son ensemble ».
Présentateur :
Onzième question : Dernière question qui vous départagera. La question de
l’opposition entre Keynes et les classiques a nourri l’analyse économique. Pourriez-
vous me donner quelques exemples de théories qui reprennent ces deux analyses ? Je
pense notamment à la question de l’emploi.
 6
6
1
/
6
100%