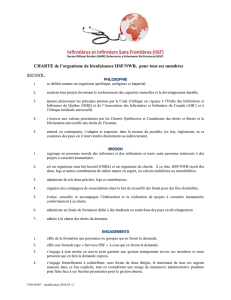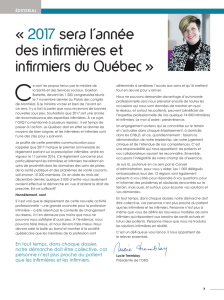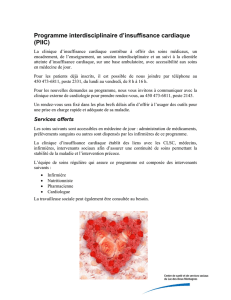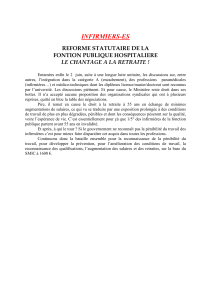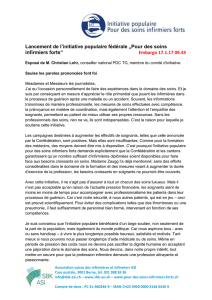rencontre - Banque de données en santé publique

6 l Recherche en soins infirmiers n° 112 - Mars 2013
Copyright © ARSI tous droits réservés
Pour citer l’article :
LECORDIER D, RÉMY-LARGEAU I, JOVIC L. Comment aborder la question de la discipline « sciences inrmières » en France ? Recherche
en soins inrmiers, mars 2013 ; 112 : 6-13
Adresse de correspondance :
Didier Lecordier : didier[email protected]
RENCONTRE
RÉSUMÉ
Les quatre dernières années ont vu se développer des soutiens à la recherche infirmière
et paramédicale française en même temps qu’une « universitarisation » de la formation
dans les Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI). Les paysages professionnel
et scientifique changent et les perspectives qui s’ouvrent laissent entrevoir une
professionnalisation grandissante des activités infirmières mais posent également
la question de la construction des sciences infirmières en France. En abordant
l’interdisciplinarité dans l’approche des situations de soins complexes, en précisant la
finalité de la production des connaissances scientifiques infirmières face aux besoins
de santé de la population, en explicitant l’objet de recherche en sciences infirmières et
les éléments théoriques qui permettent sa construction, l’article qui suit propose une
réflexion épistémologique concernant l’évolution de la profession et la construction
d’une discipline scientifique pour les soins infirmiers en France.
Mots clés : Épistémologie, sciences infirmières, soins infirmiers, discipline scientifique,
professionnalisation, recherche.
Didier LECORDIER
Infirmier, cadre de santé, MII Sociologie, Chercheur associé laboratoire droit et changement social UMR 6297, Membre de Germes
(Groupe d’étude et de recherche maladies et sociétés) MSH Nantes1
Isabelle RÉMY-LARGEAU
Infirmière, cadre de santé, formatrice, doctorante en philosophie (IHPST, UMR 8590 CNRS/P1/ENS)
Ljiljana JOVIC
Infirmière PhD., Directeur des soins - Conseillère technique régionale, Agence Régionale de Santé Ile-de-France, Paris
Comment aborder la question de la discipline
« sciences infirmières » en France ?
How to approach the matter of the discipline of « sciences in nursing » in
France ?
1 Les trois auteurs sont membres du réseau ResIDoc (Réseau des Inrmiers docteur en sciences). En France, de nombreuses inrmières sont
titulaires d’un doctorat en sciences dans diverses disciplines. Cependant, les acquis de ces formations universitaires étant peu réinvestis dans
l’exercice professionnel, la possibilité de faire connaître et de mutualiser ces compétences apparaissait comme une opportunité. Une première
réunion en janvier 2010, à laquelle étaient conviées toutes les inrmières qui s’étaient identiées titulaires d’un doctorat ou doctorantes dans
l’enquête réalisée par l’ARSI (2009), a permis la rencontre de personnes aux parcours individuels divers. Par la suite, le réseau s’est constitué,
progressivement rejoint par de nouveaux membres jusqu’à prendre le nom de ResIDoc en 2011. Ses deux principaux objectifs sont de :
- développer les réexions épistémologiques relatives aux soins inrmiers ;
- développer le réseau de chercheurs en soins inrmiers en mutualisant les compétences acquises lors de formations universitaires de grade doctorat.
Cet article est issu des débats qui ont animé le groupe lors des dernières rencontres. Les réexions d’ordre épistémologique se poursuivent.
ABSTRACT
The last four years have seen the development of supports toward research in nursing
and other healthcare professionals’ research, along with the fact that, nursing education
has become part of university programs. Professional and scientific landscapes are
changing and the opening perspectives let glimpse a growing professionalization of
nurses’ activities but also, raise the question of the nursing science construction in
France. By considering interdisciplinary work, as an approach for complex situations
of care, by specifying the purpose of the production of nursing scientific knowledge
in order to meet the population needs of healthcare, by explaining the purpose of
nursing research and theoretical elements that allow its construction, the following
article offers an epistemological reflection on the evolution of the profession and on
the construction of a nursing scientific discipline in France.
Key words : qEpistemology, sciences in nursing, nursing, scientific discipline, professionalism.

Recherche en soins infirmiers n° 112 - Mars 2013 l
Copyright © ARSI tous droits réservés
-
7
INTRODUCTION
Après plusieurs décennies d’inscription de la recherche dans la
formation initiale des infirmières2, des initiatives individuelles
et associatives, trois sessions de Programme hospitalier de
recherche infirmière (PHRI) devenu Programme hospitalier
de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP), des
équipes soignantes sont en marche pour conduire des
recherches. Dans le même temps, le diplôme infirmier,
reconnu à un grade de licence, inscrit désormais la formation
des infirmières dans le paysage universitaire français. Les
organisations internationales infirmières (SIDIIEF et CII3)
soutiennent un développement de la formation supérieure
à un niveau master et doctorat au sein d’une discipline
spécifique nommée « sciences infirmières »4. Leurs
représentants soulignent l’importance du rôle que peuvent
jouer les infirmières dans le cadre de l’évolution actuelle des
systèmes de santé pour répondre aux besoins de santé des
populations (2011) [1]. Encore très récemment, en l’absence
de filière universitaire spécifique, les infirmières françaises
souhaitant poursuivre des études supérieures de 2ème ou
de 3ème cycle étaient obligées de réaliser leurs études et
recherches dans un autre champ disciplinaire choisi selon
leur sensibilité et leurs projets. Devenues chercheures5, elles
réinvestissaient leurs connaissances et leurs travaux avec
plus ou moins de facilité et de réussite dans la profession.
Aujourd’hui, les pistes offertes aux infirmières pour réaliser
un master spécifique s’ouvrent peu à peu. Les paysages
professionnel et scientifique changent et les perspectives
qui s’ouvrent laissent prévoir une professionnalisation
grandissante des activités infirmières en gardant néanmoins
ouverte la question des modalités de construction des
sciences infirmières en France.
Pour aborder cette question épistémologique, il est utile de
commencer par rappeler que la complexité des situations de
soins rend souhaitable une approche interdisciplinaire qui loin
de nier les différences nécessite au contraire une clarification
du champ disciplinaire des différents intervenants. Il est ensuite
possible de considérer plus particulièrement la manière dont
la discipline sciences infirmières peut se construire en France
grâce au développement d’une recherche spécifiquement
infirmière. Pour cela, il convient de préciser la finalité de
la production des connaissances scientifiques infirmières
face aux besoins de santé de la population, d’expliciter
l’objet de recherche en sciences infirmières et de mettre en
2 Lire partout infirmier-infirmière.
3 SIDIIEF : Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace
francophone.
CII : Conseil international des infirmières.
4 Dans cet article nous garderons le vocable « Sciences infirmières » en
référence à la dénomination de cette discipline universitaire au niveau
international.
5 Lire partout chercheur-chercheure.
évidence la nécessaire mobilisation de concepts, de modèles
théoriques et de méthodes.
LES SITUATIONS DE SOINS SONT
COMPLEXES ET MÉRITENT UNE
APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE6
DANS UN ENVIRONNEMENT
SOCIAL DONNÉ
Poser une perfusion, réaliser un pansement, accueillir un patient
dans une institution, l’accompagner à la fin de sa vie… sont
autant de soins réalisés, durant une journée, par les infirmières
selon les règles de l’art sans qu’il soit besoin, surtout pour
les experts (Benner, 1997) [4], de produire un effort réflexif
et cognitif très important. Les soins infirmiers quotidiens
paraissent, à première vue, des soins techniques et relationnels
qui « vont de soi » dans une organisation précise.
Et pourtant, aucune situation de soins n’est exactement
identique à une autre et aucune n’est aussi simple qu’elle n’y
paraît. Une infirmière mobilise donc toujours, consciemment
ou non, des savoirs multiples qu’elle doit sans cesse adapter
au cas singulier auquel elle est confrontée dans un contexte
donné. Prenons l’exemple de l’arrivée d’une personne aux
urgences, victime d’un œdème aigu du poumon. L’infirmière
d’accueil et d’organisation va évaluer le degré d’urgence
en fonction d’une première observation clinique de la
personne (son état hémodynamique, son état respiratoire,
son état de conscience et, si possible, son état psychique) et
d’un recueil de données concernant notamment le contexte
dans lequel est intervenu le malaise (antécédents, situation
familiale, lieu de vie…). Devant un tableau urgent, elle, ou sa
collègue qui prend le relais dans la salle d’examen, jugera bon
de resserrer la surveillance, placera le patient sous oxygène,
prélèvera des tubes de sang au moment de la mise en place
d’une voie veineuse périphérique. Elle prendra soin d’informer
et de rassurer le patient, l’installera en position demi-assise
pour faciliter sa respiration, informera la famille… Puis, viendra
le temps de l’examen médical, des prescriptions, de l’analyse et
de l’interprétation des examens radiologiques et des résultats
biologiques, de la mise en route d’un traitement améliorant
les fonctions respiratoire et cardiaque… Parallèlement, le
médecin et/ou l’infirmière complèteront les informations
pour identifier la ou les cause(s) de cette complication de
6 La distinction entre « interdisciplinaire », « pluridisiciplinaire » et
« multidisciplinaire » s’appuie dans la suite de l’article sur les définitions
proposées par Gérard Fourez : « Les pratiques dites « interdisciplinaires »
utilisent les résultats des diverses disciplines pour comprendre un phénomène
complexe. Une approche pluridisciplinaire est une approche où chaque
discipline indique comment elle voit la situation étudiée, mais sans qu’on
ait défini un véritable principe intégrateur, ni construit une synthèse Une
approche multidisciplinaire ou par thème consiste dans l’apport de diverses
disciplines à un thème, sans aucune intention d’intégrer les divers apports »
(Fourez, 2009) [3].

8 l Recherche en soins infirmiers n° 112 - Mars 2013
Copyright © ARSI tous droits réservés
l’insuffisance cardiaque notamment en recherchant un
problème infectieux sous-jacent, un écart alimentaire ou une
augmentation non contrôlée de l’activité physique… Une fois la
phase urgente passée, on sollicitera l’avis du cardiologue (qu’il
donnera parfois après avoir réalisé une échographie du cœur).
Enfin, on pourra solliciter l’avis d’« experts paramédicaux »
pour donner des conseils « d’hygiène de vie », préciser un
besoin en éducation thérapeutique…
Dans cet exemple typique et idéal, les points de vue
professionnels sont différents mais concourent aux meilleures
décisions pour soigner : l’infirmière d’urgence assure les
premiers soins (de survie notamment), le manipulateur en
électroradiologie réalise la radiographie selon la meilleure
incidence, le technicien de laboratoire analyse le prélèvement
de sang dans les délais compatibles avec l’urgence, le médecin
réalise la synthèse des informations, pose un diagnostic et
prescrit le traitement. Le cardiologue affine l’analyse de la
fonction cardiaque et les choix thérapeutiques. L’infirmière,
la diététicienne et la psychologue du réseau, dans lequel
sont organisés des programmes d’éducation thérapeutique,
ouvrent des perspectives d’action chacune dans son domaine
à moyen terme, puis le médecin traitant et l’infirmière à
domicile prendront le relais à la sortie de l’hôpital.
Plus on multiplie les points de vue, plus on ajoute des données
liées à la pathologie, au contexte, à l’environnement, à la
personne… et plus la situation de soins apparaît dans sa
complexité que nulle discipline ne peut embrasser dans
sa totalité. Il devient alors indispensable de mobiliser des
professionnels « experts » issus de disciplines différentes dans
un but commun qui consiste à améliorer où à mieux prendre en
compte l’état de santé du patient en fonction de son projet de
vie inscrit dans un environnement social et culturel singulier.
Le développement des maladies chroniques a montré,
par exemple, qu’une approche uniquement biomédicale
est insuffisante pour répondre efficacement aux besoins
de santé de la population. Nombre de patients échappent
au strict respect de la prescription médicale malgré les
efforts d’information, de persuasion, d’injonction voire
d’éducation. L’histoire du sida est à cet égard révélatrice.
Quand les problèmes d’observance du traitement par la
trithérapie, il y a environ vingt ans, risquaient de poser des
problèmes de résistance du virus, d’autres disciplines que la
médecine (psychologie, sociologie, sciences de l’éducation,
anthropologie, économie de la santé, philosophie…) ont été
mobilisées pour compléter et diversifier l’offre de soin dans
le cadre d’une approche systémique.
La pluridisciplinarité gagne ainsi à évoluer en une véritable
interdisciplinarité, l’ensemble des disciplines devenant
capables de conjuguer leurs efforts et de faire la synthèse de
leurs connaissances et analyses pour résoudre conjointement
un même problème.
Dans les situations de soins complexes, tous les acteurs centrés
sur leur domaine de compétence vont concourir, dans l’idéal,
à un même projet de soins dit « personnalisé ». Remarquons
que la personnalisation des soins n’est pas envisagée de la
même façon par chacun en fonction des buts qu’il se fixe,
des connaissances auxquelles il se réfère et des méthodes
qu’il utilise. Les postures et positions plurielles cherchent à
résoudre d’une manière différente les problèmes générés par
une situation de soins particulière pour un patient. Idéalement,
chacun va problématiser la situation à partir de son point de
vue mais jouer sa partition de concert : le médecin centré
prioritairement sur la pathologie et le traitement adapté au
patient qu’il a en face de lui, l’infirmière sur l’expérience de
santé de la personne dans son environnement et la réalisation
des soins (qui sont sous sa responsabilité, avec ou sans une
prescription). Il en sera de même pour tous les acteurs de
santé : le kinésithérapeute centré sur la réduction des déficits
physiques de l’individu, le psychologue centré sur l’état
psychique du sujet, l’orthophoniste sur la rééducation de sa
parole, la diététicienne sur son alimentation, l’ergothérapeute
sur la réadaptation à son travail ou à son milieu de vie…
L’interdisciplinarité n’est donc pas la dilution des disciplines
dans un projet commun. Au contraire, la richesse de
l’interdisciplinarité a pour corollaire la maîtrise, par chacun,
de sa discipline à un haut niveau.
Certes, le découpage des professions et des disciplines est
différent selon les contextes et évolutif selon les époques
mais dans une situation donnée chacun endosse son rôle avec
d’autant plus de facilité qu’il est à l’aise avec sa discipline7 et que
son périmètre d’intervention est inter-professionnellement
négocié, admis et reconnu.
LA DISCIPLINE SE CONSTRUIT
PAR LA PRODUCTION
D E
CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
UTILES À LA POPULATION
L’évolution des besoins de santé publique, la reconfiguration
de notre système de soins, l’évolution de la démographie des
professionnels de santé, le rôle grandissant des associations
de patients, des aidants non professionnels, des malades
experts… brouillent parfois le paysage et interrogent les
identités professionnelles. Dans ce contexte sanitaire,
7 Une discipline peut être définie comme un « domaine d’investigation
marqué d’une perspective unique, c’est-à-dire d’une façon distincte de
regarder des phénomènes. Une discipline professionnelle recommande
des modes d’intervention pour la pratique (sciences infirmières, médecine,
sciences sociales, etc.) alors qu’une discipline théorique décrit ou analyse
des phénomènes à partir de modèles précis (philosophie, sociologie, etc.)
sans intervenir ». (Kerouac et al., 2003) [5]. La profession est la forme
opérationnelle de la discipline qui se traduit par l’organisation des pratiques
sur un territoire. Robert Nadeau (1999) [2] cite Toulmin pour qui « la nature
d’une discipline intellectuelle (ou scientifique) implique toujours à la fois ses
concepts et les humains qui les emploient, à la fois son objet d’étude, son
champ ou son domaine, et les ambitions intellectuelles qui rassemblent ceux
et celles qui œuvrent à l’intérieur de la discipline en question ».

Recherche en soins infirmiers n° 112 - Mars 2013 l
Copyright © ARSI tous droits réservés
-
9
Comment aborder la question de la discipline
« sciences infirmières » en France ?
l’analyse de la production des soins éclaire la position des
professionnels lesquels réalisent leurs prestations d’une part,
en fonction de la demande sociale et, d’autre part, en fonction
des connaissances scientifiques qu’ils possèdent dans leur
domaine de compétence. Ces deux attributs du concept de
profession8 (Freidson, 1984) [6] permettent de distinguer les
soins réalisés par des professionnels de ceux réalisés par les
« aidants » issus de l’entourage du patient.
Tous les professionnels fondent leurs actes sur des
connaissances formalisées. Qu’il s’agisse du calcul de dose
pour préparer un médicament à administrer par voie
injectable ou de l’accompagnement de la quête d’autonomie
d’une personne atteinte d’une maladie chronique, les
infirmières viennent puiser dans les sciences biomédicales
ou les sciences humaines et sociales les connaissances
nécessaires pour soigner. Elles utilisent également des
connaissances produites par les sciences infirmières elles-
mêmes. En les mobilisant dans la pratique, les infirmières
analysent les situations de soins de leur point de vue et
agissent, dans un but précis, selon les règles de leur art.
En d’autres termes, les connaissances et les méthodes
utilisées deviennent centrales pour construire d’une manière
collective et organisée la réponse spécifique à la demande
sociale en matière de santé. Les caractéristiques d’une
discipline, souligne Gérard Fourez (2009) [3], sont « son
objectif, et ses finalités sociales… ».
Un premier niveau de questions fondamentales se pose
alors conjointement aux chercheures et aux praticiennes :
est-ce que l’assemblage des connaissances scientifiques
qui structurent les soins infirmiers est efficace et atteint sa
cible ? Permet-il de modifier, le cas échéant, les pratiques
grâce à ces connaissances renouvelées et d’améliorer l’état
de santé de la population ?
Un deuxième niveau de questions aussi fondamentales reste à
traiter : comment construire et faire évoluer cet assemblage ?
En d’autres termes, comment structurer la recherche, diffuser
et enseigner les connaissances scientifiques ? Comment à
la fois développer la recherche fondamentale sur les soins
infirmiers et produire des résultats opérationnels pour les
mobiliser dans la pratique ?
8 Nous pouvons synthétiser les cinq attributs qui caractérisent une profession
d’après E. Freidson :
- Répondre à une demande sociale ;
- Avoir une activité spécifique, reconnue et autonome ;
- Situer et défendre son périmètre d’intervention par rapport à d’autres
professions ;
- Assurer son contrôle interne de façon autonome ;
- Construire sa formation de façon autonome et organiser la formation de la
profession jusqu’au plus haut niveau universitaire (doctorat). Construire un
savoir spécifique (développer des connaissances nouvelles sur un segment
spécifique).
La production des chercheures en sciences infirmières dans le
monde lève le doute sur la capacité de la discipline à produire
et à organiser des connaissances scientifiques à un niveau
international. Les évolutions récentes en France laissent
espérer une participation accrue des infirmières françaises au
développement de ces connaissances et l’affirmation d’une
volonté de mieux les utiliser afin d’améliorer les pratiques
professionnelles et de légitimer une expertise spécifique
dans certaines situations de soins. Il convient donc, dans un
mouvement dialectique, de se centrer sur la discipline pour
faire évoluer la profession mais également se recentrer sur
l’exercice professionnel pour mieux construire la discipline. Il
semble en effet que les infirmières françaises se heurtent encore
souvent à un problème de positionnement voire d’identité.
Certes, cela n’est pas nouveau mais ce questionnement
semble ressurgir avec force chaque fois que s’ébauche un
projet de recherche (Jeanguiot, 2009) [7] : s’agit-il vraiment
d’une recherche infirmière ou bien d’une recherche médicale ?
d’une recherche en sciences infirmières ou d’une recherche
en sciences humaines (sociologie, psychologie, ou sciences de
l’éducation…) réalisée par une infirmière ? d’une recherche en
soins infirmiers ou d’une recherche sur les soins infirmiers ?...
Pour répondre à ces interrogations et dissiper les doutes,
une piste féconde semble être de chercher, avant tout, à
clarifier l’objet de recherche des infirmières confrontées à
des situations de soins qui posent problème.
LA DISCIPLINE SE CONSTRUIT
SUR UN OBJET SCIENTIFIQUE
ENRACINÉ DANS DES QUESTIONS
PROFESSIONNELLES
Pour Marie-Fabienne Fortin (2010) [8], c’est la pratique qui
est à l’origine de l’objet de recherche. En effet, pour cette
infirmière, spécialiste des méthodes scientifiques appliquées
aux sciences infirmières, définir l’objet de recherche consiste
à établir un pont entre trois champs : la discipline comme
champ des savoirs, la théorie ou les concepts comme champ
d’organisation des connaissances et la pratique professionnelle
comme champ d’application des savoirs.
Or, si l’on considère que l’objet de recherche est le résultat
d’un questionnement scientifique rigoureux qui s’inscrit dans
une discipline et participe à l’évolution d’une profession, il en
résulte les interrogations suivantes :
Les « irritations »9 (Fortin, 2010) [8] vécues dans des
situations de soins et qui semblent mériter d’être explorées
font-elles partie du périmètre des soins infirmiers ? Quelles
sont les connaissances actuelles sur les questions posées
et en particulier les connaissances en sciences infirmières ?
9 Marie-Fabienne Fortin parle d’irritation pour souligner la posture curieuse
et attentionnée du chercheur quand les questions surgissent.

10 l Recherche en soins infirmiers n° 112 - Mars 2013
Copyright © ARSI tous droits réservés
Quels sont les fondements théoriques et conceptuels qui
permettent de dire que ce point de vue scientifique est fécond
et particulier aux infirmières ?
Ces questions soulignent une interaction forte entre une
discipline scientifique dont les savoirs sont internationalement
reconnus et la profession dont l’exercice mobilise les
connaissances produites par la discipline mais qui est défini
réglementairement au niveau national. Ainsi, pour répondre à
la première question, il n’est pas inutile, comme le proposent
Michel Poisson et Ljiljana Jovic [9], de commencer par préciser
le périmètre de l’objet des soins infirmiers à l’aide du cadre
réglementaire :
« Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs,
intègrent qualité technique et qualité des relations avec le
malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l’évolution
des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans
le respect des droits de la personne, dans un souci
de son éducation à la santé et en tenant compte de la
personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique,
psychologique, économique, sociale et culturelle :
1) de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé
physique et mentale des personnes ou l’autonomie de
leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de
favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion
dans leur cadre de vie familiale ou sociale ;
2) de concourir à la mise en place de méthodes et au recueil
des informations utiles aux autres professionnels, et
notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et
évaluer l’effet de leurs prescriptions ;
3) de participer à l’évaluation du degré de dépendance des
personnes ;
4) de contribuer à la mise en œuvre des traitements en
participant à la surveillance clinique et à l’application
des prescriptions médicales contenues, le cas échéant,
dans les protocoles établis à l’initiative des médecins
prescripteurs ;
5) de participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement
de la douleur et de la détresse physique et psychique des
personnes, particulièrement en fin de vie au moyen de
soins palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin,
leur entourage. » [10]
A l’intérieur de ce cadre réglementaire étroitement lié à
la pratique, doit pouvoir se développer sans ambiguïté la
recherche en soins infirmiers avec un recentrage que l’on
peut souhaiter plus affirmé sur la clinique et qui se justifie par
la volonté de mobiliser des connaissances scientifiquement
établies dans l’exercice professionnel.
La réponse à la deuxième question nécessite de maîtriser les
techniques de recherche bibliographique qui, rappelons-le,
ne sont pas réservées aux chercheures mais qui devraient
pouvoir être mises en œuvre par de nombreux professionnels.
Il n’est pas besoin de conduire une recherche à chaque fois
que se pose une question de soins. Bien des réponses se
trouvent déjà dans la littérature des sciences infirmières.
Encore faut-il que les professionnels aient conscience
d’appartenir à une profession qui se consolide sur des bases
scientifiques infirmières et qu’ils apprennent à chercher, à
lire, critiquer et utiliser les articles scientifiques publiés. Le
nouveau référentiel de formation s’inscrit d’une manière
plus formelle dans un cursus universitaire et les exigences en
matière de recherche s’en trouvent sans doute plus affirmées.
Gageons que la nouvelle génération participera davantage
que dans le passé à cette dynamique scientifique et qu’elle
sera capable de s’approprier les résultats de recherche pour
modifier ses pratiques professionnelles. Le contexte français
pourrait être favorisé avec d’une part, le développement
des Evaluations des pratiques professionnelles (EPP) et
de l’Evidence based nursing (EBN) dans les institutions et,
d’autre part, la mise en œuvre du Développement personnel
continu (DPC) pour tous les professionnels de santé. Le
« capital » de connaissances scientifiques des sciences
infirmières est déjà bien réel et accessible dans les bases de
données ad hoc : BDSP (Banque de Données Santé Publique),
C.I.N.A.H.L (Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Litterature), RefDoc, service de INIST-CNRS (INstitut de
l’Information Scientifique et Technique du CNRS), MEDLINE
version PubMed etc.
Enfin, la troisième question est sans doute la plus difficile à
traiter, la plus exigeante mais également la plus féconde pour
avancer dans la réflexion sur la construction de la discipline
infirmière. Si l’on considère que l’objet de recherche est
une nouvelle manière de considérer une situation de soins
(conduisant souvent à rompre avec ses présupposés) et qui
se construit en articulant les trois éléments suivants : d’une
part, les soins réalisés auprès des personnes, d’autre part les
connaissances des sciences infirmières, et enfin les concepts,
modèles théoriques, théories et méthodes, alors il convient
maintenant d’approfondir ce dernier point.
LA PRODUCTION DE CONNAISSANCES
EN SCIENCES INFIRMIÈRES
PASSE PAR LA MOBILISATION ET
L’ÉLABORATION DE CONCEPTS,
DE MODÈLES ET DE MÉTHODES
Pour illustrer la manière dont peuvent être produites
des connaissances en sciences infirmières, prenons un
exemple : celui de l’éducation thérapeutique qui a gagné
ses lettres de noblesse dans la loi relative à l’Hôpital, aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST, 2009) et dans
laquelle de nombreux professionnels s’engagent désormais.
De multiples initiatives voient le jour et s’accompagnent
de formations, s’enrichissent de débats lors de congrès…
Dans tous ces projets, différents professionnels (médecins,
pharmaciens, infirmières, diététiciennes, psychologues…)
agissent, prennent leurs marques, revendiquent une place en
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%