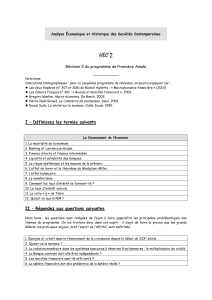chapitre_III - Laboratoire d`Ingénierie Financière et Économique

1
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Département d’économie
Economie monétaire et financière
2015 – 2016
Babacar Sène
Professeur Agrégé des universités
Polycopie de cours

2
Chapitre III : La demande de monnaie
Pour les classiques, la monnaie n’est jamais désirée pour elle-même, elle ne sert qu’à l’échange
et n’a aucune influence sur les variables réelles de l’économie. La demande de monnaie de
l’école de Cambridge que nous présentons dans un premier temps ne contredit pas ces résultats.
En revanche, Keynes remet en cause l’ensemble de l’analyse classique concernant la monnaie.
Il rejette en effet la dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire, et considère que
les motifs de détention de la monnaie ne se limitent pas à la seule réalisation des échanges. Au
contraire, la monnaie peut être désirée pour elle-même. Les motifs keynésiens de la détention
de la monnaie sont multiples : les individus peuvent détenir de la monnaie pour les motifs de :
transaction, précaution et spéculation. Cette approche développée par Keynes, amène à
reconsidérer la demande de monnaie dans une optique portefeuille, d’où la dimension des actifs
financiers qui va être prise en compte. Ce chapitre va aussi introduire les mécanismes de l’offre
de monnaie à travers le processus de création monétaire par une ou plusieurs banques, et par la
banque centrale. Par ailleurs ce débat permet de faire la distinction entre multiplicateur du
crédit et diviseur du crédit.
Section 1 - La théorie quantitative de la monnaie
Développée par les économistes classiques durant le XIXième siècle au début du XXième
siècle, la théorie quantitative de la monnaie décrit la détermination de la valeur nominale du
revenu global. Elle est également une théorie de demande de monnaie : elle explique la quantité
de monnaie détenue pour un niveau donné de revenu global. L’essentiel de cette théorie réside
dans l’absence d’effets des taux d’intérêt sur la demande de monnaie
La vitesse de circulation de la monnaie
Dans son ouvrage de référence Le pouvoir d’achat de la monnaie ( The purchasing Power of
Money, 1911) , l’économiste américain Irving Fisher fournit l’exposé le plus complet de la
version classique de la théorie quantitative.
Le modèle de Fisher
Ce modèle permet de faire un lien entre la quantité totale de monnaie offerte et le montant
des dépenses en biens et services :

3
- M : La quantité totale de monnaie offerte
- P x Y : représente le PIB nominal ou revenu global ou dépenses totales
- M et PxY sont reliés par la vitesse de circulation de la monnaie
Définition de la vitesse de circulation de la monnaie
C’est le coefficient de rotation de la monnaie, qui représente le nombre de fois où, au cours de
la période considérée, une unité de monnaie est dépensée lors de l’achat de biens et services
produits l’économie. La vitesse de circulation est équivalente à la vitesse-revenu :
Exemple : Pour un PIB nominal ( PxY ) annuel de 6000 Milliards de FCFA et une quantité de
monnaie de 1200 milliards de FCFA, la vitesse de circulation est de 5, cela signifie qu’une
pièce de 5 FCFA est en moyenne dépensée 1 fois pour l’achat de biens et services. En
multipliant les deux membres par M :
Reformulation de l’équation quantitative de la monnaie
L’équation de la demande de monnaie classique a été reformulée par Marshall et Pigou ( Ecole
de Cambridge ) qui définissent une demande de monnaie macroéconomique proportionnelle au
revenu qui peut s’écrire comme suit :
M = kPY
On peut noter que cette formulation est compatible avec l’équation quantitative de monnaie.
La demande de monnaie est ici proportionnelle au niveau général des prix, c’est une demande
d’encaisses réelles.
Cette formulation de la demande de monnaie permet à Pigou d’expliquer la variation du
niveau général des prix par le comportement des agents lorsque leurs encaisses ne sont pas au
niveau désiré, c’est l’effet d’encaisses réelles. Les agents lorsqu’ils ont le sentiment de détenir
trop de monnaie augmentent leur demande de biens sur tous les marchés, il en résulte une
MYP
V
YPVM

4
augmentation du niveau général des prix qui ramène la valeur de leurs encaisses réelles à celle
qu’ils souhaitaient.
Section 2 La théorie Keynésienne de la préférence pour la liquidité
Dans la théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936) , Keynes renonce à
l’approche classique où la vitesse de circulation est supposée constante pour développer une
théorie de la demande de monnaie centrée sur l’importance du taux d’intérêt. Keynes pose la
question suivante :
Pourquoi les agents détiennent ils de la monnaie ? Pour Keynes trois raisons majeures poussent
les agents à détenir de la monnaie :
Motif de transaction
Motif de précaution
Motif de spéculation
Le motif de transaction
Keynes suppose que cette composante de la demande de monnaie est principalement déterminée
par le volume des transactions effectuées par les agents économiques et que celles-ci sont
proportionnelles au revenu. La demande de monnaie pour motif de transaction est donc
proportionnelle au revenu.
Le motif de précaution
Keynes va au-delà de l’analyse classique. Les agents économiques détiennent de la monnaie
non seulement pour effectuer des transactions mais aussi pour faire face à des besoins
inattendus. D’après Keynes le montant des encaisses monétaires de précaution détenues par les
agents est déterminé principalement par le montant anticipé des transactions supposé
proportionnel au revenu. C’est pourquoi Keynes suppose que les encaisses monétaires de
précaution sont proportionnelles au revenu.
Le motif de spéculation
Si Keynes s’était limité aux motifs de transaction et de précaution, le revenu serait demeuré le
seul déterminant important de la monnaie. Cela n’aurait guère modifié la théorie quantitative
de la monnaie. Il ajoute un motif supplémentaire appelé motif de spéculation. La monnaie est

5
une réserve de richesse. La richesse étant étroitement reliée au revenu. Mais il regarde plus
attentivement les facteurs qui affectent la quantité de monnaie détenue comme réserve de
valeur. Cela le conduit à souligner l’influence du taux d’intérêt sur la demande d’encaisses de
spéculation.
La prise en compte simultanée des trois motifs
Keynes regroupe les trois motifs de détention de la monnaie en une équation unique de
demande de monnaie qui est liée au revenu et au taux d’intérêt. L’équation de demande de
monnaie proposée par Keynes connue sous le nom de fonction de préférence pour la liquidité
relie la demande d’encaisses réelles Md/P à i et Y :
Md/P = f( i,Y )
- +
Demande de monnaie pour motif de spéculation ( Une hausse du
taux d’intérêt entraîne une baisse de la demande de monnaie et une
hausse de la demande de titre )
0
Y
P
Md
Demande de monnaie pour motif de transaction et de précaution ( Une
hausse du revenu entraîne une hausse de la demande de monnaie pour ces deux motifs ).
Section 3 - Les prolongements de l’approche Keynésienne
Le modèle d’encaisses de transaction : modèle de Baumol-Tobin
Le modèle suivant s’inspire des travaux de Baumol ( 1952) et Tobin ( 1956 ) est qualifiée
d’approche en termes de gestion de stock, car il s’agit déterminer le stock optimal de
monnaie.
Les agents économiques reçoivent leur revenu à une date qui ne correspond pas à celle de
toutes leurs dépenses.
0
i
P
Md
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%