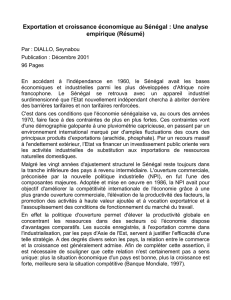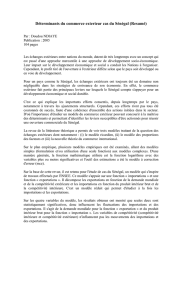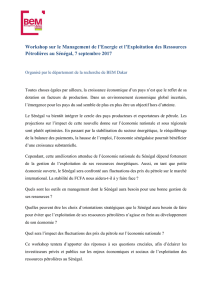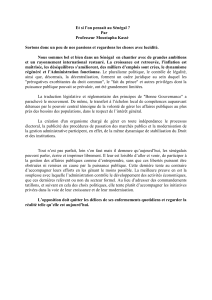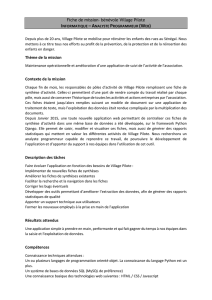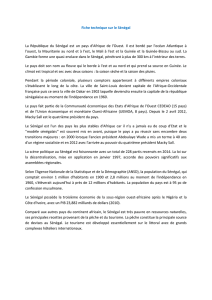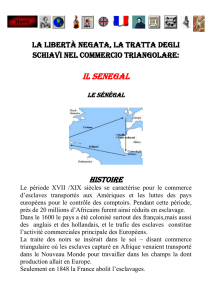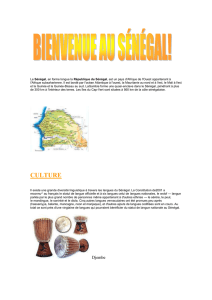INTRODUCTION : Le modèle d`organisation socio

1
LES CONTRAINTES EXTERIEURES DU SENEGAL
Par Professeur Moustapha Kassé
INTRODUCTION :
Au lendemain de son indépendance, l’économie sénégalaise bénéficiait en guise d’héritage de
l’AOF (Afrique Occidentale Française), d’infrastructures relativement modernes et d’un
certain niveau d’industrialisation capables de lui assurer un bon décollage économique par
rapport aux autres colonies africaines et asiatiques. Mais malheureusement ces avantages
n’ont pas été bien exploités par le sénégal. En effet, l’économie sénégalaise s’est
essentiellement tournée vers une agriculture coloniale de traite au détriment de la production
céréalière locale engendrant ainsi une explosion des importations de produits alimentaires.
Au niveau industriel, il faut noter que même si le Sénégal disposait d’un certain avantage dans
ce domaine, l’industrie était essentiellement alimentaire, peu dynamique et tournée vers le
marché intérieur. Elle était totalement contrôlée par l’état et son niveau de développement
embryonnaire nécessitait des importations de biens manufacturés en provenance des pays
développés.
En 1978, l’économie sénégalaise est entrée dans une crise profonde avec l’apparition de
nombreux déséquilibres principalement au niveau du cadre macroéconomique. La
conséquence sur le tableau d’ensemble de l’économie reflète des tendances de déséquilibre
structurel :
- le PIB moyen en termes réels est de 2,1% inférieur au croît démographique (2,7%);
- le taux de consommation finale est très élevé dépassant 100% ;
- le taux d’investissement relativement faible tourne autour de 15% ;
- le déficit budgétaire est très important et représente près de 12% du PIB, avec une masse
salariale absorbant plus de 50% des recettes courantes ;
- la dette extérieure représente 32% des exportations en 1979/80 ;
- le déficit commercial est devenu insupportable (125 milliards en 1981);
- l’inflation est élevée en raison du choc pétrolier et des politiques expansionnistes du crédit.
Le niveau élevé des importations en produits alimentaires et manufacturés a inévitablement
été à l’origine du déficit commercial du pays et du solde négatif de sa balance des paiements
dès lors que les flux de capitaux ne suivaient pas. Pour remédier à ces déficits prolongés et
chroniques, l’Etat a dû recourir à l’endettement public extérieur. Le poids de la dette
extérieure du pays s’amplifiera non seulement sous l’effet des difficultés budgétaires de
l’Etat, mais aussi à cause de la facilité avec laquelle les pays pouvaient s’endetter grâce à la
disponibilité des pétrodollars provenant des chocs pétroliers des années 1970. Et l’usage peu
efficient de ces capitaux finira de plonger le pays dans une crise sévère de la dette (son service
était passé de 11 milliards à 43,8 milliards de francs CFA) qui a nécessité plusieurs mesures
de politiques économiques connues sous le nom de politiques d’ajustement structurel.

2
Pour juguler ces déséquilibres macro-économiques, le Sénégal s’est engagé depuis 1979 dans
un processus d’ajustement ordonné de son économie. Ce choix dépendait de la mise en oeuvre
de programmes économiques et financiers pour les périodes 1979-1991 et (1994-2000) avec
les institutions de Bretton-Woods. Les objectifs fondamentaux assignés à ces programmes
étaient le rétablissement des grands équilibres, la maîtrise de l’inflation et la réalisation d’une
croissance économique saine et durable.
Aujourd’hui la globalisation des échanges qui s’est approfondie dicte les règles de conduite à
suivre par les nations. On ne choisit pas la mondialisation, on s’y conforme. Les nations qui
s’y refusent (Corée du Nord, Cuba…) sont systématiquement mises en ermite avec des
conséquences que l’on sait pour les populations. Le Sénégal dont l’option est de poursuivre sa
quête du développement dans un environnement mondialisé, doit irrémédiablement se mettre
dans le moule des nations émergentes : transformations structurelles de son économie et
surtout mise en œuvre de politique adéquates tenant fortement compte des comportements
stratégiques du reste du monde. Il ne s’agit plus de déterminer ses actions en fonction
d’optimum simple, mais en fonction des contraintes imposées par la mondialisation. Dans ces
conditions quelles types de d’actions publiques à mener pour un Sénégal gagnant dans la
mondialisation ? La résolution d’un tel problème semble s’apparenter à un exercice de
comparaison de la batterie de politiques économiques recommandées dans les théories
économique du développement. Ce faisant nous nous orienterions vers un débat dont la
pertinence était notoire dans les années 1950-1960, mais que la mondialisation a rendu caduc,
du fait que le champs de la compétition n’a de limites que celles de la terre. Le reste du texte
s’articulera comme suit : mode d’organisation socio-économique au Sénégal dans une
première partie, ensuite nous nous attarderons sur les contraintes et ajustements à l’économie
mondiale, la troisième partie montrera comment le Sénégal a tenté de construire une
économie tirée par les exportations sans succès, la balance des paiements nous servira de
loupe pour mieux apprécier les relations économiques du Sénégal avec le reste du monde dans
la quatrième partie, enfin il sera question des perspectives pour une meilleure participation à
l’économie et les instruments nécessaires pour les saisir seront traités dans la cinquième et
sixième partie.
I- Le modèle d’organisation socio-économique de
l'économie sénégalaise.
1°) Economie sénégalaise : caractéristiques et évolution
On ne peut rien comprendre à l’évolution de l’économie sénégalaise si on ne la replace
dans son contexte historique. L’étude de l’économie politique de l’agriculture coloniale
organisée autour de la monoculture arachidière avait débouché sur une tendance lourde : la
modification des structures paysannes et l’introduction des petites technologies n’ont pas été
accompagnées par une amélioration des rendements agricoles et une augmentation de la
productivité. Le mode de valorisation a progressivement inséré le secteur indigène à
l’économie mondiale (échanges) sans être réellement intégré à son schéma de production aux
normes réputées productivistes.
Par ailleurs l’impérieuse nécessité d’approvisionner les industries de la métropole en
matières premières d’origine agricole d’une part et la recherche de débouchés extérieurs en
vue d’écouler sur des marchés captifs, les excédents de produits manufacturés métropolitains
d’autre part, ont inéluctablement conduit à l’abandon progressif des cultures vivrières,

3
principalement au profit des cultures de rente. Corrélativement, la production céréalière, jadis
abondante, va être progressivement supplantée par des importations de biens alimentaires.
Ainsi s’amorce et s’approfondit la double extraversion structurelle qui caractérise l’économie
sénégalaise contemporaine : extraversion du système productif orienté essentiellement
orienté vers la satisfaction prioritaire de la demande extérieure et celle de la structure de
consommation marquée par des importations massives de produits alimentaires et de biens
manufacturés non localement fabriqués.
Le consensus général qui s’est formé pour dater le déclenchement de la crise
économique et financière s’appuie sur des indicateurs macroéconomiques mais qui sont
insuffisants pour traduire le constat des déséquilibres quasi permanents et l’impuissance des
différentes réformes entreprises par les Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) sur une
période de trois décennies. Ces déséquilibres s’inscrivent dans des tendances lourdes
historiques caractéristiques du modèle traditionnel de fonctionnement de l'économie. En
d’autres termes, les racines des difficultés actuelles de l’économie sont donc à rechercher plus
loin, au-delà des chiffres de conjoncture, au sein même du système d’organisation socio-
économique.
De quelque côté que l’on mène l’analyse, il apparaît que le modèle de base de
l'économie sénégalaise peut être identifié par quatre traits caractéristiques qui établissent la
prééminence des variables liées à l’extérieur :
une forte sensibilité de la croissance du PIB aux variations de la production
et de l'exportation des produits du secteur primaire;
une répartition inégale du revenu national, au profit surtout des
consommateurs urbains ;
un emploi insuffisamment productif du PIB et des apports extérieurs ;
une vulnérabilité croissante de l'économie à l'égard des variables exogènes
(climat, cours mondiaux, taux d'intérêt, etc.), résultat pour partie des trois
caractéristiques précédentes.
2°) Bilan des politiques d’ajustement structurel
Le Sénégal, après plus de deux décennies d’ajustement et de stabilisation, apparaît
comme un laboratoire en la matière. Pour juguler ces déséquilibres macro-économiques, le
Sénégal s’est engagé depuis 1979 dans un processus d’ajustement ordonné de son économie.
Ce choix dépendait de la mise en oeuvre de programmes économiques et financiers pour les
périodes 1979-1991 et (1994-2000) avec les institutions de Breton Woods. Les objectifs
fondamentaux assignés à ces programmes étaient le rétablissement des grands équilibres, la
maîtrise de l’inflation et la réalisation d’une croissance économique saine et durable.
Dès lors il est important de passer en revue la portée de ces politiques. Les objectifs de
ces plans d’ajustement et de stabilisation ont été bâtis autour de grands programmes :
a- La phase de stabilisation (1979-84)
Elle est caractérisée par le programme de stabilisation à court terme sur la période (1979-
80) considéré comme un plan d’urgence de stabilisation de la détérioration des agrégats
macro-économiques. Ce programme est suivi d’un plan de redressement économique et
financier (1980-1984) avec comme objectifs précis :l’équilibre des finances publiques, des
échanges extérieurs et des marchés de l’emploi ainsi que la maîtrise de l’inflation dans le
cadre de la maîtrise de la demande globale.

4
Les résultats furent mitigés car la croissance moyenne par an du PIB s’est établie à
1,6%, en deçà de la croissance démographique estimée à 2,7%, en raison notamment d’une
évolution fortement marquée par le comportement erratique des conditions climatiques.
b- Le programme d’ajustement à moyen et long terme (1985-1991)
Le document-cadre de politique économique et financière soumis au Groupe
consultatif pour le Sénégal en décembre 1986 marque une rupture dans l’approche de
l’ajustement. En effet, le programme d’ajustement à moyen et long terme 1985-91, appelé à
maintenir les acquis obtenus dans la réduction de la demande, a été centré sur la promotion
des exportations et la mise en oeuvre des politiques sectorielles. C’est à ce titre qu‘ont été
adoptées les Nouvelles Politiques Industrielles (NPI) en juillet 1986, le désengagement de
l’Etat dans les activités marchandes en 1987 ainsi qu’une nouvelle approche en matière
d’investissements. Aussi le système des incitations industrielles a été révisé afin de rendre le
secteur plus compétitif sur les marchés intérieurs et extérieurs.
Les résultats : L’activité économique en termes réels a cru de 2,9% en moyenne entre
1985 et 1991 soit un taux légèrement supérieur au croît démographique. Le solde budgétaire
est passé d’un déficit de 5,7% en 1985/86 à 1,1% en 1990/91 avec un poids réduit de la masse
salariale de la Fonction publique qui représente 41% des recettes courantes. Les arriérés de
l’Etat sont passés de 45 milliards en 1985/86 à 10 milliards au 30 juin 1991. Le solde courant
extérieur ne représente que 3,6% du PIB en 1991. Les avoirs extérieurs se sont améliorés
nettement de 43,8 milliards entre décembre 1985 et décembre 1991. Il en est de même pour la
position nette du gouvernement qui s’est améliorée de (20,8 milliards sur la période) limitant
l’effet d’éviction que l'Etat suscitait en recourant massivement au système bancaire.
En dépit du programme d’ajustement à moyen et long terme (PAMLT), le Sénégal
demeurait confronté à des problèmes d’ordre structurel. Non seulement la structure des
finances publiques révélait une précarité dans les améliorations, mais la balance commerciale
se caractérisait toujours par une rigidité des importations et des exportations.
Globalement, les résultats n’ont pas pu restaurer la capacité financière de l’Etat. Par
ailleurs, le taux de change effectif réel s’est substantiellement apprécié, entravant
sérieusement la compétitivité de l’économie. La conséquence de tous ces facteurs qu’on
retrouvait dans la plupart des pays de l’UMOA sera la dévaluation du F CFA de 50% en 1994.
c- le programme post-dévaluation (1994-2000)
Il s’inscrit dans la logique de l’approfondissement de l’ajustement. Mais il bénéficie
de la dévaluation du franc CFA de 50%. Avec le changement de parité du franc CFA
intervenu le 12 janvier 1994, le Gouvernement du Sénégal s’est engagé dans la voie de
l’ajustement global avec comme principal objectif l’amélioration de la compétitivité de
l’économie dans le cadre d’une croissance économique durable.
La nouvelle stratégie est basée sur la mise en oeuvre d’une série de programmes
d’ajustement et de réformes économiques en vue de rétablir les conditions d’une croissance
durable et d’assurer la viabilité extérieure et intérieure, notamment par la mise en oeuvre de
réformes de libéralisation de l’économie, de réduction de la taille du secteur public, de
promotion du secteur privé et de maîtrise de l’inflation.
Pour ce faire, le Gouvernement a mis en œuvre depuis 1994, un programme
d’ajustement macro-économique et de réformes structurelles. Ce programme a été appuyé par
le Fonds Monétaire International (FMI) dans le cadre d’un arrangement de trois ans (1994-
1997) au titre de la facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR) qui a été approuvé le 29
août 1994. Le troisième et dernier accord annuel au titre de cet arrangement a été approuvé le
13 janvier 1997 et a expiré le 12 janvier 1998.

5
Un second arrangement de Facilité d’Ajustement Structurel Renforcée (FASR) d’une
durée également de trois ans (1998 — 2000) a ensuite été approuvé. Depuis décembre 1999,
le document cadre est remplacé par un «Document de Stratégie de réduction de la Pauvreté et
de Croissance».
II- Les contraintes extérieures et l’ajustement à
l’économie mondiale.
1°) Caractérisation de la mondialisation inéluctable
D’après BOYER (1997) la mondialisation "économique" se caractérise par un accroissement
des mouvements d’échanges marchands mais aussi des investissements productifs : la
globalisation de la production, la mondialisation financière et la perte d’autonomie des Etats-
nations. La mondialisation revêt aussi une dimension politique et institutionnelle. Cet aspect
intègre le rôle très actif des grandes institutions de la "gouvernance mondiale" (OMC, FMI,
BM... et G7) mais aussi les décisions politiques majeures du gouvernement des USA. A ce
titre se raccrochent les nouvelles politiques issues de la fin de l’affrontement Ouest/Est depuis
la chute du mur de Berlin, allant de "tempête du Désert" (guerre de Bush père) à la guerre
totale et préventive (de Bush junior).
La mondialisation présente un caractère de contrastes et de paradoxes. Les statistiques des
Organisations internationales montrent que jamais le monde n’a disposé d’autant de
techniques et n’a produit autant de richesses, pourtant, jamais elle n’a produit autant
d’inégalités et de pauvreté révélant ainsi la marque d’une humanité socialement duale.
A défaut d’un consensus sur la définition, les pratiques et les tendances de l’économie
mondiale, dans sa double sphère réelle et monétaire, laissent apparaître une triple
interdépendance que l’on pourrait qualifier de mondialisation. Essayons de cerner de plus prés
ces interdépendances pour bien en mesurer toutes les conséquences à la fois sur les économies
et sur les différents acteurs:
- L’interdépendance par la production se caractérise par une décomposition internationale
des processus productifs qui s’appuie sur un réseau de filiales ou de sous- traitants et le
nomadisme de segments entiers des appareils de production selon la logique des
avantages comparatifs ;
- L’interdépendance par les marchés qui se traduit par la disparition des frontières
géographiques, l’abaissement des barrières tarifaires et non tarifaires qui accélère alors
les échanges commerciaux ;
- L’interdépendance financière qui procède d’une interconnexion des places financières
mondiales fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre grâce à la conjugaison de
trois éléments que sont la déréglementation, le décloisonnement des marchés et la
désintermédiation ;
- L’interdépendance par les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) qui, avec les transports, intensifient la mobilité et la flexibilité
des capitaux, des biens, des services et des personnes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
1
/
39
100%