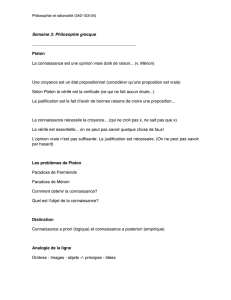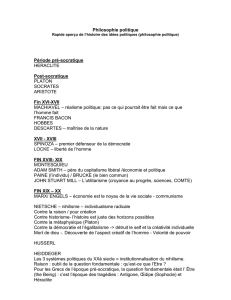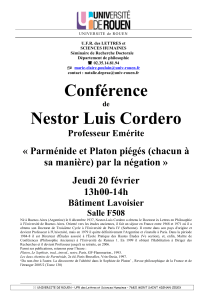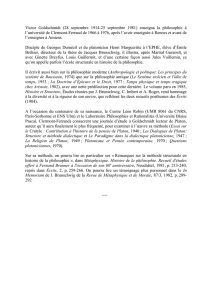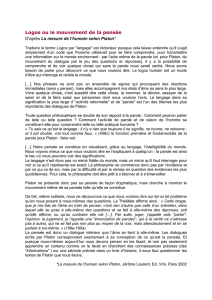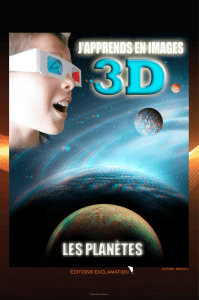Copie de Lettre X-philo n°2 VDef 2

1
LA LETTRE
X
XX
X
-PHILO
N°2 Décembre 2011
Le sommaire L’Edito
L’être ou le paraître : une question
de prestige p. 2
Par E. Osier
René Girard : un pionnier de
génie, un chantier à poursuivre p. 5
Par J.-P. Castel
Platon ou le totalitarisme p. 8
Par M. Muller
La métaphysique ou les préférences
du cœur p. 18
Par P. Mirault
S’il y a un début à tout, y a-t-il forcément une suite à ce
début ? Avec le numéro deux de la lettre X-philo, c’est le
cas. C’est même l’occasion de confirmer notre choix
éditorial : articles d’expression au format court (2-3
pages) ou articles plus long (6-8 pages) à vocation
pédagogique. En espérant que nous en gardions
définitivement le pli, comme le voudrez toutes les
bonnes repasseuses…
Trois des articles du présent numéro sont des
questionnements appelant à porter un autre regard sur
des sujets dits classiques.
Les lecteurs souhaitant satisfaire, plus avant, leur
curiosité ou réagir aux thèses développées, peuvent
envoyer petits mots ou grands avis à l’adresse suivante :
[email protected]. Ils y sont d’ailleurs
cordialement invités par leurs auteurs, qui n’oublient pas
que la philosophie est discipline de controverse et de
débat, née il y a bien longtemps, sous le ciel grec, d’un
esprit de contradiction et d’une esthétique de pensée…
Bonne lecture !
J.-P. Bessis (X 80)

2
L’être ou le paraître :
une question de prestige
Le philosophe le plus impertinent n’est
jamais celui que l’on croit : Socrate était
plus facétieux que ne nous l’ont fait
imaginer les traditions stoïcienne (les
Stoïciens grecs aimaient être nommés « les
Socratiques »), chrétienne (Socrate
chrétien de Guez de Balzac, 1652) ou
encore le thème pictural de sa mort
(David), figeant le personnage dans un
rationalisme monolithique. Revenons aux
taons, torpilles et autres quolibets auto-
proclamés par le « père de la morale »
(Schopenhauer, 1839), autrement dit à sa
mise en scène par Platon, pour saisir ce
personnage piquant d’esprit et électrisant
de séduction. Tous les chemins d’une
réflexion sur l’être et le paraître, mènent,
ou plutôt ramènent à Socrate. Or, dans les
Dialogues de Platon, s’agit-il de la mise en
scène d’un être seulement dévoué à la
philosophie comme à une puissance
tutélaire qui ne jure que par ce qu’il
convient de faire, ce qui paraît bon, juste,
et beau, et affectant l’ironie ? ou bien de la
mise en scène d’un être voué à être
précisément ce qu’il est, devenu ou en
devenir, sans jamais se départir de l’ironie
qui le garde de toute infatuation ? On n’en
sait plus quoi penser à la longue, tout en
pressentant qu’entre l’être et le paraître de
Socrate il n’y a pas seulement un jeu de
langage, voire de mots. « Connais-toi toi-
même », lui enjoint la Pythie de Delphes
dans son oracle le plus proverbial, mais
avant de connaître, et de se connaître, il
faut être. Etre soi-même, n’est-ce pas le
plus impertinent des rôles, par sa négation
même de tout rôle ?
Cette question ne saurait se limiter à une
critique sociale. Elle nous rappelle que
nous faisons de la philosophie sans le
savoir, du moins sans chercher à réfléchir
sur ce que nous croyons savoir : mieux
encore, nous exprimons dans la langue
usuelle un problème qui relève de la
métaphysique la plus spéciale, la plus
traditionnelle aussi, lorsque nous disons,
avant même tout attribut, « je suis ». Les
traditions judéo-chrétienne, et
métaphysique (Descartes, Méditations
métaphysiques, 1641) seraient une réponse
de façade, toujours bien convenue, la
façade d’un rôle justement, celui qu’on
devrait éviter pour affronter la face nue
celui qui se dit «être ». Faire de la grande
métaphysique, en quelque sorte, sans la
métaphysique des grands philosophes.
Revenir à Platon, à l’intérieur de la
tradition qu’il a fondée plus que tout autre
grec, sinon plus que tout autre philosophe,
s’impose certes comme une nécessité
historique. Le plus anti-traditionaliste des
occidentaux, Nietzsche, décrivait sa propre
philosophie un « platonisme inversé »,
allégeance renversante mais révélatrice de
la position cardinale du plus célèbre
disciple de Socrate. Mais la nécessité que
l’on voudrait souligner est plus profonde,
d’ordre psychologique, linguistique aussi,
comme l’usage du verbe « être » au
quotidien, banal et pourtant si délicat à
définir.

3
C’est que la grammaire nous assure elle
aussi de sa tradition savante et rassurante,
qui identifie le « soi-même » au pronom
personnel réfléchi, au verbe pronominal
associé, tandis que la même métaphysique
construit des systèmes entiers sur ce
« soi », sous les espèces de l’âme, de
l’esprit ou de l’ego. La grammaire a donc
quelque chose de métaphysique, non pas
au sens où elle aurait une face cachée mais,
pour peu qu’on en fasse une philosophie
élémentaire au sens premier d’une
réduction à ses éléments premiers, parce
qu’elle exprime une recherche sur
l’identité des mots comme identification
des êtres. Parce que, écrit Bergson dans les
Données immédiates de la
conscience(1889), « nous nous exprimons
nécessairement par des mots », il ne s’agit
pas de contourner l’usage linguistique ni la
grammaire, mais de les traverser en nous
demandant si la langue, toute langue, ne
sont pas un miroir de notre impuissance et
un alibi pour notre paresse dans le paraître.
Le délestage de deux traditions dont l’une
est le fruit de l’apprentissage académique
et l’autre de l’habitude culturelle relève de
la gageure, de la provocation peut-être,
mais la meilleure est à venir : séparer la
logique du langage de son référent
métaphysique (le « je » qui s’exprime
n’existe pas, seuls les mots, y compris
« je », ont un sens purement linguistique et
conventionnel) a été tenté par les Sophistes
en Grèce ancienne comme par la
philosophie analytique anglo-saxonne au
XXème siècle (Russell, J . Bouveresse en
France), mais on peut aussi, en posant la
question de l’être et du paraître, conjuguer
l’expérience de pensée (métaphysique) et
le vécu exprimé dans le langage
(grammaire), sans faire excès d’allégeance
aux savoirs traditionnels. Etre original,
c’est revenir à l’origine.
Il faut d’abord insister sur le fait que la
question s’y prête. L’être un, vrai et parfait
cher à Parménide, ce Présocratique auteur
du premier texte connu, fragmentaire, de la
métaphysique occidentale (VI siècle av
JC), l’être absolument transcendant qui dit
« au commencement » : « Que la lumière
soit » (Genèse, I, 3), la place toute
particulière qu’occupe, dans un texte sur la
société et l’Etat, la fameuse Allégorie de la
caverne (Platon, République, VII) tout
cela renvoie à une recherche de l’origine et
de la vérité, irréductiblement supérieure au
paraître. La nudité du texte de Parménide,
la simplicité du discours biblique ne visent
pas le même objectif que la République,
même s’ils procèdent de la même
radicalité. On oublie trop en effet que la
caverne n’est pas le lieu de prestige que
doit s’efforcer de fuir le philosophe, elle
est encore dans sa perspective une fois
percées les images mirobolantes de ses
murs. Et là recommencent les tentations
du paraître, à ceci près que le philosophe
n’a plus besoin de leur résister puisque
cette fois il les reconnaît immédiatement. Il
doit y retourner.
Rien chez Platon, a dit un commentateur
illustre, n’est étranger à la politique, pas
même le passage mentionné ci-dessus.
Paraître dans la Caverne, être à l’extérieur,
l’opposition est flagrante, mais le plus
difficile, et le plus nécessaire pourtant, sera
bien d’ « être » dans la Caverne. On l’aura
compris, la caverne est une allégorie de
tout le monde humain mais aussi et surtout
de la communauté politique, de l’Etat issu
de la société des hommes. Nous critiquons
l’Etat pour l’apparence d’action et le
prestige de ses apparitions, en majesté
royale comme républicaine. Tel était le
propos de Platon, qui visait l’ordre
politique de son temps, à travers l’ordre

4
philosophique institué hors de toute
institution, Agora exceptée, par Socrate.
L’être et le paraître n’ont alors pas
d’histoire, ils sont actuels et anciens,
preuves linguistiques et sociales d’une
philosophia perennis qui nous habite le
temps d’un effort d’attention à la valeur du
réel, et, plus gravement, à la valeur des
hommes. L’épaisseur thématique de l’être
et du paraître se fonde ainsi sur une
uniformité sémantique, et non l’inverse : ce
ne sont pas un être ni un paraître à chaque
fois différenciés qu’il faut chercher dans la
métaphysique, dans la physique, dans la
société, mais les mêmes à l’œuvre dans des
milieux différents. La puissance théorique
de Platon parvient ainsi à déphaser le
lecteur qui ne comprend pas le sens social
et politique de l’Allégorie de la caverne, ni
le sens métaphysique de la constitution de
la cité idéale.
Un autre philosophe, lui aussi écrivain, lui
aussi intéressé à refonder l’Etat et la
société dans la transparence (pour
reprendre le mot de Starobinski), tant par
un traité politique (du Contrat social) que
par un ouvrage de pédagogie (Emile), leur
ajoutant la compassion portée au rang de
vertu, la liberté de la personne humaine au
rang de principe naturel, et l’expression
explicitement personnelle du « je suis»
(Confessions). A l’époque dite moderne,
Rousseau dénonce les mêmes travers, le
même prestige du paraître. Il nous montre
lui aussi une Caverne qui n’a plus rien
d’allégorique : la nôtre. Comme Socrate, il
le paya d’une mort, mais vivante, celle de
l’isolement, prix assumé du choix d’être
soi-même.
Etienne Osier, philosophe
1
1
Ancien élève de l’ENS-Ulm, Etienne Osier est spécialiste de la pensée de Schopenhauer. Il a notamment traduit
et présenté les œuvres : « Sur la liberté de la volonté » de Schopenhauer (éd. Hermann) et « Sur la religion » de
Schopenhauer (éd. Garnier-Flammarion). Il a également beaucoup travaillé sur les traditions philosophiques
orientales (indienne).

5
René Girard :
Un pionnier de génie, un chantier à poursuivre
La thèse de René Girard du désir mimétique et
du bouc émissaire séduit à la fois par sa
simplicité et par son pouvoir explicatif. Sur
bien des points elle concurrence
avantageusement tant la théorie freudienne que
le structuralisme. La découverte des neurones
miroirs et les développements de l'éthologie
apportent des éléments de confirmation au
"premier étage" de la théorie girardienne, la
théorie mimétique. René Girard reste pourtant
un personnage contesté, voire méconnu,
surtout en France.
Le système théorique girardien est
apparemment très simple. Avec comme point
de départ le mimétisme du désir− dont l'étude
remonte à Platon −, et comme mécanisme
fondateur le meurtre d'un bouc émissaire −
concept déjà reconnu dans l'Ancien Testament
−, René Girard résout l'énigme du sacrifice,
rituel violent mais central dans la plupart des
religions connues. Plus précisément,
l'autonomie du désir est illusoire, tout désir
n'étant que l'imitation du désir d'un autre, le
modèle, qui devient vite le rival, dans une
relation triangulaire. La violence mimétique
qui ressort de cette rivalité menace tout groupe
humain d'autodestruction. La désignation
arbitraire d'un bouc émissaire et son meurtre
focalisent cette violence, transforment le "tous
contre tous" en un "tous contre un", fournissent
au groupe le moyen d'expulser la violence et
lui permettent enfin de retrouver la paix. Cet
effet cathartique, capable tant de déchaîner la
violence que d'apporter la paix, conduit, par un
processus de sublimation, à élever la victime
émissaire au rang de divinité. Le sacrifice n'est
que le rituel de répétition de ce meurtre
fondateur. Avec pour fonction de garder à
distance la violence toujours renaissante, il
assure la régulation du groupe et lui permet de
se constituer en société, fondant ainsi le
premier rituel.
La théorie conduit bien sûr à des questions plus
complexes voire paradoxales, comme par
exemple : la relation entre désir et
indifférenciation, entre violence et
différenciation, la proximité entre violence et
sexualité, entre systèmes vindicatoires et
alliances matrimoniales. Mais son pouvoir
explicatif est immense.
A l'instar des mots du langage qui segmentent
le réel, le sacrifice pose le premier acte de
séparation de l'histoire de l'humanité : entre le
groupe et la violence, entre le profane et le
sacré. Domestication de l'homme par l'homme,
il installe ainsi le religieux comme pierre
angulaire de la civilisation, L'émergence du
divin représente quant à elle la première
production symbolique.
La théorie triangulaire du désir rend compte de
l'omniprésence de la réciprocité dans les
rapports sociaux, de la violence mimétique des
foules, du rôle social de la monnaie, de la
montée de l'individualisme, de l'égalitarisme et
de l'omniprésence de l'économie dans la
civilisation moderne. La libido freudienne
s'interprète comme un cas particulier de la
violence mimétique, et le complexe d'Œdipe,
le meurtre du père, comme un cas particulier
du mécanisme victimaire. La rareté, fondement
de l'économie, apparaît comme une modalité
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%