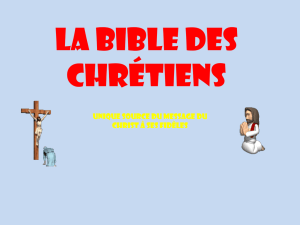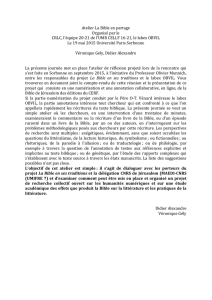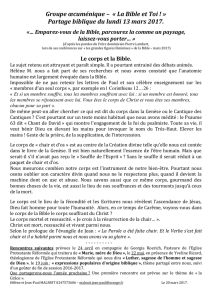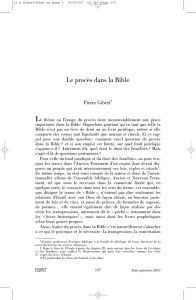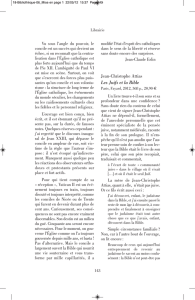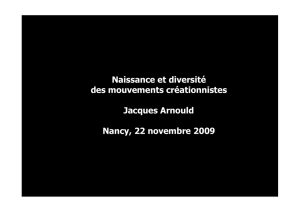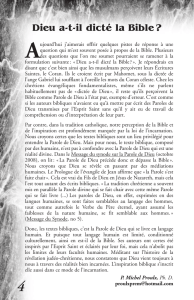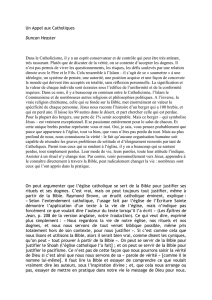Lecture(s): Réceptions et usages de la Bible

PLAN DE COURS
04.06.2015 1
LECTURE(S):
RÉCEPTIONS ET USAGES DE LA BIBLE
Professeur : Francesca CAVAZZA
Année universitaire 2016/2017: Semestre d’automne
SÉANCES ET PROGRAMMES
1ere séance : « le monde catholique et le monde protestant : qui peut lire la
Bible ? »
L’effet multiplicateur de l’imprimerie, qui diffusa 300.000 copies des œuvres de Luther et une infinité de
traductions de la Bible, se trouve à l’origine de la fracture de la Chrétienté opérée par la Réforme. La Bible a
bien été l’objet de la première censure en Europe occidentale. La décision de l’Église catholique d’interdire,
après la Réforme protestante, les traductions et adaptations en langue vernaculaire de la Bible pour
empêcher la diffusion des textes sacrés auprès du public (les clercs devant rester les médiateurs entre le
peuple et Dieu) est à l’origine, entre autres, de la faible familiarité des Français avec la Bible. Cette
interdiction a contribué à creuser une division entre le Sud et le Nord de l’Europe.
• Supports : Gérard Dou, Portrait d’une vieille femme lisant (1630) ; Gérard Dou, La Lecture de la
Bible ou Anne et Tobie (vers 1645) ; Caravage, Saint Jérôme (1606) ; Tertullien, « De la toilette des
femmes » [De cultu feminarum] (IIIème siècle).
• Méthodologie : La dissertation (analyse du sujet).
2ème séance : « Symboles de l’architecture religieuse »
Pour parler aux fidèles, le monde catholique n’a pas recouru qu’à l’intermédiaire du clergé. La construction
de la « maison du Seigneur » dans toutes ses formes a représenté autant l’édification de lieux de
recueillement spirituel que l’édification morale par un symbolisme devenu aujourd’hui difficile à décrypter.
Depuis l’orientation géographique des édifices jusqu’à leurs noms, en passant naturellement par les
éléments architecturaux accompagnant les grands courants de l’histoire, tous les détails dans une église
font sens et traduisent, à leur manière, le discours religieux. On propose une exploration de l’architecture
religieuse depuis la plus grande église de tous les temps (construite au Moyen Âge puis détruite à la
Révolution) jusqu’à la dernière cathédrale érigée en France afin de déchiffrer ce que des formes, aujourd’hui
devenues non-signifiantes, pouvaient raconter jadis aux fidèles.
• Supports : La « Maior Ecclesia » à Cluny ; Conques, de l’église romane aux vitraux de Soulages ;
Notre-Dame de Paris, de Reims et de Chartres, exemples de cathédrale gothique ; l’église Saint-
Pierre de Firminy du Corbusier ; la Résurrection Saint-Corbinien à Évry.

PLAN DE COURS
04.06.2015 2
• Méthodologie : La dissertation (élaboration d’une problématique et construction du plan).
3ème séance : « La Bible illustrée par les grands maîtres »
Aux côtés de l’architecture, la peinture se met au service de l’Église pour transmettre des contenus religieux
dont l’approche personnelle par le public était jugée « dangereuse ». Pendant des siècles, en Occident, la
Bible demeure, avec la mythologie gréco-latine, le principal sujet des œuvres d’art. Le génie de centaines
d’artistes du Moyen Âge à la Renaissance n’est soutenu que par des mécénats proches du monde
catholique, demandant en échange de se conformer à une certaine lecture du texte biblique. Il s’agit alors de
montrer par l’analyse de quelques chefs-d’œuvre comment les artistes ont mis leur talent au service des
institutions et de considérer, par l’exemple d’un commentaire moderne (de Proust) et de l’étude d’un musée
(à partir notamment de leur modernisation, à travers l’exemple du Louvre), l’immortalité des œuvres et, en
contraste, la fugacité du public.
Supports :
• La Cène : Domenico Ghirlandaio, Cenacolo de Ognissanti (1480) ; Léonard de Vinci, La Cène
(1494-1498) ; Paolo Veronese, Le Repas chez Levi (1573) ; Alessandro Allori, Ultima Cena (1582).
• Le Souper chez Emmaüs : Jacopo Pontormo, Le Souper à Emmaüs (1525) ; Le Caravage, Le
Souper à Emmaüs (1606) ; Rembrandt, Les Pèlerins d'Emmaüs (1648).
• Le Jugement dernier : Giotto, Chapelle des Scrovegni (1303-1306) ; Fra Angelico, Le Jugement
dernier (environ 1431) ; Michel-Ange, Le Jugement dernier dans la Chapelle Sixtine (1536-1541).
• Marcel Proust, « La charité de Giotto » dans Du côté de chez Swann (1913).
• Méthodologie : L’interprétation et l’analyse d’une œuvre d’art.
4ème séance : « Chanter la Bible »
L’ère de la musique baroque débute symboliquement en Italie avec l’opéra de Claudio Monteverdi (1567-
1643), L’Orfeo (1607), et se termine avec les contemporains de Johann Sebastian Bach (1685-1750). Le
compositeur italien a profité à la cour de Vincent de Gonzague à Mantoue d’un mécène exubérant porté sur
les arts et a joui, en tant que musicien, d’une réputation flatteuse. Bach, de son vivant, n’était connu que
localement, et surtout comme organiste et improvisateur. Si le premier ne s’est pas adonné exclusivement à
la musique sacrée et a su donner une interprétation humaine à l’expression de sentiments divins, pour Bach
la musique sans Dieu n’est rien. Nous étudierons la manière dont Monteverdi et Bach ont transposé en
musique le sentiment de la compassion et de l’abandon à la douleur et engagé ce qu’on appellera
rétrospectivement « la révolution baroque ». On comparera le Pianto della Madonna (1640) de Monteverdi,
métamorphose ultime du Lamento d’Arianna, à un choral extrait de La Passion selon saint Matthieu (1727)
de Bach.
• Supports : Claudio Monteverdi ; Pianto della Madonna, dernière partie de la Messa a quattro voci da
cappella, dans Selva morale e spirituale (1640) ; Johann Sebastian Bach, « O Haupt voll Blut und
Wunden (Ô tête couverte de sang et de blessures) » dans Passion selon saint Matthieu (1727).

PLAN DE COURS
04.06.2015 3
• Méthodologie : Argumentation logique et connecteurs.
5ème séance : « la quête du graal »
Le Moyen Âge marque une époque décisive pour la chrétienté car il s’agit, pour les différents papes,
d’évangéliser massivement des populations païennes — et souvent polythéistes — vouant des cultes à des
divinités locales. Il est intéressant d’observer les différents moyens déployés pour parvenir à toucher des
populations illettrées et rurales et pour engager leur conversion. L’imagerie, l’iconographie et les contes
jouèrent un rôle décisif. Il s’agit de considérer pour cela d’une part l’invention de la figure du saint qui permit
d’implanter des figures chrétiennes locales et, d’autre part, la confusion entre le religieux et le chevaleresque
qu’opéra la geste arthurienne. Les chevaliers de la Table Ronde apparaissent tant et si bien comme les
nouveaux apôtres d’un graal qui a tous les aspects du Saint-Esprit, que l’Église hésita longuement, au cours
du xiiie siècle, à faire de La Queste del Saint-Graal le Troisième Testament, témoignage moderne de la
présence de Dieu sur terre. Par les saints et l’épopée du graal, il s’agissait de réécrire une Bible et de
l’adapter pour répondre aux soucis et aux préoccupations d’individus les plus divers.
• Supports : La Quête du Saint Graal (roman anonyme du xiiie siècle) ; imageries d’Épinal ; Georges
Duby, Le Temps des cathédrales (1976).
• Méthodologie : Éléments de rhétorique et prise de parole.
6ème séance : « Saint Jean-Baptiste décapité par Salomé femme fatale »
La figure de Salomé — qui dans les Évangiles est responsable de la mort de Jean-Baptiste après avoir
dansé et séduit le roi Hérode — devient au xixème siècle l’emblème de la femme fatale et de la féminité
perverse. Des centaines d’œuvres sont inspirées à cette époque par cette figure incarnant la modernité.
Devant cette nouvelle incarnation de Salomé, Jean-Baptiste cesse d’être considéré comme le prophète
précurseur de Jésus Christ pour devenir un avatar de l’artiste perdant sa tête à cause de l’art. L’art devient
alors, à la fin du xixème siècle, une nouvelle religion : à l’élan transcendant vers la sacralité de Dieu et de sa
Création se substitue un élan immanent vers la création humaine. La sacralité de la Bible passe du religieux
à l’artistique.
• Supports : Henri Regnault, Salomé (1870) ; Gustave Moreau, Salomé dansant devant Hérode
(1876) ; Joris-Karl Huysmans, Vème chapitre d’À Rebours, (1884) ; Gustave Flaubert, « Hérodias »
(1877) dans Trois contes ; Aubrey Beardsley, Illustrations pour Oscar Wilde « Salomé » (1894).
Émile Zola, L’Œuvre (1886) ; Odilon Redon, Dans la balance (1884) ; Edvard Munch, Salomé.
Paraphrase (1894-98).
• Exposé : Judith et Holopherne dans la peinture.

PLAN DE COURS
04.06.2015 4
7ème séance : « Relectures de la Passion du Christ : Jésus au cinéma et en
bicyclette »
La vie et la Passion de Jésus ont été l’un des sujets privilégiés du film biblique, voire l’un des thèmes
privilégiés du cinéma, dès ses origines. L’un des plus anciens films bibliques fut d’ailleurs réalisé par les
frères Lumière en 1897 : La Vie et la passion du Christ. Si dans le premier cinéma l’interprétation orthodoxe
de Jésus et de ses miracles reste simple et sans dimension théologique, les premiers films sur ce sujet se
sont souvent inspirés de peintures de représentations bibliques. Pasolini a transformé la Passion du Christ
en drame social tandis qu’Alfred Jarry la voit dans une étape de montagne du Tour de France.
• Supports : Auguste et Louis Lumière, La Vie et la Passion du Christ (1897) ; Georges Méliès, Le
Christ marchant sur les flots (1899) ; Rosso Fiorentino, Descente de croix (1521) ; Pontormo, La
déposition (1527) ; Pier Paolo Pasolini, La Ricotta (Le Fromage blanc), dans Ragopag (1963) et
L’Évangile selon Saint Matthieu (1964) ; Alfred Jarry, « La passion considérée comme course de
côte », Le Canard sauvage, n° 4,11-17 (1903) ; Albert Uderzo, L’Odyssée d’Astérix (1981).
• Exposé : La Passion du Christ dans la Renaissance italienne.
8ème séance : « Sympathies pour le diable »
Les figures de Salomé et Jean-Baptiste, comme celle de Jésus, ne sont pas les seules à avoir fait l’objet
d’une autonomisation de leur signification traditionnelle. La figure du Diable a notamment été revisitée et
retournée. D’emblème du mal, l’ange tombé du ciel pour ne pas avoir reconnu la supériorité de Dieu fait
l’objet de maintes réinterprétations et appropriations le présentant comme une figure attirante voire positive.
Le choix provocateur d’accorder à Lucifer une place et une dimension nouvelles, en lien avec des enjeux et
des préoccupations socio-politiques, sera examiné à travers quelques exemples tirés de la littérature, du
rock et du cinéma.
• Supports : Alain-René Lesage, Le Diable boiteux (1707) ; The Rolling Stones, Sympathy for the
Devil (1968) ; Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite (1939) ; Jean-Luc Godard, Sympathy for
the Devil (One plus One) (1968).
• Exposé : L’Enfer dans la littérature.
9ème séance : « Caricatures et dérisions »
La caricature, la dérision et le blasphème occupent une place importante dans la culture occidentale et
notamment en France. À partir de l’époque des Lumières, caricatures et vignettes ont ciblé d’abord le clergé
jusqu’à toucher, à l’époque contemporaine, les thèmes les plus sensibles de la religion chrétienne.
• Supports : La Bible pour rire. Illustrée de 306 dessins par Lavrate (1881) ; Georges Brassens, Le
mécréant (1960) ; Max Ernst, La Vierge corrigeant l’enfant Jésus (1926) ; Unes de Charlie Hebdo
(1970-2016).

PLAN DE COURS
04.06.2015 5
• Exposé : Spinoza ou l’« athée vertueux »
10ème séance : « Lecture laïque de la bible »
À la suite de la Révolution de 1789, la République française se construit en réaction au pouvoir de l’Église
catholique en France et à son autorité morale et politique. La Troisième République notamment (1870-1940)
va proposer un contre-modèle laïque, reprenant de nombreux rituels et emblèmes religieux et bibliques pour
asseoir son pouvoir. Marianne, allégorie incarnant la République, n’est pas sans rappeler la Vierge, quand la
fraternité, que l’on entend dans la devise républicaine, n’est rien d’autre qu’une charité laïcisée. En d’autres
termes, la Mairie a remplacé l’Église et le Maire le prêtre.
• Supports : La célébration du mariage et du baptême républicains et catholiques ; Figures de
Marianne.
• Exposé : La séparation de l’Église et de l’État en France.
11ème séance : « Bible et culture de masse »
Le rapport entre religion chrétienne et publicité n’est pas sans paradoxe. Tout les oppose : la religion invite à
une vie simple, empreinte de spiritualité et détachée des biens matériels, quand la publicité encourage au
contraire la soif de possession de biens matériels et pousse à une consommation à outrance pour satisfaire
des désirs toujours renouvelés. Toutefois des liens ancestraux se sont tissés entre religion et économie.
La publicité puise librement et depuis longtemps dans le vaste répertoire des signes religieux présents dans
la mémoire collective. Le religieux est devenu aujourd’hui un répertoire de signes parmi d’autres, dont se
nourrissent les publicitaires, en ayant recours à différents emprunts : histoire, pensée, récits, personnages,
paroles ou symboles.
Il s’agit enfin de situer le texte sacré à l’heure de la société et de la culture de masse.
• Supports : La Bible. Traduction officielle liturgique [simplifiée], AELF (association épiscopale
liturgique pour les pays francophones) ; plusieurs traductions d’un passage de la Bible disponible en
2016 ; campagnes publicitaires de marques de voiture, de mode et de cosmétique.
• Exposé : « Stars » du Moyen Âge : saints et fondateurs d’ordres religieux.
12ème séance : « Contrôle final ».
BIBLIOGRAPHIE
• La Bible de Jérusalem, Paris, Les Éditions du Cerf, 1998.
• Auerbach Erich, Figura. La Loi juive et la Promesse chrétienne, traduit de l’allemand par Diane
Meur, postface de M. Launay, Paris, Macula, 2003, 143 p.
 6
6
1
/
6
100%