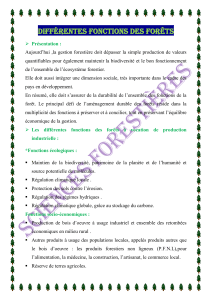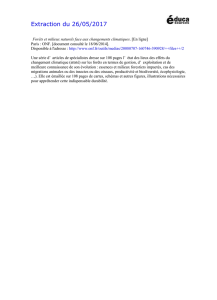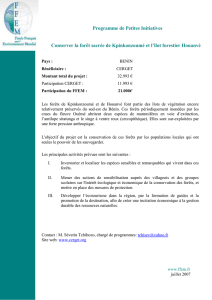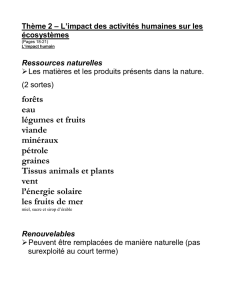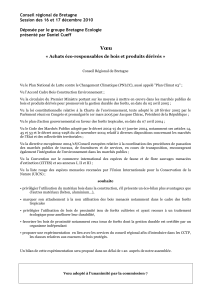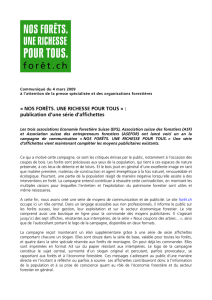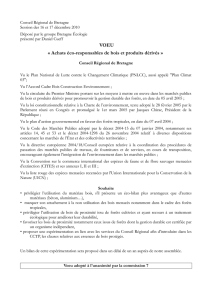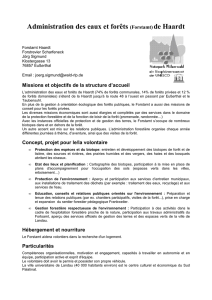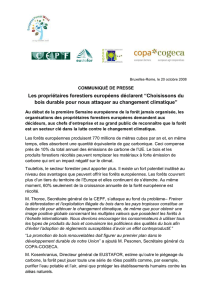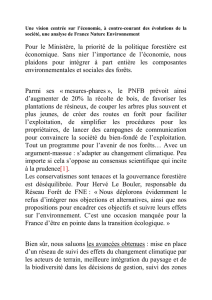Epreuve 2 : Commentaire de texte

Commentaire de texte– Session 2011 1/21
C
ONCOURS
3
E
VOIE OUVERT POUR L
’
ACC
È
S AU CORPS
DES TECHNICIENS OP
É
RATIONNELS
DE L
’
OFFICE NATIONAL DES FOR
Ê
TS
ANN
É
E
2011
É
PREUVE D
’
UN COMMENTAIRE DE TEXTE
Durée de l’épreuve :
X heures à partir du moment où le sujet est remis au candidat
(Coefficient Y)
Dossier à destination au jury

2 de 21 Commentaire de texte – avril 2011
Commentaire de texte se rapprochant à l’environnement
socio-économique de la forêt
Le candidat disposera de 2 heures pour satisfaire à l’épreuve de commentaire de texte se
rapportant à l’environnement socioéconomique de la forêt.
En référence aux questions qui lui sont posées, sont soumis à son attention les textes suivants :
•
La conservation des forêts, l'accroissement de la couverture forestière et le rôle des forêts
dans la satisfaction des besoins humains essentiels.
•
France. La situation forestière actuelle: aperçu du contexte et appréciation des principales
contraintes. Source: http://www.europart.europa.eu/
•
Dygepop (Dynamique et gestion des populations d'arbres en forêt guyanaise aménagée)
M. Arbez, Fondement et organisation des réseaux européens de conservation des ressources
génétiques forestières (ext)
Vous répondrez aux questions suivantes en développant vos réponses.
Questions :
1. Pourquoi une coopération internationale est-elle nécessaire à la conservation des forêts ?
2. Quel lien peut-on établir entre le climat et la préservation des forêts ?
3. Répondez par vrai ou par faux aux affirmations suivantes. Argumentez vos réponses en donnant
les bons éléments quand la proposition est fausse.
a. Le recours aux coupes sélectives n’a pas fait la preuve de sa rentabilité écologique et
économique.
b. La qualification n’est pas nécessaire au métier traditionnel de bûcheron.
c. Les actions de conservation doivent être rapides et ponctuelles pour être efficaces.
4. Pourquoi la conservation ex situ est-elle préférable ? Développez cette question.
5. À quelle nécessité correspond la bonne gestion d’une forêt ?

Commentaire de texte– Session 2011 3/21
Questions posées et barème de notation de commentaire de texte
se rapportant à l’environnement socioéconomique de la forêt
Questions Barème de notation
1. Pourquoi une coopération internationale est-
elle nécessaire à la conservation des forêts ? 6 points
2. Quel lien peut-on établir entre le climat et la
préservation des forêts ? 3 points
3. a- Le recours aux coupes sélectives n’a pas
fait la preuve de sa rentabilité écologique et
économique. 2 points
3. b- Quels sont les paramètres hydriques dont il
faut tenir compte dans le cadre de la lutte contre
la désertification ? 2 points
3. c- Les actions de conservation doivent être
rapides et ponctuelles pour être efficaces. 2 points
4. Pourquoi la conservation ex situ est-elle
préférable ? Développez cette question. 2 points
5. Le boisement correspond à une nécessité
écologique dans les zones en voie de
désertification. Est-ce vrai ? 3 points

4 de 21 Commentaire de texte – avril 2011
Doc 1
LA CONSERVATION DES FORÊTS, L'ACCROISSEMENT DE LA COUVERTURE
FORESTIÈRE ET LE RÔLE DES FORÊTS DANS LA SATISFACTION DES
BESOINS HUMAINS ESSENTIELS
1. INTRODUCTION
À la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), tenue en juin 1992, on a
souligné que tous les pays se devaient de développer des approches semblables tant qu'à la gestion, la
conservation et le développement durable des forêts du globe sont indispensables pour répondre aux besoins
socio-économiques et environnementaux des générations actuelles et futures. Les participants de la CNUED ont
aussi reconnu, entre autres, qu'il fallait pour cela maintenir les rôles et fonctions multiples de tous les types de
forêts ainsi qu'améliorer la conservation et la gestion des forêts et accroître le couvert forestier mondial, comme
l'indiquent les programmes A et B du chapitre 11 d'Action 21. De plus, le chapitre 15 d'Action 21 met l'accent
sur le besoin d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Bien que tous ces besoins soient maintenant reconnus, il faut avant tout mettre en oeuvre les programmes
adoptés à la CNUED, tout en se rappelant que l'implantation de l'énoncé des Principes forestiers et des
programmes forestiers variés ne sont réalisables qu'avec un effort international vers l'atteinte de buts concrets. Le
présent document a pour objet de susciter la discussion sur la mise en œuvre de certains volets de ces
programmes, notamment la conservation des forêts, l'accroissement du couvert forestier et les fonctions des
forêts, et sur les domaines propices à une collaboration nationale et internationale.
2. CONSERVATION DES FORÊTS
Les forêts sont influencées par le climat, les formes de terrain et la composition du sol qui existent sous une
grande variété de formes dans les zones tropicales, tempérées et boréales du monde. Elles peuvent se composer
de résineux ou de feuillus, leur feuillage peut être persistant ou caduc, leur couvert peut être ouvert ou fermé et
elles peuvent être humides ou sèches. Chacun des types de forêts est unique en son genre, mais ensemble ils se
complètent et remplissent des fonctions socio- économiques, écologiques, environnementales, culturelles et
spirituelles.
Selon des études récentes effectuées à l'échelle de la planète, il y aurait environ 1,4 million d'espèces connues.
De l'avis général, cependant, ce chiffre se situe au-dessous de la réalité : de 5 à 50 millions d'espèces existeraient
dans les écosystèmes naturels des forêts, des savanes, des pâturages, des déserts, des toundras, des lacs et des
mers. Les terres cultivées et les jardins sont aussi d'importants dépôts de ressources biologiques.
Dans cette perspective, il est reconnu que les forêts sont riches en ressources biologiques. Bien qu'elles ne
couvrent que 13,4 % des terres du globe, ces forêts abritent la moitié des vertébrés, 60 % des espèces végétales
connues et peut-être 90 % des espèces du globe. Toutefois, des études récentes indiquent que les forêts
tempérées et boréales, qui ont des écosystèmes extrêmement variés, particulièrement dans les zones climatiques
et géographiques où subsistent de vieilles forêts, peuvent présenter une diversité supérieure à celle des forêts
tropicales à l'intérieur de certaines espèces. Bien que les forêts tempérées et boréales comprennent généralement
beaucoup moins d'espèces d'arbres que les forêts tropicales, souvent le dixième ou moins, on estime maintenant
que certaines d'entre elles sont aussi diversifiées, sinon plus, que les forêts tropicales. Par exemple, la litière
végétale des vieilles forêts de l'Oregon, aux États-Unis, abrite près de 250 espèces différentes d'arthropodes par
mètre carré; dans la seule aire de recherche de la H.J. Andrews Memorial Forest, 90 genres ont été recensés
(Lattin, 1990). Il a été proposé que l'objectif minimal acceptable soit un réseau de 500 zones protégées et gérées,
de 200 000 hectares en moyenne, qui abriterait 10 % des vieilles forêts et des forêts primaires restantes (Anon.,
1991 et UICN/PNUE/FMN, 1991).
Pour favoriser ce réseautage et optimiser la représentativité globale de ces zones biogéographiques aux fins de la
conservation de la diversité biologique, il faudrait dresser une liste des zones en question, dont conviendraient
les gouvernements nationaux. Il faudrait aussi définir ces zones biogéographiques et mettre au point des
mécanismes conjoints, ainsi que quantifier les coûts et déterminer les sources de fonds nécessaires pour gérer et
conserver les zones. Il y aurait également lieu d'instaurer des mécanismes conjoints de coopération internationale
visant l'établissement de zones biogéographiques transnationales.

Commentaire de texte– Session 2011 5/21
Par ailleurs, il a été reconnu que les aires entièrement protégées ne peuvent jamais être suffisamment vastes pour
assurer la conservation de tous les processus écologiques et de toutes les espèces. Il est cependant nécessaire de
fixer, au niveau national, un objectif minimum acceptable pour les zones de conservation des forêts pour chaque
pays. On pourrait aller plus loin en constituant des zones tampons de forêts naturelles autour de l'aire protégée;
une zone tampon intérieure servirait à la recherche fondamentale et appliquée, à la surveillance
environnementale, à l'utilisation traditionnelle du territoire, aux loisirs et au tourisme ou à l'éducation et à la
formation en matière d'environnement, et une zone tampon extérieure servirait à appliquer les résultats de la
recherche en vue de satisfaire aux besoins des populations locales. Ces pratiques de gestion s'inscrivent dans le
droit fil du point 8e) des Principes sur les forêts.
Mise à part la nécessité de réserver des aires de conservation, on reconnaît maintenant de plus en plus que la
production durable de bois par des méthodes de coupe sélective est l'un des moyens les plus efficaces d'assurer la
conservation in situ de la diversité biologique des écosystèmes forestiers. Ainsi gérées, les forêts conservent la
plus grande partie de la diversité des vieilles forêts et des forêts primaires en ce qui concerne tant le nombre
d'espèces que leur population. La valeur économique du bois et les bienfaits environnementaux qui en résultent
justifient amplement les investissements faits pour conserver le couvert forestier. L'adoption de méthodes de
coupe sélective pour tous les types de forêts favoriserait grandement la conservation in situ de la diversité
biologique et l'utilisation durable des ressources forestières. À cet égard, la plantation d'arbres aurait pour effet
d'atténuer les pressions menant à la surexploitation des forêts naturelles et attribuables à la demande croissante
de bois.
La production durable de biens et de services forestiers et la conservation de la diversité biologique des
écosystèmes forestiers, de même que le partage équitable des avantages de l'utilisation des ressources génétiques,
exigent une action concrète à l'échelle nationale comme internationale. Il est donc indispensable que des
politiques et des stratégies nationales, entre autres, visent à consacrer une superficie forestière optimale à la
conservation ainsi qu'à la production durable de biens et de services et indiquent les mesures propices à la
conservation des forêts ex situ et in situ pendant la coupe. Dans certains cas, les mesures à long terme peuvent
comprendre le rétablissement et la recréation des vieilles forêts et des forêts primaires.
Dans cette optique, il est essentiel, pour la gestion durable, la conservation et l'exploitation de leurs ressources
forestières, que les pays ayant un pourcentage élevé de ces espaces de terres couverts de forêts, surtout les pays
en développement, aient accès à «des ressources financières nouvelles et supplémentaires» et au «transfert [de]
techniques écologiquement rationnelles et [du] savoir-faire correspondant [...] y compris à des conditions
concessionnelles et préférentielles», d'après les points 10 et 11, respectivement, des Principes sur les forêts. En
outre, «le commerce des produits forestiers devrait se fonder sur des règles et procédures non discriminatoires et
multilatéralement acceptées, compatibles avec le droit et les pratiques commerciales internationales» et «il
faudrait éliminer ou éviter les mesures unilatérales, incompatibles avec les obligations internationales ou accords
internationaux, qui visent à restreindre et/ou à bannir le commerce international du bois d'oeuvre et d'autres
produits forestiers», comme le préconisent les points 13a) et 14, respectivement, des Principes sur les forêts. La
communauté internationale doit respecter ces principes pour réaliser la conservation et la gestion durables des
forêts à long terme.
3. ACCROISSEMENT DU COUVERT FORESTIER
L'accroissement du couvert forestier doit être considéré comme une mesure proactive à prendre pour freiner et
renverser la tendance actuelle au recul et à la dégradation des forêts. Les forêts mondiales sont en péril et
connaissent un déclin. On évalue qu'au début du XVIII
e
siècle, les forêts couvraient les quatre cinquièmes du
territoire actuel. Environ la moitié se trouvait dans des régions tropicales et l'autre moitié, dans des régions
boréales et tempérées. Au milieu du XIX
e
siècle, le couvert forestier mondial était passé à 3,9 milliards
d'hectares, soit 30 % de la zone continentale de la planète, à cause du déboisement. D'après les dernières données
fournies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans son évaluation des
ressources forestières de 1990, le couvert forestier mondial était passé à la fin de 1990 à 3,188 milliards
d'hectares, soit environ 24,4 % de la zone continentale. Les processus de réduction et de dégradation des
couvertures forestières ont apporté une perte annuelle d'environ 0.6 pourcent.
Bien que le recul annuel des forêts tempérées et boréales soit considéré comme négligeable à notre époque, il y a
eu déboisement sur une vaste échelle en Europe, au cours de la Révolution industrielle, pour répondre aux
besoins en terres agricoles, en matériaux de construction et en développement industriel (Hinde, 1985). On
estime en fait la superficie des forêts disparues à près de 200 millions d'hectares, ou 50 % de la zone forestière
initiale (ONU, 1991).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%