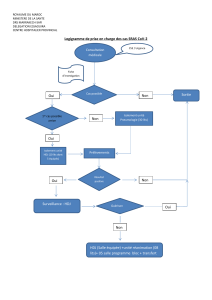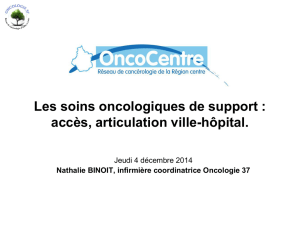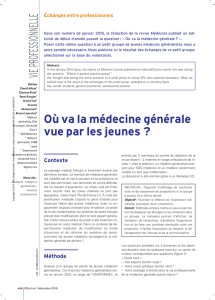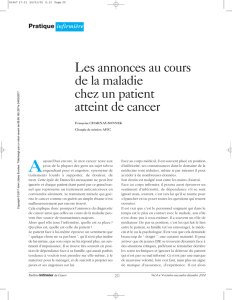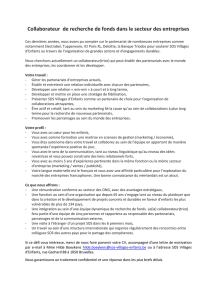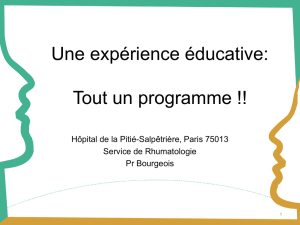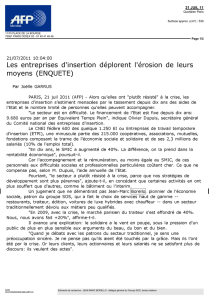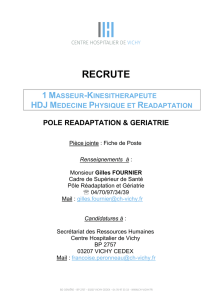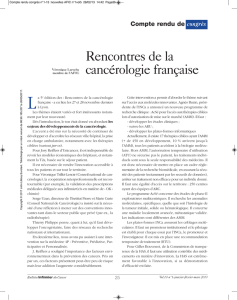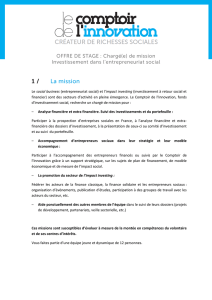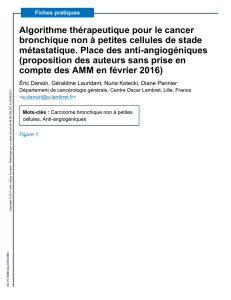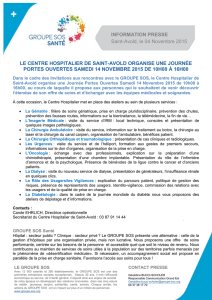La mise en place d`un hôpital de jour en Soins oncologiques de

E xpériences
9
Bulletin Infirmier du Cancer Vol.12-n°1-janvier-février-mars 2012
undi 8 h 15. Sandra* prend son service en hôpi-
tal de jour en Soins oncologiques de support
(HDJ SOS), au rez-de-chaussée de l’hôpital René
Huguenin-Institut Curie à Saint-Cloud.
Ce matin, elle attend deux patientes qui resteront
toute la matinée. Elle lit les dossiers et commence à rem-
plir les fiches spécifiques qui constitueront le support
de son entretien infirmier d’accueil. Cela lui permet de
mieux affiner les questions sur le contexte nutritionnel,
douleur, fatigue, et psychosocial des patients.
À 9 heures débute la réunion quotidienne de
l’équipe de l’Unité fonctionnelle de soins de support
(UFSOS) autour d’un café et d’un ballotin de chocolat.
Ensemble, tous les intervenants revoient les dossiers
du jour, évoquent les dossiers de la semaine et peuvent
communiquer sur les patients suivis en intra- et extra-
hospitalier.
Sandra va accueillir sa première patiente, Madame
N., qui découvre le service. Il y a deux chambres indi-
viduelles dans les tons parme, avec un lit médicalisé, un
fauteuil confortable, la télévision, un chariot de soins et
un cabinet de toilette. Les deux chambres donnent sur
la salle de soins qui les longe et qui ouvre sur la salle de
réunion du service.
Madame N. présente des effets secondaires impor-
tants à la suite de son traitement de chimiothérapie ;
elle souhaite un soutien psychologique et a besoin de
la mise en place d’une aide pour rester à domicile. En
venant en HDJ SOS, elle a la possibilité de profiter de
toute une équipe qui se présente à elle dans sa
chambre, de parler de ses problèmes et d’envisager des
solutions.
L’entretien infirmier se déroule dans la chambre et
Madame N., très fatiguée, fond en larmes en serrant la
main de sa fille. Pour un patient en cours de traitement,
savoir s’arrêter pour demander de l’aide n’est pas facile.
L’entretien infirmier prend tout son sens car, au-delà de
son rôle de coordinateur des soins et des intervenants,
l’infirmier prend aussi soin de la personne et de ses
accompagnants, avec une écoute active et sa présence,
temps rare à trouver en service d’hospitalisation conven-
tionnelle.
Après avoir prélevé un bilan sanguin et relevé les
constantes, Sandra laisse sa place au Dr B., médecin de
soins de support, qui va analyser la tolérance à la chi-
miothérapie et proposer des mesures correctrices. Sui-
vra l’assistante sociale qui mettra en place une aide à
domicile. Madame N. sera reçue dans un second temps
par l’unité Psycho-Oncologique (UPO) qui regroupe
une psychologue clinicienne, Madame D., et un onco-
psychiatre, le Dr M.
La mise en place
d’un hôpital de jour
en Soins oncologiques
de support
Blandine Meyrieux
L
* Les noms ont été remplacés.
Expériences n°1-12:nouvelles AFIC n°1vol5 03/05/12 14:00 Page9
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 02/06/2017.

E xpériences
10
Bulletin Infirmier du Cancer Vol.12-n°1-janvier-février-mars 2012
La deuxième patiente, Madame S., vient régulière-
ment pour des ponctions d’ascite. Afin d’améliorer son
confort, on lui a posé une chambre implantable reliée
à la collection. De la même façon que pour une perfu-
sion, le médecin ponctionne la chambre avec une
aiguille de Huber et peut drainer rapidement l’épan-
chement en asepsie et sans douleur pour la patiente. Ce
type de geste technique rapide ne peut être fait à domi-
cile et ne nécessite pas d’hospitalisation convention-
nelle. Venir en HDJ SOS permet à Madame S. d’être sou-
lagée de l’inconfort de l’ascite et d’avoir également un
moment « bulle », dans l’univers hospitalier, sans la pres-
sion d’un service où le temps est compté. Sandra pourra
donc passer un moment à discuter avec elle, de sa
famille, de son intolérance à l’activité, de la vision de
son corps changé par la maladie avant qu’un entretien
avec l’assistante sociale ne soit réalisé pour bilan.
Les deux patientes repartiront à domicile après le
déjeuner.
Que sont les soins de support ?
En 2001, le groupe de la fédération des centres de
luttes contre le cancer, mené par Dr Yvan Krakowsky,
choisit l’équivalent français du « supportive care » anglo-
saxon qui devient « soins de support ». Avec le Dr Phi-
lippe Colombat (GRASSPHO) et le Dr Gilles Marx, ils
travaillent sur les missions des soins de support en posant
comme définition : globalité et continuité des soins, de
l’annonce du diagnostic à la fin de vie ; marquant ainsi
le parallèle de prise en charge de chimiothérapie, radio-
thérapie et chirurgie. Les deux principes de base sont la
lisibilité (pas de concepts abstraits, des approches pra-
tiques) et l’accessibilité (patient et famille).
Initiée en 2003 par les États Généraux en Oncologie,
la réflexion sur les soins de support aboutit au plan Can-
cer I (mesure 42 annexe 4) qui en définit le fonctionne-
ment. La circulaire DHOS du 22 févier 2005 organise les
soins de support en France. La demande des patients et
de leur entourage est de ne pas prendre en charge seu-
lement la maladie, mais d’organiser également une prise
en charge transversale avec homogénéité et pertinence.
En 2006, au Centre René Huguenin, les services sont
éclatés, les soins de support dépendent de hiérarchies
différentes : diététiciennes, kinésithérapeutes, assistantes
sociales dépendant soit du directeur adjoint, soit des ser-
vices économiques.
En 2007, grâce à une impulsion forte de la nouvelle
direction de l’hôpital, le projet d’établissement 2007-
2012 inclut l’organisation fonctionnelle des soins de sup-
port qui sont intégrés à la direction des soins, sous une
même hiérarchie avec la mise en commun d’objectifs et
de projets de soins. Le projet médical de l’établissement
prévoit un axe de coordination des soins de support,
avec le directeur des soins comme copilote et le Dr M.
comme pilote.
Elle se base sur :
– un regroupement géographique, encore partiel à
ce jour ;
– des réunions de concertation pluridisciplinaires
(RCP) ou staff Soins oncologiques de support (SOS), sur
des dossiers cliniques complexes, en multidisciplinarité,
pour donner de la cohérence à une globalité de prise
en charge (par ex. : arrêt des traitements) ;
– HDJ SOS en articulation avec l’HDJ d’oncologie
médicale.
Les SOS sont formés par les kinésithérapeutes, les
diététiciennes, les assistantes sociales, l’UPO (Unité de
Psycho-Oncologie), l’entérothérapeute, l’orthophoniste,
un médecin gériatre, les spécialistes douleurs et en soins
palliatifs (infirmières et médecins) qui forment aussi
deux équipes mobiles intervenant dans les étages. Un
nouveau chef de service de médecine oncologique per-
met de pérenniser la structure, par un engagement médi-
cal fort, en lien avec les autres disciplines médicales
(radiothérapie, chirurgie). L’objectif de l’UFSOS est de
favoriser la prise en charge globale, de développer l’ex-
pertise, d’apporter son assistance aux équipes pour
qu’elles assurent la continuité des soins, en éduquant,
en informant et en formant les personnels. Elle doit deve-
nir partie intégrante du fonctionnement de tous les ser-
vices d’hospitalisation. Il faut garder l’optique de la tra-
çabilité pour permettre une continuité des soins, une
valorisation financière par le séjour, le développement
de projets, de recherches, des formations.
En parallèle se fait la fusion avec l’Institut Curie qui
devient un établissement de soins sur trois sites : Paris,
Orsay et Saint Cloud.
La mise en œuvre du service des Soins de support
est lancée en 2009 avec un cadre de santé dédié, Mme H.
et un médecin référent, le Dr B. Est créé un guichet
unique qui centralise les demandes en soins de support
de tout l’établissement, ainsi qu’un espace physique
grâce à la fermeture de lits en médecine transformés en
service dédié à l’accueil des patients et au travail en mul-
Expériences n°1-12:nouvelles AFIC n°1vol5 03/05/12 14:00 Page10
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 02/06/2017.

E xpériences
11
Bulletin Infirmier du Cancer Vol.12-n°1-janvier-février-mars 2012
tidisciplinarité. L’UFSOS est officielle en mars 2010, deve-
nant plus visible dans son action par l’ouverture de l’HDJ
SOS le 28 février 2011.
L’UFSOS s’élargit progressivement avec le recrute-
ment de personnels dédiés, qui se retrouvent dans un
même lieu pour se réunir, partager et se former. Après
explications pédagogiques sur le projet, les profession-
nels apprennent à travailler ensemble, à structurer et à
tracer leurs actes, à faire des évaluations de leurs pra-
tiques, ce qui n’était pas dans leur mode de fonction-
nement initial. Cette évolution de leur organisation leur
permet d’être plus visibles, mieux reconnus. Cela
entraîne aussi une coordination plus efficace car les inter-
venants ont un médecin prescripteur, et ont aussi la pos-
sibilité d’échanger sur la pertinence des prises en charge.
Ils ne sont plus interpellés dans les couloirs ou au télé-
phone pour des demandes d’intervention ponctuelles
car ce sont les secrétaires du guichet unique qui récep-
tionnent les demandes et les répercutent vers les pro-
fessionnels concernés, ce qui permet de gagner du temps
et d’éviter les oublis.
Auparavant, certains professionnels étaient très iso-
lés, ils se sentaient des « satellites », car ils gravitaient
autour des patients sans être impliqués de façon conti-
nue et réfléchie dans leur prise en charge. Il en résultait
une grande souffrance car ils pouvaient être les témoins
impuissants d’impasses thérapeutiques. Depuis la réor-
ganisation, une fiche de critères planchers a été établie,
permettant de mieux cibler les besoins de support des
patients. L’HDJ SOS est organisé de façon à ce qu’un
rendez-vous ne soit déclenché que si certains de ces cri-
tères sont présents, soit un acte technique de courte
durée (ponction, transfusion), soit trois besoins néces-
sitant l’intervention d’un professionnel de l’UFSOS. La
durée d’hospitalisation d’une demi-journée donne le
temps de cheminer avec le patient, de lui permettre
d’être entendu. Les besoins d’intervention ciblés pas-
sent aussi par le guichet unique qui centralise les
demandes et organise les interventions.
Le patient suivi en HDJ SOS voit la différence car
désormais, les professionnels viennent à lui -et non l’in-
verse- et ils le prennent en charge de façon globale, en
incluant son entourage, en faisant le bilan de tous les
problèmes qui se posent dans sa vie. Il est reçu en
chambre individuelle, confortable, dans le calme, en
dehors du contexte de traitement, des thérapeutiques,
de la chimiothérapie, ce qui lui permet de préserver son
intimité. C’est un temps de pause dans le parcours du
patient, pour lui, sa famille et les médecins en charge,
que ce soit le médecin traitant ou l’oncologue référent.
Cela amène un point de vue extérieur pour les praticiens
avec des échanges professionnels sur les pratiques et
les conduites à tenir. Les infirmières diplômées d’état
(IDE) intervenantes à l’HDJ SOS sont aussi dans l’équipe
de l’HDJ d’oncologie médicale, ce qui fait qu’elles
connaissent bien les patients, la structure, le circuit, et
ce sont souvent elles qui lancent les alertes qui amènent
à proposer aux patients de consulter une demi-journée
à l’HDJ SOS. Les IDE qui travaillent en HDJ SOS sont
volontaires, formées aux spécificités des autres corps de
métier qui composent les soins de support au décours
de visites d’autres unités de ce type à l’institut Gustave
Roussy et à l’institut Curie à Paris. Elles apprennent sur
le terrain à travailler avec les réseaux de ville et les pres-
tataires, ce qui élargit leur pratique.
L’hôpital de jour en soins
oncologiques de support
fête son premier anniversaire
Ces derniers douze mois ont été riches en émotions
et en événements. À l’ouverture du centre, des cas très
lourds de patients en échec de prise en charge ont été
proposés par les services d’hospitalisation. L’équipe de
l’UFSOS a connu des difficultés à organiser des suivis
pour ces patients déjà très malades qui attendaient beau-
coup d’une structure encore à ses débuts. Les équipes
soignantes et médicales des services d’hospitalisation
peuvent parfois se sentir dépossédées de la décision
concernant la prise en charge, car la responsabilité est
portée par l’UFSOS. Il a fallu donc réinventer une nou-
velle façon de partager les rôles, apprendre pour les
équipes mobiles à ne pas se substituer aux équipes cli-
niques tout en luttant contre les représentations des soins
palliatifs qui font qu’on les appelle parfois un peu trop
tardivement.
Les professionnels intégrés à l’UFSFOS ont aussi dû
apprendre à travailler ensemble, de façon complémen-
taire. Plusieurs d’entre eux ont témoigné avoir décou-
vert un nouvel aspect du travail en équipe, basé sur la
communication et le suivi du patient jusqu’au bout. Cela
conduit à une nouvelle perspective du rôle de chacun,
particulièrement aux postes réputés administratifs,
comme celui de Mme L., secrétaire médicale : « Ce que
j’ai entrepris a fait une différence. Je me sens utile. Le
Expériences n°1-12:nouvelles AFIC n°1vol5 03/05/12 14:00 Page11
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 02/06/2017.

E xpériences
12
Bulletin Infirmier du Cancer Vol.12-n°1-janvier-février-mars 2012
patient se sent accueilli, c’est aussi gratifiant pour lui,
car il n’a pas à répéter son histoire à chaque intervenant.
Il se sent exister. Il est installé en chambre, reçoit le méde-
cin qui vient à lui ».
D’autres ont investi l’UFSOS comme une unité d’es-
pace, grâce aux rencontres d’équipe, avec une réunion
hebdomadaire sous une forme plus clinique. Cela a per-
mis une meilleure visibilité des compétences de façon
concrète pour des professionnels habitués à travailler
seuls. Par exemple, la psychologue, Mme D. a découvert
que les assistantes sociales menaient des entretiens d’aide
au retour à l’emploi. « C’est un espace de confiance qui se
crée » souligne-t-elle. Certes, des conflits de personnalité
ont surgi dans les premiers mois, mais la gestion de ces
conflits a donné lieu à de vraies relations. D’autant que
les embauches, particulièrement en soins palliatifs, ont
été longues et marquées par une succession d’interve-
nants, ce qui a compliqué la mise en place des projets.
Le travail en équipe est le pilier de cette équipe, mené
par un binôme soignant-médecin. Le Dr B. a su fédérer
l’équipe, chacun à sa place, à sa valeur propre. Elle a
redonné de la visibilité et du dialogue. « Avant, il y avait
un sentiment de solitude immense en salle. Maintenant,
on sent un soulagement » dit-elle. Avec Mme H., elle a
investi du temps pour la formation du personnel, par
exemple une intervention sur la loi Leonetti faite par le
Dr L., médecin de soins palliatifs, un rappel juridique
très apprécié par les diététiciennes. Il y a eu des défini-
tions de poste réalisées, pertinentes, en relation avec les
autres métiers en présence. Ce mode relationnel de
proximité est souligné par l’ensemble des interve-
nants qui soulignent un travail d’équipe en toute bien-
veillance, malgré des tensions naturelles au sein d’une
équipe qui apprend à fonctionner ensemble. Valoriser
les capacités personnelles, les connaissances et les com-
pétences de chacun permet d’apporter un espace de
confort pour les professionnels, ce qui améliore celui
fourni aux patients.
Même avec une approche aussi attentive, travailler
dans cette unité expose à des situations de soins diffi-
ciles. Cela impose une maturité personnelle et profes-
sionnelle, ainsi qu’un soutien au quotidien, apporté en
partie par la présence des autres membres de l’équipe.
Comme l’explique Mme P., entérothérapeute : « L’UFSOS
était exactement ce qu’il me manquait, un point de rat-
tachement : ne plus courir après un référent, un chirur-
gien. J’ai un médecin et une équipe qui travaille avec
moi. Partager sur les patients, sur les points de vue,
décharger au niveau émotionnel. ». Mais cela n’est pas
suffisant. L’activité a énormément augmenté, le manque
de personnel est toujours d’actualité. Grâce au change-
ment de fonctionnement lié à l’UFSOS, le burn-out est
temporisé mais non réglé, car il n’y a pas encore de
supervision psychologique pour le personnel. De sur-
croît, plus l’UFSOS est connue, plus les services d’hos-
pitalisation la sollicitent, et encore plus de besoins se
créent.
Outre l’aspect relationnel, il y a l’aspect organisa-
tionnel. Le guichet unique, standard téléphonique et
physique regroupant toutes les demandes, est plébis-
cité pour sa praticité et sa réactivité. Les intervenants
sont mieux à même de gérer leur planning. Mais il leur
est aussi demandé de projeter leur activité dans un terme
plus lointain, d’élaborer des objectifs, des formations. Il
existe désormais au sein de l’établissement des IDE et
des aides-soignants, relais en Douleur et Dénutrition au
sein des équipes cliniques, assurant le dépistage des
problèmes de santé au plus près des patients.
La « réunionite » est aussi un nouvel aspect de l’exer-
cice sur le terrain. Pour un professionnel habitué à tra-
vailler seul, s’astreindre régulièrement à s’asseoir autour
d’une table pour discuter de sa pratique peut être dérou-
tant, voire considéré comme trop chronophage et inutile.
Pourtant, cela amène à une prise de distance et à une
meilleure vision d’ensemble. Cela a ainsi permis de déve-
lopper la prise en charge de la kinésithérapie systéma-
tique des lymphœdèmes, de lancer un projet de proto-
cole d’ostéothérapie avec un étudiant ou l’éducation
thérapeutique.
Les assistantes ont développé leur polyvalence, car
elles se remplacent mutuellement lors des absences pour
les consultations spécialisées. Elles sont les pivots de
toutes les demandes téléphoniques et par fax, assurant
aussi la gestion des alertes gérontologiques, par le biais
des suivis des questionnaires systématiques. Elles ont
ainsi permis de libérer du temps soignant.
La volonté de l’encadrement d’inclure l’équipe à des
formations en tant que participants, puis en tant que
témoins de leur expertise auprès des équipes cliniques
modifie la dynamique du groupe. Chacun devient acteur.
Cela se ressent au niveau des services cliniques, les
médecins ont une meilleure lisibilité des atouts de l’UF-
SOS, ils ont le réflexe d’envoyer les patients pour gérer
leurs symptômes, même en dehors du contexte curatif,
avec toutefois des disparités dans la hiérarchie des
demandes. Les femmes médecins sont ainsi plus sensi-
Expériences n°1-12:nouvelles AFIC n°1vol5 03/05/12 14:00 Page12
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 02/06/2017.

E xpériences
13
Bulletin Infirmier du Cancer Vol.12-n°1-janvier-février-mars 2012
bilisées à l’impact négatif de la prise de poids lors
d’un traitement par hormonothérapie tandis que les
médecins hommes sont plus souvent attentifs à la dénu-
trition.
Le problème récurrent est la gestion des problèmes
de santé aigus transitant par l’HDJ SOS. Il y a une impres-
sion négative des équipes cliniques qui ne comprennent
pas le rythme de l’HDJ (2 à 4 patients/jour) et qui espé-
raient un allègement de leur prise en charge palliative
en service. Or, il y a plusieurs hospitalisations en non
programmé venant des lits de l’HDJ SOS en direction
des services classiques pour des patients pour qui le
dépistage n’a pas été possible. Un service de régulation
est en projet pour permettre de gérer les urgences rela-
tives.
Deux fois par mois se tient une réunion de concer-
tation pluridisciplinaire SOS, avec proposition « démo-
cratique » des dossiers à traiter. Chaque membre de
l’équipe peut proposer et discuter sur un pied d’égalité.
C’est d’ailleurs un des défis posés par ce nouveau mode
de collaboration interdisciplinaire : libérer la parole,
autoriser les opinions contradictoires au service d’une
prise en charge multilatérale. Se confronter à différents
points de vue et allier toutes les expertises enrichissent
la stratégie et le choix thérapeutique.
Sur un an, les retours des professionnels impliqués
avec qui j’ai pu m’entretenir sont très positifs. Ils disent
avoir pu réinvestir leur fonction avec une énergie nou-
velle, ils ont apprécié de pouvoir travailler ensemble en
gardant leur spécificité. Un trait commun a été la pers-
pective sur le long terme suscitée par l’encadrement :
élaborer des projets et des formations ne fait pas partie
du fonctionnement classique de professionnels de ter-
rain. Le long terme implique un retour sur investisse-
ment plus long et n’entre généralement pas dans l’or-
ganisation des soins. C’est pourtant un axe prioritaire de
cette unité de soins.
Le fait d’être dans la structure des Centres de lutte
contre le cancer (CLCC) est un plus, car la fédération est
porteuse d’une expertise cancérologique et permet de
disposer de temps et de ressources, ce qui permet syn-
thèse et échange. Dans un futur proche, il y aura un rap-
prochement hiérarchique entre les deux unités DISSPO
(Paris) et UFSOS (St-Cloud). On en escompte un enri-
chissement par l’expérience plus ancienne du site de
Paris, tout en pariant sur l’unification des pratiques de
deux établissements n’ayant pas la même organisation.
Il sera alors dans les projets du service de poursuivre sur
la prise en charge après cancer (avec le PPSAC Plan Can-
cer II), tout en continuant le travail sur le parcours patient
avec le dispositif d’annonce et les consultations infir-
mières spécialisées. La spécificité de l’Hôpital René
Huguenin est aussi l’existence de la Maison des Patients,
ouverte depuis 2006, qui permet d’accueillir patients et
proches pour des ateliers divers, de l’information, du
soutien, et les « entretiens d’Hippocrate », qui sont des
conférences pour tous publics. Les intervenants de l’UF-
SOS sont régulièrement appelés à y intervenir.
Et demain ?
Les défis de l’UFSOS sont nombreux : développer la
formation du personnel afin de permettre un signale-
ment plus précoce et mieux ciblé, embaucher des soi-
gnants formés et compétents en plus grand nombre,
avoir des équipes sensibilisées à toutes les formes de
marginalisation inhérentes à la maladie et aux traite-
ments (perte d’emploi, SDF, patients payants), disposer
de locaux plus centraux et plus vastes, construire des
partenariats (appartements thérapeutiques, réseaux ville-
hôpital), élargir le suivi téléphonique pour éviter les hos-
pitalisations et augmenter le confort du patient grâce au
maintien à domicile.
Le futur de l’UFSOS est dans l’élargissement aux
médecines complémentaires, avec déjà une consulta-
tion en auriculothérapie, et l’ouverture en consultation
spécialisée en externe.
Reste une inconnue. Un petit pourcentage de patients
refuse l’assistance de l’unité, sans que cela ait été encore
évalué. Il serait intéressant d’investiguer les raisons du
refus et les représentations de l’UFSOS.
Les phénomènes de maltraitance et d’euthanasie sont
toujours en filigrane dans les établissements de soins, et
particulier dans les pathologies de longue durée, au
niveau des soignants comme des aidants qui sont en
demande. Les équipes de soins ont travaillé sur la « bien-
traitance » et élaboré une charte pour le respect de la
personne soignée. Le travail de patience est initié au sein
de l’établissement afin que la culture de l’accompagne-
ment s’implante dans les mentalités, sans que le per-
sonnel ne soit en souffrance.
Un grand merci à la Direction des soins de l’institut
Curie qui m’a permis de mener ces entretiens, ainsi
qu’à tous les intervenants qui ont trouvé le temps de me
recevoir.
Expériences n°1-12:nouvelles AFIC n°1vol5 03/05/12 14:00 Page13
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 02/06/2017.
1
/
5
100%