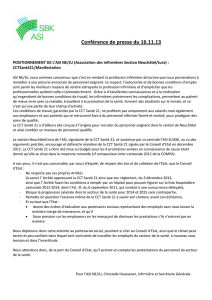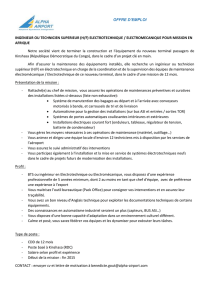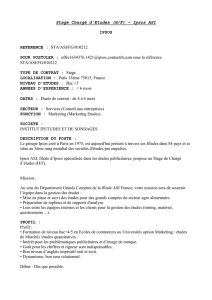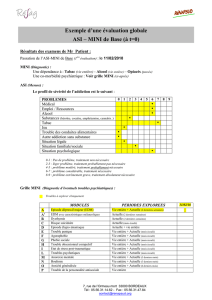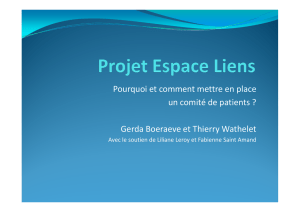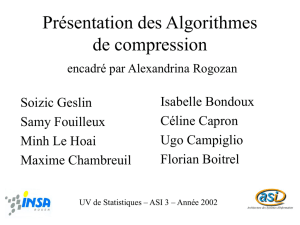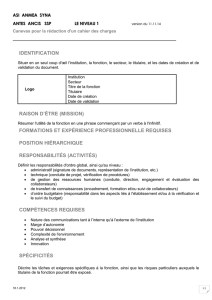Lire l`article complet

200
MISE AU POINT
Le but de l’Addiction Severity Index ou
ASI, une grille d’entretien destinée à l’éva-
luation des consommateurs de drogue(s) ou
d’alcool (10), est de recueillir des informa-
tions factuelles aussi pertinentes pour l’ap-
préciation de l’état clinique des sujets que
pour la recherche.
Les caractéristiques de l’ASI en font un
instrument d’évaluation de qualité et très
complet tout en restant maniable et simple
d’utilisation.
L’ASI est multifactoriel
Conçu pour évaluer les différents pro-
blèmes rencontrés chez les personnes
dépendantes de la drogue ou de l’alcool, il
appréhende à lui seul l’ensemble de la
situation biopsychosociale. Les informa-
tions concernant la consommation de
toxiques ont en effet été limitées afin de
pouvoir s’en décentrer pour tenir compte des
autres facteurs intervenants dans la toxico-
manie ou l’alcoolisme, et pouvant avoir une
incidence sur l’issue du traitement.
Il s’organise ainsi en plusieurs sections
indépendantes les unes des autres : état
médical, emploi et ressources, drogue,
alcool, situation légale, relations familiales
et sociales, état psychologique.
Son caractère multifactoriel permet à l’ASI
de tracer une image à facettes en différen-
ciant davantage les secteurs susceptibles
d’être problématiques pour le sujet. Les
aides et traitements proposés peuvent alors
cibler les grands domaines de la qualité de
vie affectés. Cela permet de s’orienter vers
une prise en charge globale, qui peut être
plus efficiente.
L’ASI est semi-structuré
L’ASI n’est pas un questionnaire fermé
mais une grille d’entretien. Il est semi-
structuré, et par là même, satisfaisant pour
le patient comme pour l’interviewer.
Il doit permettre au sujet de s’exprimer à pro-
pos des divers thèmes abordés. Celui-ci y
voit alors une occasion de faire le point de
façon coordonnée, guidé par l’interviewer.
L’ ASI privilégie la relation interpersonnelle,
il est l’occasion d’un échange pendant
lequel le sujet se sent considéré, investi, de
par l’intérêt global qu’on lui accorde.
Le fait de prendre en compte l’évaluation
qu’il fait lui-même de son état contribue à
l’impliquer dans la démarche de soin en lui
donnant un rôle actif (11).
De son côté, l’interviewer est responsabilisé
dans son travail de recueil de données. De
par la structure de l’ASI, il doit, par
exemple, être en mesure de reformuler les
questions pour atteindre l’information
recherchée, de revenir à une section dépas-
sée si elle n’est pas corroborée par les nou-
velles réponses du sujet.
L’ASI est fiable et valide
Les nombreuses études effectuées depuis
1979 sur la version en anglais, puis sur les
traductions dans d’autres langues, dont en
français, ont pu démontrer que ses caracté-
ristiques psychométriques satisfaisaient
aux critères scientifiques les plus exigeants
(1, 5-9).
La cinquième version, que nous utilisons
dans son adaptation française, est le résul-
tat d’un souci d’intégration des nouvelles
habitudes de consommation et des der-
nières connaissances issues de la recherche
clinique en toxicomanie.
Le cadre de l’entrevue décrit plus haut faci-
lite la coopération du sujet et la fiabilité de
ses réponses.
Au niveau du traitement statistique, l’ASI
est utilisable au-delà de la simple lecture de
la grille puisque ses données sont facile-
ment informatisables dans des logiciels
spécifiques ou plus répandus comme EPI
INFO ou EXCEL (3).
L’ASI est détaillé et précis
Il autorise une meilleure connaissance des
consommateurs de drogue(s) et d’alcool
grâce à un total de 240 items répartis sur
ses sept sections. Son originalité est d’inté-
grer l’auto- et l’hétéro-évaluation, ainsi que
deux grandes périodes de référence (toute
la vie et les trente derniers jours). Il réalise
donc une évaluation complexe tenant
compte de l’opinion du sujet et de celle de
l’interviewer, des informations objectives
et subjectives, du passé et de l’état actuel.
L’ASI est standardisé
Il propose des évaluations chiffrées, per-
mettant ainsi d’établir des profils descrip-
tifs afin de mieux connaître une clientèle
Sarah Brisseau, Marc Auriacombe, Pascale Franques,
Jean-Pierre Daulouède, Jean Tignol*
L’ A ddiction severity index
* Groupe d’étude des toxicomanies, labora-
toire de psychiatrie, université Victor-Segalen
Bordeaux 2 et institut fédératif de recherche
biomédicale en neurosciences cliniques et
expérimentales, INSERM-IFR n° 8, CNRS-FR
n° 13, Bordeaux.
Unité de Soins pour Addictions, Service
Universitaire de Psychiatrie, CH Charles-
Perrens et CHU de Bordeaux.
Correspondance : Marc Auriacombe, Centre
Carreire, 121 rue de la Béchade, 33076
Bordeaux Cedex.
marc.auriacombe@labopsy.u-bordeaux2.fr
Le Courrier des addictions (1), n° 5, décembre 1999
Conçu à Philadelphie en 1979 comme grille d’entretien destinée
à l’évaluation des consommations de drogues ou d’alcool, l’in-
dex de sévérité de l’addiction (ASI) a été introduit en France par
cette équipe bordelaise. Il est actuellement utilisé dans sa cin-
quième édition version française. Un véritable outil d’apprécia-
tion et de suivi de l’évolution des patients.

201
ou de la comparer à d’autres populations de
sujets toxicomanes ou alcooliques, rencon-
trés dans d’autres centres de soin ou évo-
luant dans des contextes géographiques,
culturels et linguistiques différents (4).
Les réponses du sujet sont codées selon des
modalités simples et efficaces. Dans
chaque section, des informations objectives
et subjectives sont utilisées pour obtenir un
score composite calculé mathématique-
ment et un score de sévérité évaluant la
sévérité des problèmes et le besoin en trai-
tement spécifique.
L’ASI peut se répéter
En utilisant un nombre réduit d’items et à
trente jours minimum d’intervalle, l’inter-
viewer peut faire un suivi en 15 à 20
minutes. Il peut ainsi évaluer l’évolution
des problèmes rencontrés en bilan de base
et apprécier l’efficacité des soins proposés
depuis.
L’ASI est facilement partageable
La standardisation du recueil des données
lui donne l’avantage de toujours fournir des
informations basées sur les mêmes para-
mètres, quel que soit l’interviewer ou le
sujet ; cela facilite la consultation sélective
de la grille d’entretien selon les besoins du
moment.
Les intervenants apprécient de pouvoir par-
tager un langage commun dans l’évocation
des problèmes de leurs patients ; l’ASI
favorise ainsi les échanges cliniques et le
partage des expertises (11).
S’ils le souhaitent, ils peuvent être formés à
la passation et à la cotation de l’ASI en
deux journées seulement et sans qu’aucune
qualification particulière ne soit requise.
Et ce tant au niveau de la clinique qu’à
celui de la recherche.
L’ASI est un outil pertinent
Dans le champ clinique, il fournit une éva-
luation de premier ordre pour les patients
admis en traitement et une référence com-
mune descriptive de la situation des consul-
tants. Les informations sont utilisées par
l’équipe soignante pour asseoir et préciser
l’indication des traitements, pour orienter
le cadre thérapeutique et le réajuster tout au
long de la prise en charge, ou encore à des
moments critiques de la vie du sujet.
Dans le champ de la recherche, il se présente
comme un outil capable de caractériser préci-
sément des populations de sujets toxicomanes
ou alcooliques. C’est en cela un instrument
particulièrement pertinent dans la recherche
épidémiologique concernant les addictions,
que l’on se situe à un niveau descriptif, analy-
tique ou évaluatif. Il est particulièrement
adapté à l’étude de l’impact des traitements.
Sa diffusion à l’échelle mondiale permet des
comparaisons transculturelles.
Qui peut faire passer un ASI ?
Tout professionnel susceptible de rencon-
trer des personnes dépendantes d’une sub-
stance est un utilisateur potentiel de l’ASI.
Pour cela il faut prendre connaissance de
ses modalités d’utilisation. Outre la lecture
approfondie des manuels d’instruction
pour la passation de l’ASI, la formation
directe par une personne ayant déjà une
bonne connaissance de l’instrument et une
pratique personnelle apparaît indispensable
si l’on veut faire des ASI qui soient rapide-
ment valables. C’est dans cet esprit que, dès
1995, notre équipe a mis son expérience à la
disposition des professionnels de la prise
en charge des personnes dépendantes de
substances et des chercheurs, dans le cadre
de formations de base de deux jours, et de
formations individuelles adaptables aux cas
particuliers (voir encadré). Nous sommes
également disponibles pour les questions
qui peuvent survenir une fois la formation
de base effectuée, dans la pratique réguliè-
re de l’ASI (“hot line”).
Un plan de formation spécifique
Les sessions de formation peuvent être individuelles (il s’agit alors de la formation intensive
d’un stagiaire en une journée) ou se dérouler en groupe de dix à quinze stagiaires sur une
durée de deux journées consécutives.
Les stages de formation de deux jours comprennent :
– un historique de la conception de l’ASI jusqu’à la cinquième version traduite et adaptée à
la langue française ;
–un point sur les qualités psychométriques et études de validation de l’instrument ;
–une étude détaillée de l’outil, de ses manuels et des techniques de passation et de codifica-
tion item par item ;
–la présentation de l’ASI à un sujet ;
–le calcul des scores de sévérité ;
– la procédure des ASI de suivi ;
–un point sur les procédés d’informatisation ;
–un entraînement à la passation et à la codification de la grille à l’aide de vidéos et autres ins-
truments pédagogiques ;
–une initiation à d’autres instruments.
À la fin de la formation, une attestation de présence au stage est remise au participant. Celui-
ci a la possibilité de nous adresser ses premières grilles dans le cadre d’un suivi de contrôle
qualité. Ceux qui se soumettent à cet exercice avec succès reçoivent une attestation indiquant
qu’ils sont compétents comme interviewers ASI.
Frais de formation : 1 750 FF HT
(290 euros) par personne.
Possibilité de prise en charge des frais dans le cadre de la formation continue. Possibilité
d’aide pour les cas particuliers. Tarifs forfaitaires pour la formation sur site du personnel d’un
même centre.
Les formations ont lieu dans toute l’Europe francophone.
Demande de renseignements et informations complémentaires par courrier électronique à :
<sarah.brisseau@labopsy.u-bordeaux2.fr>.

202
MISE AU POINT
Comment adapter l’utilisation
de l’ASI à mes besoins ?
Deux exemples d’utilisation
Intégré dans le cadre clinique normal
d’un centre de soins
C’est la situation la plus fréquente. L’ASI est
proposé à tous les primo-consultants. La pas-
sation est alors effectuée par les personnes qui
interviennent en première ligne. L’ASI peut
encore n’être proposé qu’aux seules per-
sonnes qui sont orientées vers une prise en
charge. Il peut alors être effectué par les per-
sonnes qui assurent ces prises en charge (édu-
cateurs, assistants sociaux, psychologues,
médecins). Une fois le premier ASI effectué,
l’instrument vaut d’être à nouveau complété
tous les trimestres, semestres ou années, pour
suivre l’évolution du sujet. Utilisé ainsi, l’ASI
s’intègre très bien dans le fonctionnement
normal d’un centre de soins pour toxico-
manes, ou d’un centre de consultation pour
alcooliques. Dans la mesure où il a été effec-
tué par ceux-là mêmes qui en font usage et
s’occupent directement du consultant, il per-
met de collecter d’emblée les informations
indispensables dans une vue globale de la
situation qui est toujours très appréciée des
consultants eux-mêmes.
Utilisé comme instrument principal
dans le cadre de la recherche
Dans le cadre formel d’un protocole de
recherche qui inclut des personnes dépen-
dantes, l’ASI devrait être pratiqué par des
interviewers qui n’interviennent pas auprès
des sujets par ailleurs, notamment dans le
cadre de leur prise en charge ou dans celui du
protocole s’il s’agit d’une étude sur les pro-
cessus de soin ou sur les techniques relation-
nelles de prise en charge. Il s’agit alors d’une
évaluation externe qui répond aux exigences
de la méthodologie de la recherche clinique.
Les critiques et
les limites de l’ASI
Oui, c’est bien, mais on n’a pas le
temps, on n’a pas le personnel
Il s’agit souvent d’un problème dû à un
malentendu ou à une mauvaise informa-
tion. Un premier ASI, complété avec un
sujet inconnu, dure en moyenne de 40 à
60 minutes, et un ASI de suivi rarement
plus de 20 minutes. Lorsque, en tant que
professionnel, on rencontre un patient qui a
un problème d’alcool ou de toxicomanie, il
est difficile de passer moins de temps avec
lui. Dans la pratique clinique, l’ASI repré-
sente un gain de temps pour le clinicien qui
l’utilise car il permet une documentation
exhaustive du dossier. Le temps de passa-
tion de l’ASI s’intègre alors à la prise en
charge normale, il ne vient pas en plus.
Quand l’état du patient ou le contexte de sa
rencontre ne permet pas de compléter l’en-
tretien, il est possible de proposer une
pause ou de le reporter au lendemain.
On ne s’appuie que sur ce que dit le
patient. Cela n’a pas de valeur
En fait, la valeur de ce que rapportent les
personnes dépendantes, autant que les usa-
gers de drogues, est une question de condi-
tions d’entretien. Les études de validité
montrent une excellente corrélation entre
ce qui est collecté au cours de l’interview et
le dosage urinaire. Il est en effet utile de
compléter l’ASI par un dosage urinaire ;
celui-ci, lorsqu’il est clairement expliqué et
que son utilisation est thérapeutique, est
très bien accepté et apprécié des personnes
dépendantes (2).
C’est trop limité. Certains domaines ne
sont pas explorés. Il n’y a rien
concernant la consommation de tabac
Si les questions de l’ASI ne peuvent être
modifiées, il est en revanche tout a fait pos-
sible de compléter l’entretien par des ques-
tions adaptées aux besoins locaux. La
consommation de tabac peut être explorée
par des questions appropriées dans la sec-
tion drogue/alcool. Les utilisateurs de
l’ASI peuvent y associer tous les instru-
ments qui leur sembleront apporter un
complément d’information ou préciser un
domaine d’intérêt particulier.
Conclusion
Depuis sa création en 1979, l’ASI est devenu
l’un des outils les plus utilisés au monde dans
son domaine, répondant aussi bien aux
besoins des équipes cliniques qu’aux exi-
gences de la recherche.
Il s’est efficacement adapté à son objet
d’étude en fournissant une évaluation globale
et synthétique de la toxicomanie et des pro-
blèmes qui y sont associés.
Il recueille des informations qui peuvent être
comparées sur les plans descriptif, clinique, et
culturel. Il est efficace et efficient compte tenu
du rapport temps de passation/quantité et qua-
lité des données recueillies.
Le groupe d’étude des toxicomanies du labo-
ratoire de psychiatrie a été son premier utilisa-
teur français à bénéficier d’interviewers for-
més directement par l’équipe des inventeurs
de l’ASI (A.T. McLellan et coll., Université de
Pennsylvanie à Philadelphie, États-Unis).
Nous en assurons une diffusion la plus large
possible, en proposant aux équipes qui le sou-
haitent l’ensemble des services nécessaires à
son utilisation : l’instrument, les manuels, les
sessions de formation, le contrôle qualité. Le
maintien de la collaboration avec Philadelphie
ainsi qu’avec les premiers utilisateurs franco-
phones québécois (RISQ, Montréal) participe
au maintien de la qualité et à la communica-
tion internationale sur les dépendances.
Le Courrier des addictions (1), n° 5, décembre 1999
Références bibliographiques
1. Bergeron J., Landry M., Ishak I.
Validation d’un instrument d’évaluation
de la gravité des problèmes reliés à la
consommation de drogues et d’alcool,
l’Indice de gravité d’une toxicomanie
(IGT). Québec : ministère de la Santé et
des Services sociaux 1992.
2. Bonnand B., Auriacombe M.,
Franques P., Bertorelle V., Afflelou S.,
Daulouède J.P., Combourieu I., Tignol J.
Évaluation de l’usage des psychotropes à
partir d’échantillons urinaires chez des
sujets s’adressant pour la première fois à
une consultation spécialisée pour toxico-
manie opiacée. La Presse Médicale
1999 ; 28 : 1-4.
3. Grabot D., Brisseau S., Martin C.,
Franques P., Bertorelle V., Auriacombe

203
M., Tignol J. L’Addiction Severity Index :
formation, informatisation et recherche.
Synapse 1996 ; 131 : 33-6.
4. Grabot D., Landry M. l’ASI/IGT
pour l’élaboration d’une base de don-
nées interculturelle. In : Guyon L.,
Landry M., Brochu S., Bergeron J. Ed.
L’évaluation des clientèles alcooliques
et toxicomanes. Montréal : Les Presses
de l’Université Laval 1998 : 131-52.
5. Hendriks V., Kaplan C., Van
Llimbeek J., Geerlings P. The Addiction
Severity Index : reliability and validity
in a Dutch addict population. Journal of
Nervous and Mental Disease 1988 ; 6 :
133-41.
6. Hodgins D., El-Guebaly G. More
data on the Addiction Severity Index.
Reliability and validity with the Mentally
III Substance abuser. Journal of Nervous
and Mental Disease 1992 ;180 : 197-
201.
7. Kosten T., Rounsavielle B., Kleber H.
Concurrent validity of the Addiction
Severity Index. Journal of Nervous and
Mental Disease 1983 ; 171 : 606-10.
8. Martin C., Grabot D., Auriacombe
M., Brisseau S., Daulouède J.P., Tignol
J. Données descriptives issues de l’utili-
sation de l’Addiction Severity Index en
France. Encéphale 1996 ; 22 : 359-
63.
9. Mc Lellan A., Luborsky L., Cacciola J.,
Griffith J., Evans F., Barr H., O’Brien C.
New data from the Addiction Severity
Index : reliability and validity in three
centers. Journal of Nervous and Mental
Disease 1985 : 412-23.
10. McLellan A.T., Luborsky L., Woody
G.E., O’Brien C.P. An improved dia-
gnostic evaluation instrument for sub-
stance abuse patients, the Addiction
Severity Index. Journal of Nervous and
Mental Disease 1980 ; 168 : 26-33.
11. Menard J., Hamel-Jutras N.
L’IGT/ASI sur le terrain : l’expérience
d’intervenants provenant des centres
publics de réadaptation pour personnes
alcooliques et autres toxicomanes du
Québec. In : Guyon L., Landry M.,
Brochu S., Bergeron J. ed. L’évaluation
des clientèle alcooliques et toxico-
manes. Montréal : Les Presses de l’uni-
versité Laval 1998 : 67-81.
On se drogue au boulot aux États-Unis
Les toxicomanes ne sont pas forcément des marginaux, des exclus, des sans-travail. La
preuve vient d’en être révélée par le général Barry McCaffrey, le conseiller de la Maison-
Blanche pour la toxicomanie, qui vient de donner les résultats de l’enquête réalisée en
1997 pour le compte du ministère des Affaires sociales (Health and Human Services
Department.) auprès de 8 000 ouvriers ou employés de 18 à 49 ans, travaillant à temps
plein.Ainsi, 6,3 millions de salariés américains à temps plein, soit près de 8 salariés sur 100,
sont des utilisateurs de drogues. Parmi les branches les plus “touchées” par ce phénomè-
ne, on compte la restauration (19 % des salariés, en particulier les serveuses et les gar-
çons), la construction (14 %), les transports (10 %), et surtout dans les entreprises de
petites et moyennes dimensions qui emploient moins de 25 salariés (44 %).
4e colloque THS : dont
Actes
, très prochainement
Les colloques internationaux “Toxicomanies, hépatites, sida (THS) qu’organise tous les
deux ans la Société européenne toxicomanies, hépatites, sida (SETHS) ont pour objet l’étude
scientifique, médicale, sociale et culturelle des addictions, des hépatites virales et de l’in-
fection à VIH ainsi que les problèmes de société qui s’y rattachent, dont l’humanisme, la
solidarité et la fraternité constituent le dénominateur commun.
Le 4ecolloque THS4 a réuni du 2 au 6 juin 1999 à Draguignan et à Ramatuelle, 1 250 partici-
pants, d’horizons professionnels divers, représentant près de 30 pays, autour de 160 communi-
cations, réparties globalement autour d’une dizaine de thèmes parmi lesquels : les hépatites
virales (les hépatites C surtout), les nouvelles thérapeutiques (ribavirine), l’accès à celles-ci, le pro-
blème des femmes enceintes contaminées et des personnes incarcérées, des co-infections par le
VHC et le VIH ; les nouveaux traitements antiviraux du sida, leur mise en place précoce à titre
prophylactique, leur impact sur l’évolution de l’épidémie, l’adhésion ou non des patients, ou
encore l’impossibilité des pays en développement d’en bénéficier, le cas particulier des femmes
(grossesse, accouchement, allaitement et risques de contamination du nourrisson), les accidents
d’exposition au sang ; les usages de drogues et les toxicomanies abordés sous l’angle pharmaco-
logique, neurobiologique (plaisir, frustration, mécanismes moléculaires de la désensibilisation du
récepteur opioïde, etc.),sanitaire et médico-psychologique (comorbidités psychiatriques et infec-
tieuses, prises en charge dans le cadre d’une hospitalisation, d’une incarcération), répressif (inter-
pellations policières, pratiques judiciaires en direction des usagers de cannabis et de cocaïne, des
toxicomanes et des étrangers incarcérés) ; les traitements de substitution par la méthadone ou
par la buprénorphine HD des héroïnomanes (aspect physiologique, dosages du taux sanguin, pré-
valence de l’usage des benzodiazépines, facteurs de réussite et d’échec pour les usagers substi-
tués à la méthadone, problèmes rencontrés en prison notamment, mésusage) leurs perspectives
au niveau européen (législation, traitement, expérimentation d’un programme de distribution
d’héroïne en direction des héroïnomanes “lourds” en Suisse), etc. ; l’alcool (comportements
addictifs, hépatite C, association avec les benzodiazépines et passages à l’acte, etc.) et le tabac
(dépendance, traitements de substitution par le patch transdermique à la nicotine, rôle joué par
l’industrie du tabac dans la pandémie du tabagisme, etc.) ; les addictions comportementales non
chimiodépendantes (jeu, pratique intensive du sport, dopage) ; les stratégies de réduction des
risques et de prévention auxquelles un forum des associations était consacré (efficacité des trai-
tements de substitution en ce qui concerne la modification des conduites toxicomaniaques, le
nombre des délits commis ; prévention en prison mise en place d’un atelier tatouage, mobilisa-
tion de pharmaciens dans une campagne de réduction de risque, etc.) ; la législation (évolution
de la politique française, propositions et recommandations de la MILDT, législation sur les
drogues dans l’Union européenne).
Ces travaux seront, pour la plupart, rassemblés dans les Actes du colloque, outil d’infor-
mation, de travail et de réflexion, disponibles en novembre. Ils peuvent, dès à présent, être
réservés auprès de : la SETHS Le vieux mûrier, route de Tahiti, 83990 Saint-Tropez.
F.A.R.
Références bibliographiques
suite de la p. 202
1
/
4
100%