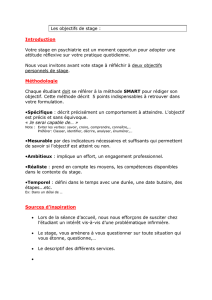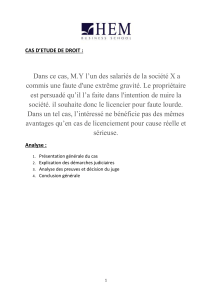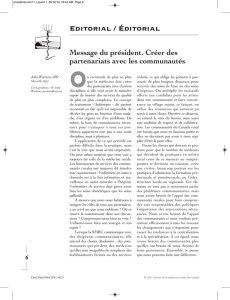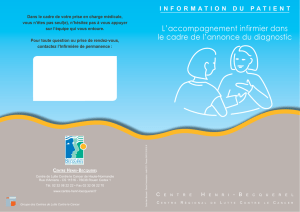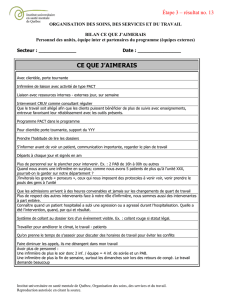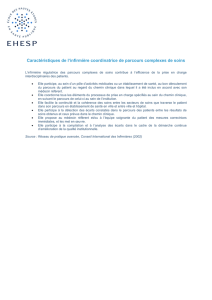Jurisprudence récente - Soins et surveillance en psychiatrie

Soins et surveillance en psychiatrie
1. Surveillance renforcée
en psychiatrie
Un patient est admis dans une cli-
nique pour subir un lavage d’esto-
mac après une tentative de suicide
par absorption de comprimés.
Connaissant des antécédents car-
diaques, il est admis dans le ser-
vice de cardiologie de la clinique,
selon la décision commune du
cardiologue et du psychiatre.
Le psychiatre envisage pour
le lendemain, en fonction du
contrôle de l’état cardiaque, un
transfert dans une unité psychia-
trique. Le personnel soignant
connaît ce contexte immédiat
mais n’a, en revanche, été informé
ni des antécédents dépressifs, ni
du risque de nouvelles tentatives
de suicide. Au demeurant, il n’a
pas été prescrit de surveillance
particulière. Il faut ajouter que,
compte tenu du risque cardiaque,
le service est le seul de la clinique
où peut être admis ce patient. Or,
ce service est situé en étage et, au
cours de la nuit, le patient se dé-
fenestre et se blesse grièvement.
Au moment des faits, un médecin
et une aide-soignante sont sur
place mais n’ont rien pu faire.
•Sur recours formé par le patient, la
responsabilité de l’établissement est
retenue.
Cour de cassation, 1re civ., 3 mars 1998, 96.13775.
Explication : Cette décision
constitue un rappel lucide des
principes. On relève trois fautes.
La première est d’avoir admis un
patient dans un établissement qui
n’est pas en mesure d’assurer la
surveillance adéquate compte
tenu de la configuration des lieux.
La deuxième est une faute de dia-
gnostic, le risque suicidaire ayant
été sous-évalué. La troisième est
une faute de prescription, aucune
surveillance particulière n’ayant
été prescrite.
Par contre, la surveillance infir-
mière n’est pas reconnue fautive,
aucune consigne particulière
n’ayant été donnée, et aucun signe
ne laissant présager un risque de
passage à l’acte. La clinique aurait
dû, dans cette phase critique, pro-
téger le patient contre lui-même.
2. Faute de diagnostic
et de surveillance
À la suite de manifestations vio-
lentes d’agressivité au sein de
la cellule familiale, un homme
connu pour de nombreux anté-
cédents psychiatriques est admis
au service des urgences de l’hôpi-
tal général le 21 août et placé
sous traitement neuroleptique
pour être transféré, dès le lende-
main, en centre spécialisé. Le mé-
decin psychiatre diagnostique
une schizophrénie paranoïde,
prescrit des traitements adéquats
et décide le maintien du patient
dans le service, mentionnant que
sa sortie est interdite, mais il re-
nonce à procéder à une hospitali-
sation sous la contrainte.
Une dizaine de jours plus tard, le
patient quitte furtivement l’éta-
blissement et se rend dans un
bâtiment voisin, d’où il se défe-
nestre, se blessant très griève-
ment. Dans le cadre du recours en
responsabilité engagé, les experts
confirment la schizophrénie para-
noïde avec effluescence délirante,
dépersonnalisation et hallucina-
tions. Selon eux, ce diagnostic
implique des risques élevés d’hé-
téro- ou d’auto-agressivité à un
degré tel qu’une hospitalisation
d’office aurait été nécessaire. En
outre, l’absence de surveillance
particulière de la part de l’équipe
infirmière, surveillance de nature
à prévenir une fuite inopinée,
constitue une seconde faute.
•Dès lors, l’hôpital est jugé res-
ponsable de l’entier préjudice subi
du fait de la défenestration.
Cour administrative d’appel de Paris, 11 juillet
1977, Jurisdata n° 0150923.
Explication : Il s’agit d’un rappel
des principes établis : il y a faute
dans le diagnostic, car une hospi-
talisation d’office aurait été néces-
saire, et faute dans l’organisation
du service du fait de l’insuffisance
de la surveillance. Les deux fautes
se conjuguent pour engager l’en-
tière responsabilité de l’établisse-
ment qui répond ainsi des fautes
cumulées du médecin psychiatre
et de l’équipe infirmière.
3. Surveillance d’un patient agité
Une patiente hospitalisée dans
une clinique psychiatrique pour
troubles dépressifs avec intoxica-
tion éthylique tombe de son lit et
se blesse. Pour contester sa res-
ponsabilité, la clinique évoque
l’important état d’agitation de la
patiente dû à une alcoolisation ai-
guë. La juridiction répond que cet
état d’agitation, loin d’exonérer la
clinique, établit la faute.
•L’équipe infirmière aurait dû choi-
sir des mesures adaptées de sur-
veillance, à commencer par l’instal-
lation d’un lit équipé de barreaux, le
cas échéant avec un dispositif de
contention.
Cour d’appel de Pau, 18 décembre 1996, RDSS
octobre 1997, p. 840.
Explication : Les établissements
de psychiatrie, publics ou privés,
connaissent une obligation de
surveillance renforcée, d’autant
plus marquée que le malade est
agité. Il s’agit de protéger le pa-
tient contre lui-même, ce qui sup-
pose un traitement approprié,
L’hospitalisation de personnes ayant des antécédents
psychiatriques plus ou moins graves mérite une
attention particulière. Plusieurs décisions font juris-
prudence quant à la surveillance soutenue de ces
patients, quel que soit le motif de leur admission.
Jurisprudence récente
46

Polémique
pouvant justifier des mesures de
contention. La contention est un
acte thérapeutique, non une me-
sure de répression. Elle doit être
utilisée avec discernement, mais
avec esprit de décision quand elle
s’avère nécessaire.
Quoi qu’il en soit, la contention,
comme la mise en chambre d’iso-
lement, ne peut pas être considé-
rée comme un acte banal. Il est
d’ailleurs particulièrement regret-
table qu’il n’existe pas de référence
législative, alors que, si la conten-
tion ou le placement en chambre
d’isolement peut s’avérer une né-
cessité, il n’en reste pas moins que
de telles décisions se situent à la li-
mite entre la protection de la santé
et l’atteinte aux droits des per-
sonnes. Sur plus d’une question,
on peut faire le constat de législa-
tion ou de réglementation sur-
abondante, d’une complexité telle
que ces textes paraissent inappli-
cables dès qu’ils sont édictés. Sur
d’autres, on constate au contraire
le désert législatif. Et s’il n’est pas
légitime de réclamer du droit écrit
à tout prix, il reste toutefois un
certain nombre de domaines pour
lesquels la marge d’initiative et les
dangers potentiels sont tels qu’un
cadre législatif est nécessaire. La
balle est dans le camp du législa-
teur. Si celui-ci renonce à s’en oc-
cuper, la réponse lui sera imposée
par les tribunaux, à l’issue de
contentieux audacieux engagés
par les personnes hospitalisées
elles-mêmes.
Gilles Devers
A en croire Daniel Cohn-Bendit, député européen,
Dominique Voynet, ancien médecin anesthésiste
aurait eu, à l’occasion du naufrage de l’Erika “une
réaction d’infirmière dans une situation de catas-
trophe”. La polémique politique qui a suivi suffit à
démontrer que le propos n’était pas élogieux. Et la
profession se pose alors la question : n’aurait-elle pas
été quelque peu diffamée ou injuriée ?
tion si l’on peut prouver que l’im-
putation est inexacte alors qu’il y
ainjure quand le propos très gé-
néral ne permet pas la preuve
contraire. La jurisprudence té-
moigne de la subtilité du débat :
traiter une personne de “reître” ou
de “flibustier” constitue une in-
jure, alors qu’utiliser le terme de
“repris de justice”est diffamatoire.
Ainsi, la profession infirmière a été
atteinte. En quelque sorte, elle
n’était pas la première visée mais
elle a reçu une balle perdue. Ceci
étant, a-t-elle été diffamée ou inju-
riée ? Pour le savoir, la meilleure
solution aurait été de saisir la jus-
tice, mais cette décision ne semble
pas relever d’une bonne thérapeu-
tique. Elle aurait pourtant été l’oc-
casion de rappeler au député ce
que disent les textes depuis bien
longtemps, à savoir que les soins
infirmiers “préventifs, curatifs ou
palliatifs”, qui sont de nature
“technique, relationnelle et éduca-
tive” ont pour objet de “protéger,
maintenir, restaurer et promouvoir la
santé des personnes ou l’autonomie
de leurs fonctions vitale, physique et
psychique, en tenant compte de la
personnalité de chacune d’elles dans
ses composantes psychologiques, so-
ciales, économiques et culturelles”. Le
texte précise encore que l’infir-
mière prévient et évalue la souf-
france et la détresse des personnes,
et participe à leur soulagement.
Cela aurait également été l’occa-
sion de souligner, comme l’a écrit
Catherine Duboys-Fresney, com-
bien ce propos témoigne de mé-
pris pour la profession : «Dans la
situation de Mme Voynet, les infir-
mières auraient eu beaucoup de
compassion et d’empathie. Elles au-
raient été très proches des popula-
tions, ce qui n’a pas été le cas ».
Bref, un propos déplorable qui
se situe dans une lignée bien
connue et qui justifie les ardeurs
de la profession à défendre sa
spécificité et ses compétences.
Que faut-il en conclure ? Peut-être
que Daniel Cohn-Bendit regarde
trop de mauvais films. Ou encore
qu’il a réagi comme un politique
devant une situation de souffrance
politique.
G. D.
47
L’infirmière et le député
La loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse définit la
diffamation comme “toute alléga-
tion ou imputation d’un fait qui porte
atteinte à l’honneur ou à la considé-
ration de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé”. L’atteinte à
l’honneur ou à la considération
n’est guère discutable. La considé-
ration, c’est l’idée que les autres se
font d’une personne. Porter attein-
te à la considération, c’est troubler
la position sociale. La libre critique
est possible, mais elle ne doit ni
atteindre l’honneur, ni tendre au
dénigrement. Des termes qui n’ont
pas en eux-mêmes de caractère
déshonorant peuvent le devenir
s’ils sont utilisés dans des “circons-
tances spéciales”.
Mais la diffamation suppose l’allé-
gation d’un fait précis, ce qui
marque la différence avec l’injure
qui, elle, ne renferme l’imputation
d’aucun fait. Ainsi, il y a diffama-
1
/
2
100%