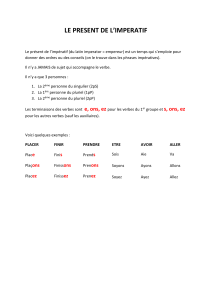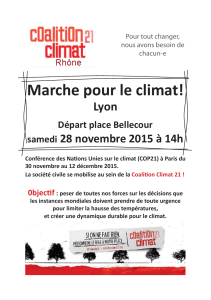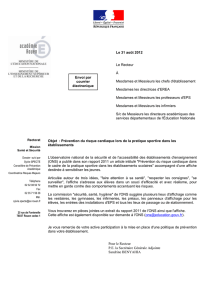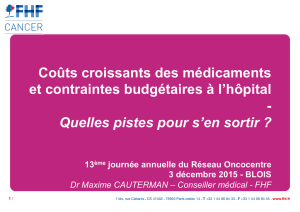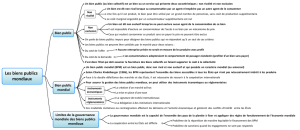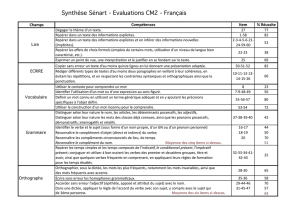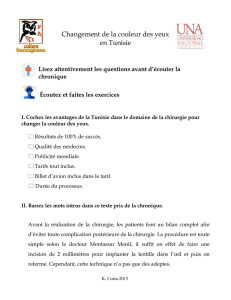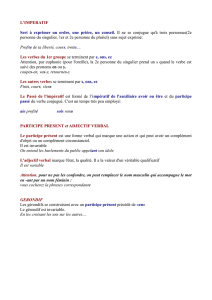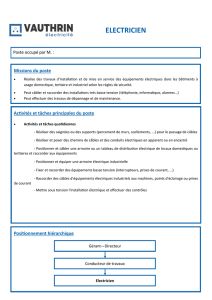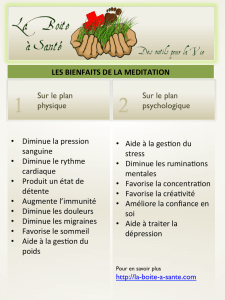Entrepreneuriat Vert - Green Growth Knowledge Platform

Une voie prome• euse vers un futur durable
en Tunisie et ailleurs
Publié par
Entrepreneuriat Vert

Men• ons légales
Publié par
Deutsche Gesellscha• für
Interna• onale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Siège de la société
Bonn et Eschborn, Allemagne
T +49 228 44 60-0 (Bonn)
T +49 61 96 79-0 (Eschborn)
Programme d’Appui à l’Entrepreneuriat et à l’Innova• on
Immeuble Panorama
40, avenue du Japon
1073 Tunis Montplaisir
Tunisie
T +216 71951116
F +216 71993983
Responsables:
Philippe Lotz
T +216 71951116
Holger Kuhle
E holger[email protected]
Texte
Anita Demuth
Concep• on
Anita Demuth
Crédits photographiques
Sur la couverture et au verso: Anita Demuth
Toutes les photos appar• ennent au répertoire de la GIZ sauf celles prises
par Anita Demuth et les crédits men• onnés à côté de l’image.
Impression
Kréa
Tunis
Mise à jour
Octobre 2014
Le contenu de la présente publica• on relève de la responsabilité de la GIZ
sur mandat du Ministère fédéral de la Coopéra• on économique et du Dé-
veloppement (BMZ). À son • tre d’entreprise fédérale, la GIZ sou• ent le
gouvernement allemand dans la realisa• on de ses objec• fs de coopéra-
• on interna• onale pour le développement durable.

3
Sommaire
Préface 2
Introduc! on 6
1. L’Entrepreneuriat Vert - un atout pour le développement durable 9
1.1. Ce que nous entendons par l’Entrepreneuriat Vert 9
1.2. Des nouveaux modèles d‘a" aires 15
1.3. L’approche territoriale pour la promo! on de l’Entrepreneuriat Vert 22
2. Promouvoir l’Entrepreneuriat Vert en Tunisie 27
2.1. Les dé# s environnementaux et sociaux en Tunisie 27
2.2. Une cartographie des ini! a! ves en Tunisie 29
2.3. Opportunités et pistes de ré$ exion 39
Bibliographie 42
Execu! ve Summary 44
Liste des abrévia! ons 48
Entrepreneuriat Vert
Une voie prome% euse vers un futur durable
en Tunisie et ailleurs
Publié par
Octobre 2014

4Entrepreneuriat Vert - Une voie prome• euse vers une futur durable en Tunisie et ailleurs
La « croissance économique »
et la « durabilité environnementale »
représentent les deux piliers des condi-
! ons indispensables à la vie dans les so-
ciétés humaines. Instaurer un équilibre
compa! ble suppose une large mesure
d’esprit et d’élan entrepreuneurial.
Ce• e a" rma! on vaut à la fois pour les
individus et les sociétés dans lesquelles
ils évoluent. L’ac! vité économique ou
le niveau d’ac! vité économique dé-
pendent d’un certain nombre de cir-
constances telles qu’un logement sa-
lubre, une alimenta! on de qualité, des
vêtements adaptés, un environnement
sûr et l’accès à l’eau propre. Telles sont
dans les grandes lignes les fondements
de la vie humaine en général et de ses
interac! ons et de son interdépendance
avec les éléments naturels tels que les
plantes, le sol, l’eau, le climat, la lu-
mière et d’autres éléments vivants et
minéraux ainsi que les ondes radio de
l’environnement électromagné! que.
Le fonc! onnement économique des
hommes et de la société a un impact
direct sur l’environnement au même
! tre que ce dernier joue un rôle dans
la croissance des individus en par! cu-
lier et de la société en général.
C’est également le cas de la Tuni-
sie, dont certaines régions pourraient
être sérieusement menacées par des
marées hautes et des tempêtes provo-
quées par les changements du climat.
Selon l’étude réalisée par la Banque
mondiale, « l’adapta! on au change-
ment clima! que et la résilience aux dé-
sastres naturels dans les villes cô! ères
d’Afrique du Nord » présente un risque
pour les régions fortement urbanisées
et les zones industrialisées le long des
li• oraux (cf. h• p//econostrum.info).
Depuis le début des années
1970, suite à la publica! on du rapport
du « Club de Rome », les analystes
n’ont cessé de répéter que l’équilibre
entre ces deux éléments de la vie hu-
maine, l’économie et l’environnement
était menacé. Que s’est-il passé ? En
outre, cet équilibre fragile cons! tue
une menace sérieuse pour notre ave-
nir. Quels sont les critères détermi-
nants pour ajuster la rela! on entre les
dimensions économique et environ-
nementale de nos sociétés ? Quelle
forme prendrait-il ? Et en# n, où fau-
drait-il commencer ?
Les raisons de la dichotomie
Les sociétés ont toujours mené
des ac! vités de nature entrepreneu-
riale pour répondre à leurs besoins
physiques. Elles ont u! lisé leurs « fac-
teurs de produc! on » tels que le travail,
la terre et les ressources naturelles.
Préface
Entrepreneuriat vert - une réponse au dé# de la
compa! bilité entre l’améliora! on des revenus
et la protec! on de l’environnement

5
Coopéra• on allemande - GIZ - République Tunisie
Elles ont ensuite perçu un revenu pour
acheter ou consommer des biens. Les
niveaux de vie d’une communauté ou
d’un état se sont progressivement éta-
blis ; le niveau de vie d’un pays dépend
des ap• tudes à produire des services
et des biens. Au ! l du temps, les sché-
mas économiques et modèles d’af-
faires adoptés par les Hommes et les
sociétés ont évolué.
Depuis que l’industrialisa• on
avec son organisa• on extensive a im-
posé la produc• on de masse, les res-
sources naturelles ont commencé à
faire l’objet d’une exploita• on non du-
rable. C’est ainsi que l’industrie agroali-
mentaire s’est développée à échelle in-
dustrielle basée sur les mono-cultures
en u• lisant des équipements lourds,
des engrais chimiques et des pes• -
cides. Le résultat de ce" e agriculture
mécanisée est la destruc• on de la bio-
diversité.
A un stade ultérieur, dans la me-
sure où la croissance économique a
été largement • rée par la « ! nancia-
risa• on » et les simpli! ca• ons ciblées
des ressources naturelles, les inves• s-
sements ont été bien moins en phase
avec les condi• ons de la vie réelle.
L’emprise croissante des impéra• fs ! -
nanciers au sein des économies, un
schéma d’accumula• on dans lequel la
réalisa• on des béné! ces s’e# ectue de
plus en plus par le biais de canaux ! -
nanciers plutôt que par le négoce et la
produc• on de biens, a sapé la récipro-
cité entre la « croissance économique »
et la « durabilité environnementale ».
De nos jours, nous sommes
confrontés à une surexploita• on de la
biocapacité de la planète, la surcons-
omma• on des ressources naturelles
et une produc• on de déchets bien su-
périeure à ce qui peut être absorbé en
toute sécurité. Nous avons vécu au-delà
de nos moyens sur le plan écologique.
La de" e écologique de l’humanité a
dépassé les « limites planétaires » et
nous avons par conséquent a" eint les
fron• ères de la croissance économique
au sens « premier » de « plus grand »
et « plus grande quan• té ».
Vers une croissance de qualité
Il semblerait qu’il n’y ait pas
d’incompa• bilité « naturelle » entre
l’entrepreuneuriat orienté vers la crois-
sance économique et la durabilité en-
vironnementale, mais l’incompa• bilité
d’origine humaine existe bel et bien.
Par conséquent, c’est donc le devoir
des Hommes et des entrepreneurs de
s’inves• r pour resor• r de l’impasse
dans laquelle nous nous trouvons à
l’heure actuelle. Les critères de percée
sont nécessaires pour reconnecter la
dimension économique et environne-
mentale du développement humain.
L’évoca• on de limites exige de
se pencher sur les cultures à choi-
sir, le lieu de planta• on et l’iden• té
du consommateur ! nal. La « crois-
sance économique » présente de nom-
breuses applica• ons. Le fait qu’une
économie croît ne nous dit rien sur la
« qualité » de ce" e croissance. L’octroi
de ressources ! nancières aux prisons
et à l’armement contribue à gon$ er le
Produit intérieur brut (PIB) au même
• tre que les dépenses consacrées aux
hôpitaux et aux écoles. Comme les be-
soins physiques des Hommes ne sont
toujours pas pris en compte dans de
nombreux endroits autour du monde
et parmi de nombreuses couches so-
ciales défavorisées, il demeure un be-
soin de produc• on de biens et de ser-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
1
/
52
100%