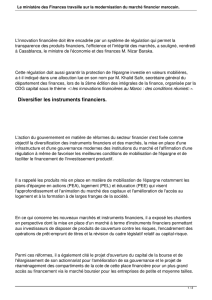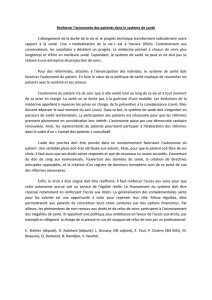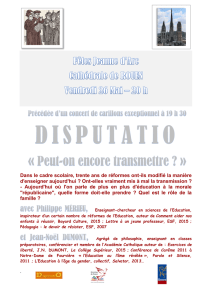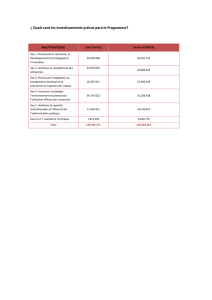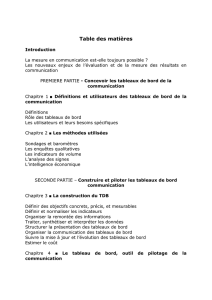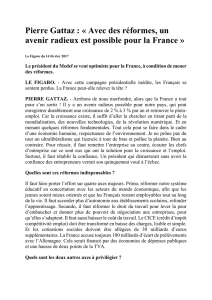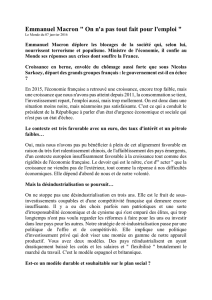Irréversibilité du développement et Quasi

SEPIO, U. Paris 1 – Mardi 9 mars 2010, 16h – MSE, salle 17, 106-112 bd de l'Hôpital, Paris 13e
Irréversibilité du développement et Quasi-réversibilité du sous-développement
Albert Tcheta-Bampa
Résumé
Ce travail examine les causes profondes du développement économique et son insuffisance. Il montre que l’ensemble d’institutions dont
dispose une économie constitue la source principale des progrès économiques. Il élabore un modèle théorique qui, démontre que lorsque les
pays réformes ses institutions, ils créent les possibilités du développement irréversible en revanche, lorsqu’ils sont dotés des mauvais
déterminants institutionnels, les réformes ne réussiront pas et le ces pays resterons bloqués dans des pièges à sous développement lié à la
défaillance institutionnelle. Schématiquement, ce modèle démontre (1) qu’à chaque design institutionnel correspond une qualité
institutionnelle et à un niveau de développement économique, (2) que les pays dotés des bonnes institutions sont placés sur un sentier de
dépendance qui les protège du sous-développement, (3) que les pays dotés par des mauvaises institutions sont enfermés dans un trappe à
pauvreté et (4) que les réformes institutionnelles sont toujours inspirées par le design institutionnel initial. Enfin, ce travail analyse les
régimes de croissance de quelques pays en développement depuis 1950 jusqu’en 2000. A partir de cette longue analyse il montre aux travers
les politiques d’aide publique au développement et/ou la politique d’ajustement que les voies de sortie de la pauvreté sont souvent parsemées
d’embûches institutionnelles, qui vont bien au-delà de simples défaillances dans la dotation de facteurs et dont la résolution exige bien plus
que de simples apports d’aide étrangère, ou même d’augmentation de l’épargne interne.
Mots clés : Institutions, réforme, irréversibilité du développement économique, quasi-réversibilité du sous-développement, politiques
publiques, pays en développement.
Abstract
This work examines the causes of economic development and its insufficiency. It shows that the set of institutions which has an economy is
the main source of economic progress. It develops a theoretical model that demonstrates that when countries reform their institutions, they
create opportunities for development irreversible however, when they are ill-equipped critical institutional reforms will fail and these
countries remain trapped in traps Slot development related to institutional failure. Finally, this work examines the patterns of growth of some
developing countries since 1950 until 2000. From this extensive analysis shows it through the policies of official development assistance and
/ or policy adjustment as ways out of poverty are often interspersed with institutional obstacles that go far beyond simple failures in
allocation of factors whose resolution requires more than simple transfers of foreign aid, or even increase domestic savings.

2
INTRODUCTION
L’idée que les facteurs accumulables au sens larges (démographie, épargne, capital physique et capital
humain ) ne sont pas les seuls déterminants
1
importants des résultats économiques et que d’autres facteurs (tels
que les institutions, l'histoire, les questions de répartition, culture…)
2
sont pertinents pour le développement
économique à long terme, est certainement la proposition la plus importante qui ressort de la théorie économique
actuelle.
Ce travail formalise la façon dont l’évolution des institutions crée les conditions d’un développement
irréversible et d’un sous-développement quasi-réversible. Il démontre à partir d’un modèle théorique de
présentation graphique comme les pays qui réforment leurs institutions afin de sortir du sous-développement
avaient des pré-requis institutionnels favorables. A l’inverse les pays qui ne réussissent pas à découvrir les
bonnes institutions pour le progrès matériel de leurs populations sont caractérisés par l’absence de ces préalables.
Le changement institutionnel est modelé et contraint par les processus de décision passés et détermine les
trajectoires futures. Cela signifie qu’une fois les bonnes institutions découvertes il existe un processus cumulatif
à la fois d’un point de vue statique ; les bonnes institutions existent, et dynamique ; les bonnes institutions
réussissent à s’adapter aux situations nouvelles parce qu’elles sont bonnes. Inversement les mauvaises
institutions le sont intrinséquement et qu’elles changent toujours dans la mauvaise direction.
Ce travail se place donc ouvertement dans la théorie néo-institutionnaliste du développement et reprend
la problématique définie par North (1991). Il accepte de différencier les institutions formelles et informelles et
situe sa réflexion dans l’histoire longue. Les institutions servent dans ce contexte à réduire l’incertitude et à
faciliter la coordination des agents. Elles sont définies comme un système incitatif qui favorise ou non l’activité
productive des entrepreneurs.
Le raisonnement est alors le suivant. La première section de ce travail montre les raisons qui conduisent
à supposer que le développement est irréversible. La deuxième section explique pourquoi de manière assez
similaire le sous-développement est quasi-réversible. L’originalité de l’analyse consiste alors dans une troisième
section à utiliser un modèle graphique pour formaliser et expliquer les conditions d’irréversibilité et de quasi-
irréversibilité du développement et du sous-développement. Pour que ce modèle puisse s’appliquer
empiriquement, la quatrième partie étudie la dynamique du PIB d’un sous-ensemble de pays en développement
qui étaient initialement pauvres avec de faibles niveaux de développement comparables dans les années 1950,
mais qui ont divergé : certains d’entre eux ont réalisés des progrès très impressionnants (par exemple les pays
d’Asie, ont réussi à s’en sortir pour éventuellement atteindre des produits intérieurs bruts par personne
comparables à ceux des pays industrialisés), alors que d’autres régions pauvres ont subi un échec économique
tout aussi impressionnant (par exemple les pays d’Afrique au sud du Sahara, sont restées sous-développées).
1
La théorie traditionnelle de la croissance (Solow, 1956) explique les différences de revenues per capita en termes d’accumulation des
facteurs de production. Les différences entre pays sont dues aux différences de taux d’épargne ou à des facteurs exogènes, tels que la
croissance de la PTF. La nouvelle théorie de la croissance (e.g. Romer, 1986; Lucas, 1988) rendent endogène la croissance et le progrès
technologique, mais les explications pour différences de revenus sont les mêmes. Un pays sera plus prospère qu’un autre s’il alloue plus de
ressources à l’innovation (dû aux préférences ou à la technologie pour créer des idées). Ces théories donnent plusieurs indications sur
processus de croissance, mais ne donnent pas d’explications sur les causes fondamentales du développement et de son insuffisance.
2
Le terme institution est employé souvent dans ce travail pour désigner cet ensemble de déterminants fondamentaux.

3
L’idée ici est que ces pays pauvres ont stagné parce qu’ils sont enfermés dans un équilibre bas à cause des
défaillances institutionnelle et qu’une réforme en profondeur
3
(considérée comme « grande impulsion ») serait
nécessaire pour les sortir de la pauvreté. Enfin la conclusion de ce travail fournit quelques conclusions pour la
réussite de réformes.
3
Une réforme est dite en profondeur lorsqu’elle « change la nature comportementale des agents, permettra de résoudre des obstacles
au développement. Par exemple l’établissement d’une loi qui est destinée à modifier la répartition de la riche d’une société ou une régulation
qui résout les problèmes de free-rider. Lorsque réformes ne se font pas «en profondeur», au sens précédemment défini, elles sont dites alors
en surface, non seulement leurs effets peuvent se trouver neutralisés selon un processus de fongibilité politique, mais elles peuvent
réellement être néfastes, du moins à certains égards. Et, enfin de compte, l’évolution de développement économique s’en trouve stagné
(décru), puisque cette évolution est bloquée par la mauvaise qualité des institutions.

4
1 Durabilité et irréversibilité du développement économique
La science économique s’est depuis longtemps enrichie de concepts issus d’autres disciplines : qu’un
concept voyage d’une discipline à une autre, il n’y a là rien de très original. Les concepts d’irréversibilité et de
réversibilité utilisés ici sont ainsi empruntés à la mécanique physique.
Une situation est irréversible lorsqu’elle échappe à la stratégie des acteurs. Des persistances, des
nouvelles mœurs, de nouvelles habitudes, de nouveaux usages, des tendances lourdes limitent et façonnent les
marges de manœuvre dont disposent les agents. Une fois qu’un pays à trouver ses bonnes institutions pour le
développement (bonne équilibre) il place sa population dans une tel situation. Le cadre institutionnel bloque les
retours en arrière. Il incite les individus à investir dans des activités de recherche de profit et à participer à la vie
économique. Il limite l’action des élites, des politiciens et des groupes d’intérêt. Il empêche les prédateurs de
développer leurs activités. Il entraîne un processus de progrès économique qu’on ne peut pas renverser.
L’histoire de l’Europe peut illustrer cette réalité. Elle montre, aussi, la capacité de ce continent à s’adapter, à
trouver les moyens de s’entendre pour surmonter les guerres, les conflits nationalistes, etc. Il existerait, en ce
sens, un processus cumulatif dans lequel le changement institution va de pair avec les normes, les mœurs, les
coutumes, l’histoire, et les croyances des peuples.
Dans cette conception, le développement économique est indissociable d’une transformation très
largement irréversible des institutions. Le changement des institutions est donc conçu comme supérieur à
l’ensemble des sources de développement, de sorte qu’il marque une étape dans un mouvement réputé
irréversible.
Si l’émergence et le changement des institutionnels rendent le développement économique irréversible,
la défaillance institutionnelle engendre des pièges de sous développement qui empêchent développement des
pays pauvres.
2 Quasi-réversibilité du sous-développement : l’existence d’une trappe à sous-développement
Le même phénomène d’irréversibilité existe pour le sous-développement et le chaos. Le chaos
économique et social est le fait d’une conjonction de facteurs culturels, historique, et institutionnels. La quasi-
réversibilité de sous développement se définit par l’opposition à une conception stricte de l’irréversibilité du
développement. Un sous développement sera dit quasi-réversible ou « quasi-statique
4
» si tout progrès ou toute
transformation opérée pendant une période donnée, peut être annulée par l’amplification des mauvaises
institutions et ses déterminants. Nous soutenons ainsi qu’un pays pauvre ne peut pas sortir de la pauvreté sans
un choc qui touche l’ensemble des caractéristiques de son design institutionnel.
4
Nous préférons utiliser l’expression « quasi-statique » à la place de réversible car en physique (thermodynamique), la notion de
réversibilité mélange plusieurs aspects qui sont difficilement adaptables dans le cadre du présent travail.

5
Pour soutenir cette thèse nous nous plaçons dans le cadre de la théorie de l’équilibre institutionnel et
reprenons l’idée d’une trappe à sous-développement, d’un piège. Certain pays serait piégé par leur histoire ou
leur dépendance du chemin suivi
5
.
En dehors des autres facteurs l’histoire détermine aussi les résultats économiques à travers d'autres
facteurs
6
. De l'histoire d'une société dépendent sa technologie, le savoir-faire de ses masses laborieuses et ses
institutions. L'impact des événements passes ne s'amenuise pas toujours avec le temps. Parfois, ces événements
conditionnent un état stable particulier de l'économie.
L'histoire conditionne aussi les résultats à travers les croyances. Un exemple évident est celui des
anticipations (au moins en partie) projectives: le fait de s'attendre a ce que les gens se comportent a l'avenir
comme ils se sont comportés dans le passé. Cependant, même si les anticipations sont tout à fait rationnelles,
l'ombre de l'histoire peut rester vivace. Ainsi, par exemple, les révélations de la corruption ou des escroqueries
impliquant un certain nombre de dirigeants africains (Mobutu du Zaïre, Bokassa de la Centre Afrique, Bongo du
Gabon, Eyadema du Togo,…) ont dégradé la réputation de tout le continent africain. L’idée est qu’une telle
situation a amoindri la motivation de chaque dirigeant africain à se comporter honnêtement dans l'avenir. En
suivant Tirole (1996) nous suppose que la réputation d'un membre du groupe (par exemple un ministre au sein
d'un gouvernement africain) dépend de son propre comportement passé, et aussi, sachant que l'on scrute son
parcours avec attention, du comportement passé du groupe. Une révélation sur un comportement malhonnête,
dans le passé, de la part d'un membre quelconque du gouvernement, fera que tout agent mettra davantage de
temps pour gagner une réputation d'honnêteté. Ce qui réduira la motivation de l'individu à être honnête, et pourra
créer un cercle vicieux de corruption dans lequel « les nouveaux membres d'un gouvernement ou d’une
administration risquent de souffrir a cause du pèche originel de leurs ainés, bien après que ces derniers ne soient
plus là ».
Cette notion des pièges de sous développement n’est pas nouvelle, elle a émergé au tout début de la
littérature sur l’économie du développement, et est associée en particulier aux contributions initiales de Young
(1928), Rosenstein-Rodan (1943) et Nurkse (1953). Ensuite, cette hypothèse a été explorée par les analystes de
la croissance étudiant la notion de « clubs de convergence » à la suite des contributions empiriques
d’Abramovitz (1986) et de Baumol (1986). Enfin, elle est devenue à la mode, et est maintenant connue comme
l’hypothèse de « trappe à pauvreté » (Kraay et Radatz, 2005).
La tendance naturelle d’un pays ayant de mauvaises institutions est de toujours revenir vers la trappe de
pauvreté, même si de bonnes réformes ont été menées. Cette trappe à pauvreté trouve, dans notre schéma
institutionnaliste son origine dans ce qui ressemble à une trappe institutionnelle. Les institutions empêchent les
bonnes réformes de se développer. Ils pervertissent toutes les actions qui sont engagées dans le pays. Elles
corrompent.
5
L’idée est que la valeur d'une variable dans le futur dépend de sa valeur dans le passe.
6
Si l'histoire compte, c'est aussi parce qu'elle conditionne la confrontation aux modèles culturels, laquelle façonne les préférences. Des
changements intervenant dans la manière dont les membres d'une génération gagnent leur vie peuvent avoir une influence sur la génération
suivante, sur sa manière d'élever les enfants, sur l'éducation scolaire, sur les règles informelles d'apprentissage telles que le conformisme, sur
les modèles et sur les normes sociales.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%