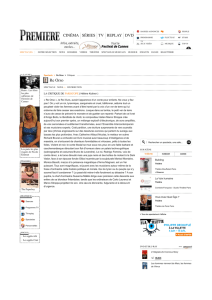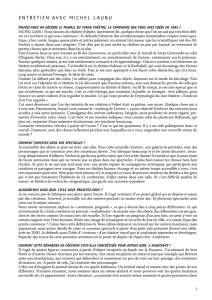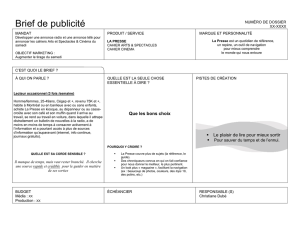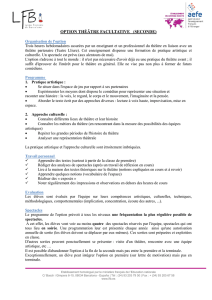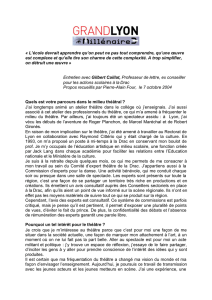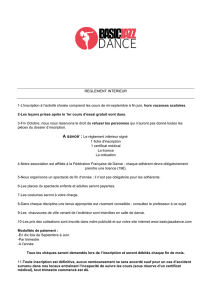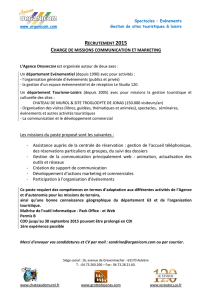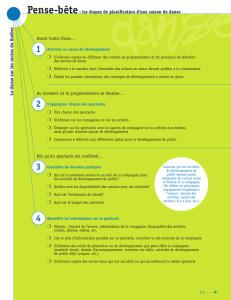Mémoires, lacunes et révélations

9
Mémoires,
lacunes et
révélations
Antoine Pickels et Célyne Van Corven
Antoine Pickels Situons cette conversation. Tu réalises cette exposition et cette
publication, or tu as débarqué à Bruxelles récemment, et ne connais pas
particulièrement le théâtre ni la danse belges. J’ai, avec d’autres (beaucoup plus
expérimentés), présidé au choix des quarante spectacles qui constituent la matière
de base. Mais, si je vois des spectacles depuis la fin des années 1970… je n’ai pas
non plus tout vu.
Célyne Van Corven Comment avez-vous eu cette idée ? Pourquoi se réunir et choisir
quarante spectacles, pourquoi ce projet ?
AP Sans doute d’une volonté de mieux comprendre le présent à partir du passé. L’état
de la scène – théâtrale, chorégraphique – en Belgique francophone aujourd’hui
souffre d’un manque lancinant de pensée autre que de « gestion » politique et de
« pertinence » médiatique. D’où vient-on, comment en est-on arrivés là ? Cela fait plus
ou moins quarante ans qu’il y a une « autonomie culturelle » des Belges
francophones. Avant les années 1970, ce qui se passait en Belgique francophone
faisait fort référence à la France, notamment sur le plan du spectacle vivant. Bien sûr,
le Théâtre National existait, et Béjart était à La Monnaie depuis 1959, mais on vivait
quand même dans un rapport d’obédience vis-à-vis de « ce qui venait de Paris » –
cette obédience subsiste d’ailleurs ici et là. Après 68, a commencé à se forger un art
scénique de recherche, un théâtre et une danse largement expérimentaux, avec
une qualité spécifique, et cette qualité (et non pas identité) spécifique est, de fait,
apparue simultanément à « l’indépendance culturelle » de ce qu’on appelle la
Communauté française de Belgique – la Belgique francophone.
CV C’est donc à la fois sur les plans politique et esthétique que se trouve votre point
de départ ?
AP Oui, et de ce problème avec lequel nous devons composer dans une petite région
comme la nôtre : parce que c’est si petit, on a tendance à ne vouloir se fâcher avec
personne, et donc à ne jamais choisir, à avoir un esprit forcément « anthologique »,
parce que c’est plus consensuel de ne pas faire de choix… Ce qui aboutit à une
absence de repères.

10 11
de l’artiste, et pour la scène (ou éventuellement la politique culturelle) belge.
On demandait aux rédacteurs d’aborder ces trois points, ou, comme ils n’avaient pas
nécessairement la place pour le faire, d’insister sur un aspect qu’ils trouvaient
particulièrement marquant, si cette trame ne pouvait pas s’appliquer au spectacle
en question, et que le point important était ailleurs. L’enjeu était de trouver un cadre
commun qui ne soit ni scolaire, ni réducteur, qui dépasse le « j’aime/j’aime pas ».
AP Avec un regard porté sur le metteur en scène ou le chorégraphe, plus que sur
l’« auteur », il faut le préciser : ce qui est mis en avant ici est surtout le (ou les)
maître(s) d’œuvre de la scène. Si parmi cette quarantaine de spectacles, on retrouve
des auteurs belges importants (René Kalisky, Jean Louvet, Michèle Fabien,
Jean-Marie Piemme, Alain Cofino Gomez, Marie Henry…), il y a aussi des absents,
des auteurs considérés comme de grandes figures littéraires qui ne sont pas
représentés, ou des textes qui ne sont pas forcément les plus importants de leurs
auteurs. Ainsi Jean-Marie Piemme (par ailleurs auteur de deux des notules de
ce livre) est uniquement représenté à travers sa collaboration à Rwanda 94, qui n’est
pas son texte le plus marquant… Mais la manière dont ses pièces les plus fortes ont
été montées en général en Belgique a donné lieu à des formes assez conven-
tionnelles, où le spectacle s’effaçait derrière le texte. C’est aussi vrai d’ailleurs
d’autres créations de textes forts – je pense par exemple aux pièces de Werner
Schwab créées en français par Michel Dezoteux, ou à Paul Willems monté par Henri
Ronse… La force du texte était telle qu’il n’y avait presque plus rien à « jouer » pour
le metteur en scène, et l’objet scénique dans sa globalité s’avérait relativement
quelconque. Mais pour reprendre notre fil… les distributions sont-elles, elles aussi,
révélatrices ?
CV La distribution, c’est l’aspect technique : on y indique notamment où et quand
a été créé le spectacle, où il a tourné, les prix reçus. La question de savoir
où le spectacle a tourné n’est pas si anodine, ne serait-ce que parce qu’elle montre
si ce spectacle, sur le coup, ou cinq ans après, a été jugé révélant ou révélateur.
À cet égard, il y a des surprises. Parfois un spectacle n’a été joué qu'une fois au
moment de sa création, comme Artefact (I) de Philip Marannes – même si l’œuvre
a été ensuite montrée au Danemark et en Belgique. Jocaste, un autre exemple, a été
repris trois fois, mais de manières différentes.
AP Qu’est-ce que la mémoire du spectateur, et notamment de ceux qui se
souviennent des spectacles les plus anciens ? Ça n’a pas été facile de trouver des
témoins…
CV À partir des distributions, on a demandé aux participants les contacts de gens
qui auraient été susceptibles de voir le spectacle et qui seraient contents d’écrire.
On a fait appel à quelques critiques, mais pas tant que cela, car on ne voulait pas
qu’ils nous répètent ce qu’ils avaient déjà écrit à l’époque, ce n’était pas le but. Ceci
n’est pas un journal. On voulait aussi un éclairage plus subjectif peut-être, et faire
varier les points de vue : donner la parole à des universitaires, des artistes, des gens
un peu déconnectés du milieu du spectacle… Pour que ce soit plus riche, pour qu’il
y ait des tons différents, des résonances, voire des discordes.
AP Les tons, les écritures, les objectifs étaient donc différents ?
CV Écrire une notule, c’est un vrai exercice de style : on demandait aux rédacteurs
de dire beaucoup de choses dans un espace très restreint. Quand on « met au
format », on doit faire des choix, et essayer par exemple de remanier des passages
CV Or là, le but n’était absolument pas de viser l’exhaustivité, mais d’être partial.
AP Partial si on veut. Subjectif au moins. Nous avons tenté de repérer, sur quarante
ans, une quarantaine de spectacles qui, d’une part ont révélé leurs auteurs, et par
ailleurs avaient peu ou prou révélé leur époque. Les choix se sont faits selon l’idée
qu’il y a une évolution de la scène, et que cette évolution est le fait de spectacles
qui sont autant de jalons. C’était là le critère ; on a donc écarté de la sélection des
spectacles parfois très intéressants ou réussis, mais qui n’allaient pas sur des
territoires inconnus. Ceux-ci avaient peut-être satisfait les spectateurs, leurs créa-
teurs aussi, mais sans pour autant faire avancer la « machine scénique ». Et la vraie
question, au bout du compte, était : qu’est-ce que cette réunion d’objets scéniques,
qui avaient révélé de nouvelles manières de faire, allait à son tour révéler ?
CV C’est intéressant, parce que dans les différents sens que l’on donne au mot
« révélation », celui qui apparaît d’abord, c’est celui d’illumination brusque,
de soudaineté, alors qu’ici, le travail de collecte des informations, de recherche
de sources, de rédaction, s’est inscrit dans le long terme, c’est une révélation qui
arrive petit à petit. C’est dans le temps, à force de faire un travail de fourmi,
qu’on arrive à voir émerger quelque chose.
AP On serait donc plutôt dans le mode de la révélation photographique…
CV Oui, et avec un bain révélateur particulièrement lent. Et en fait, même plusieurs
bains. On a l’impression de travailler dans plusieurs compartiments, et qu’à chaque
fois qu’on progresse sur un point, on y voit plus clair, mais les choses avancent
tellement progressivement et de façon concomitante, qu’il a longtemps été difficile
de se faire une idée d’ensemble.
AP Peut-être faut-il préciser ces phases de travail. On vous a fourni une liste…
CV Et on nous a dit : voilà quarante spectacles, voilà la matière sur laquelle nous
travaillons, mais on ne sait pas encore comment, ni quoi en dire ; c’est une intuition.
Assez vite, la décision fut prise de faire intervenir surtout des spectateurs, et pas
de manière universitaire, ni panégyrique. Il ne s’agissait pas en effet de distribuer
des récompenses, mais plutôt d’envisager ces spectacles à partir des traces qui
en subsistent. L’idée du souvenir était dès l’origine prégnante dans ce projet, on a
cherché à mettre en valeur la mémoire des gens… À partir de la liste, on a essayé
de se documenter, de chercher des informations pratiques, qui, quand, où,
comment ; des renseignements très simples, permettant de créer un cadre. Mais
ce cadre ne tenait pas : parce que ça avait été écrit ici où là, parce que c’était de la
danse, ou du théâtre, ou un peu des deux, voire presque de la performance, parce
qu’on n’avait aucune information, ou beaucoup trop. Il était difficile de trouver une
trame commune pour travailler sur tous ces spectacles. Nous avons donc recherché
des spectateurs privilégiés, souvent des « spectateurs professionnels », pour nous
éclairer et décider du regard qui serait porté.
AP Comment qualifierais-tu ces « notules » qui accompagnent chaque spectacle ?
Que demandiez-vous à leurs auteurs ?
CV On a voulu recueillir un point de vue renseigné mais subjectif, allant plus loin que
la recherche technique ou l’information brute (que nous documentions par ailleurs),
avec la question de savoir en quoi ce spectacle était révélateur. Il y avait en fait trois
grandes orientations : l’importance du spectacle dans son époque, dans la trajectoire

12 13
CV Oui, Cédric Juliens ne peut écrire cela qu’en fonction des spectacles que vous
avez choisis, puisque la sélection s’est faite sur le critère de la novation,
de l’exploration de voies encore inconnues.
AP Le regard de Nancy Delhalle est quant à lui plus historicisant, voire institutionnel,
et fait parfois référence à des œuvres que nous n’avons que peu évoquées.
CV Nous avons fait appel à elle et à son point de vue d’universitaire po ur replacer
ces quarante spectacles, et la scène en Belgique francophone d’une manière
générale, dans une perspective historique (voire sociopolitique), et pour évoquer
des problématiques esthétiques. À partir de notre sélection, et d’autres spectacles,
elle étudie un certain nombre de thématiques, telles que l’appréhension de la
théâtralité, la place du texte et du sujet, ou encore l’ironie, ou la prise (ou pas) de
risque. De fait, l’intérêt de cet ouvrage est aussi de pouvoir prendre le temps d’aller
voir ailleurs, d’élargir le cadre qu’on s’était donné.
AP Je voudrais revenir sur les différentes acceptions de « révélation », pour voir
où et ce qu’elles traversent. Ainsi, quand on parle de révélation au sens de découvrir
ce qui était secret, on pense par exemple à Claude Schmitz, qui était resté secret
jusqu’à Amerika. C’est vrai de lui, ça ne l’est pas de Martine Wijckaert, parce qu’on
a choisi un spectacle qui est venu bien après sa « consécration » avec La Pilule verte,
spectacle auquel on réduit trop souvent son travail. Par contre, si on prend le
deuxième sens « personne dont il est donné au public de découvrir le talent », il y a
des spectacles où il y a révélation, mais pas forcément du metteur en scène, il peut
s’agir de l’auteur, du scénographe ou d’un comédien. De La Mission de Dezoteux, on
retient souvent la scénographie de Jean-Claude de Bemels, parce qu’elle ne
proposait pas un rapport scène/salle classique, avec cette idée de surplomber la
salle. Mais excepté ce spectacle, il y a peu de transgressions du rapport scène/salle
traditionnel dans les spectacles choisis…
CV Il y a tout de même Yvonne, princesse de Bourgogne à l’École des vétérinaires,
où les comédiens se changeaient à vue, dans les boxes des chevaux…
AP Ou Le Dragon, un spectacle sous chapiteau, ou encore Ella, où van Kessel faisait
entrer les spectateurs dans le noir complet, au milieu de poules qui se mettaient à
caqueter quand la lumière s’allumait… Et Les Troyennes, et La Danse des pas perdus,
qui tirent parti de l’espace non théâtral où il se jouent, et L’Échange, qui inclut
les spectateurs dans le dispositif… Dès que j’y pense, je dois retirer ce que j’ai dit.
Il vaudrait d’ailleurs la peine de rechercher mieux la manière dont des lieux non
théâtraux, non conçus à l’effet de la scène, ou employés pour une création seulement,
ont modifié la manière d’aborder cette scène. Une architecture plus classique de nos
lieux de création (en Belgique en effet, le nombre de théâtres qui sont installés dans
des lieux non prévus pour cela est impressionnant) aurait probablement produit des
langages plus conventionnels.
CV Il y a également plusieurs spectacles qui, sans changer le rapport spatial,
transforment les dispositifs classiques. Ainsi de Made in Taïwan, où c’est le public qui
choisit le costume de l’interprète, et la musique ; le rapport entre la scène et la salle
change.
AP Ces spectacles-là sont nombreux. En fait, une série d’auteurs de la scène jouent,
depuis les années 1980 déjà, sur la déconstruction des codes. Yves Hunstad et Ève
Bonfanti avec La Tragédie comique, Transquinquennal dans Zugzwang, ou le groupe
trop obscurs pour ceux qui n’ont pas vu le spectacle, ou d’autres trop subjectifs.
C’était assez difficile, parce que des choses qui pouvaient nous sembler accessoires
étaient parfois celles qui tenaient le plus à cœur aux rédacteurs - c’est pourquoi nous
leur avons proposé, dans la mesure du possible, de retoucher le texte eux-mêmes.
Il faut dire que le travail était le plus souvent bien fait, parce qu’on s’est adressés à
des gens qui savent – et qui aiment – écrire. Au final, les notules sont très différentes :
certaines sont descriptives, d’autres soulignent ce que le spectacle a changé,
d’autres évoquent davantage l’auteur du texte, ou au contraire la mise en scène.
Globalement, les auteurs ont pris un certain plaisir à ce travail, ils ont été touchés
de se replonger dans des spectacles qu’ils avaient aimés il y a trente ou quarante
ans, de les redécouvrir. Et à entendre les relations de ces spectacles, on se rend
compte qu’ils ont effectivement été marquants. Même si je n’aime pas ce terme
un peu galvaudé, il y avait beaucoup d’émotions en jeu.
AP Qu’apprend-on des trois analyses plus longues ?
CV On a demandé à Catherine Simon de rendre compte de sa trajectoire
de spectatrice, son texte évoque donc les (nombreux) spectacles qu’elle a vus. Elle
a fait un peu le même travail que les rédacteurs de notules, mais en proposant
un autre point de vue, en insistant sur d’autres aspects. Il est d’ailleurs intéressant
de constater que les différents rédacteurs ne retiennent pas forcément les mêmes
choses d’un spectacle et que, lorsqu’on leur demande d’en parler en quelques mots,
de dire l’essentiel, on peut avoir des échos vraiment différents. Cette confrontation
est d'ailleurs souvent un signe de la richesse de la mise en scène. Catherine Simon
semble dire que les spectacles qu’elle a vus il y a longtemps l’ont davantage
bouleversée que les plus récents, et que la scène se renouvelle moins depuis
quelques années, mais peut-être est-ce dû au fait qu’elle devient moins réceptive,
qu’elle commence à être blasée.
AP À côté de Catherine Simon, une vraie mémoire vivante du spectacle, on a un
rédacteur plus jeune, Cédric Juliens.
CV Son expérience de spectateur débute dans les années 1990, et ce qui prime pour
lui, c’est l’idée d’héritage. Il l’aborde sans d’emblée dire précisément, parce que
c’est dur à identifier, ce que la scène belge, et lui en tant qu'artiste, héritent de ces
œuvres, de ces mises en scène et de ces créateurs. La question de
la filiation est très importante, il y a des noms que l’on retrouve un peu partout, au fil
de nos quarante spectacles, et ce dès Henri Chanal. On pourrait presque faire des
arbres généalogiques... Chanal a enseigné à Ferbus, qui joue avec Frédéric
Flamand, par exemple, et Marannes a des rapports directs avec Charlie Degotte.
Ces rapports de filiation expliquent aussi pourquoi on retrouve, d’une pièce à l’autre
des manières ou des concepts communs, comme une sorte de legs, et Cédric Juliens
conclut son texte en affirmant qu’il est bien l’héritier de quelque chose.
AP Oui, il y a ce paragraphe final où il cite une série de concepts apparus dans les
notules mais qui, réunis, font beaucoup sens : la simplicité des moyens,
le dépouillement et le jeu minimal, le plateau nu, l’ici et maintenant, l’engagement
social, la critique, le corps, le jeu non verbal, l’expression visuelle, la prise de parole
impertinente… Et l’idée d’un théâtre toujours à la recherche de nouveaux langages…
Or, il y a tout à fait moyen de faire une histoire du théâtre en Belgique francophone
depuis quarante ans sans parler du tout de la recherche de nouveaux langages. C’est
le choix de spectacles qui joue…

14 15
AP On peut aussi penser au Paradis des chiens, qui met en scène des personnes
âgées… ou aux comédiens handicapés mentaux du Créahm qui, parce qu’ils
ne jouent pas tout à fait « normalement », parce que l’évidence de leur âge inhabituel
ou de leur handicap coexiste avec leur jeu, font débouler sur le plateau une autre
réalité.
CV Mais si dans Le Paradis des chiens, la vieillesse, la pauvreté et l’isolement sont mis
en avant, si l'esthétique est peu séduisante, dans Watcha I love you la mise en scène
montre une vraie recherche de « beauté », au niveau des décors, des costumes,
et il y a un effort pour travailler avec les personnes handicapées comme avec
de « vrais » comédiens.
AP Mais je ne crois pas que l’irruption du réel soit en contradiction avec des
esthétiques très artificielles qui restent, au fil des années, très présentes sur nos
scènes, à travers les éclairages, les maquillages, les costumes, le travail du son, par
exemple, qui affirment souvent une théâtralité outrancière. Après tout, le
surréalisme, dont nous sommes aussi largement héritiers, c’est d’abord une faculté
de regarder le réel d’une autre manière, d’y percevoir le mystère – et les artistes
belges marquants du surréalisme ont particulièrement développé cet aspect :
il suffit de comparer Magritte et Delvaux à Dalí ou Tanguy, de lire Marcel Lecomte à
côté de Robert Desnos, pour s’en convaincre. Or, pour rendre compte de l’étrangeté
du réel, il faut souvent y mettre un peu d’artifice... Et on constate que
ce goût de l’artifice se maintient, même si les esthétiques évoluent – de l’aspect
volontiers onirique des années 1970 à celui très « léché » des spectacles des années
1980, ou à celui plus « trash » des années 1990, jusqu’aux prises de parti scéniques
plus conceptuelles des dernières années. Mais Magritte aussi a eu
sa période « vache »... Il n’en reste pas moins surréaliste.
CV Au-delà de la question de l’artifice assumé, il semble subsister une volonté
d’esthétique « pure » également, non ? C’est particulièrement sensible chez les
chorégraphes…
AP Effectivement. Les œuvres de Pierre Droulers, de Frédéric Flamand,
de Michèle Noiret, de Thierry Smits, de Karine Ponties par exemple, peuvent être
envisagées aussi d’un point de vue « strictement » formel, visuel. Et c’est vrai aussi de
certaines propositions théâtrales, faites par Philip Marannes, Martine Wijckaert,
Charlie Degotte, Claude Schmitz ou Émilie Jonet, qui sont aussi – si pas d’abord – des
propositions plastiques. On néglige souvent le rapport privilégié que de nombreux
chorégraphes, mais aussi des metteurs en scène, entretiennent ici avec les arts
plastiques. C’est que l’analyse et l’histoire du théâtre, telles qu’elles s’enseignent et
se font, sont encore très reliées à la littérature et à la sociologie, alors qu’une
approche théorique plus « plasticienne » permet parfois de mieux comprendre
certaines œuvres, qui doivent beaucoup plus à la peinture, à la sculpture, à la bande
dessinée ou à la performance qu’à Brecht, Artaud
ou Stanislavski…
CV Inversement, les questions sociales et politiques semble étrangement rares,
à part quelques exceptions évidentes, comme L’Homme qui avait le soleil dans
sa poche, Rwanda 94 ou Les Ambassadeurs de l’ombre.
AP C’est vrai que dans ce choix de spectacles, on voit peu, à part les exemples
évoqués, de démarches sociopolitiques « frontales », mais plusieurs facteurs
expliquent cette absence. D’une part, ces démarches, quand elles existent, sont
toc dans La Fontaine au sacrifice, sont ainsi des exemples d’un théâtre qui interroge
au premier chef les codes de la représentation, d’une manière souvent jubilatoire.
CV La question de la corporalité traverse également de nombreux spectacles.
On le voit bien à travers les notules ; nombreuses sont celles qui, à propos de l’acteur,
évoquent son investissement corporel. Cette insistance n’existerait peut-être pas
en France.
AP C’est un fait bien connu des maîtres de stages internationaux, quand ils
comparent les acteurs belges aux acteurs français, notamment. C’est largement dû à
la formation – même si toutes les écoles ne sont pas égales de ce point de vue,
la plupart accordent une large place à la formation corporelle, voire à la danse – et
aussi à l’influence majeure qu’ont eue sur nos scènes Barba, Grotowski, Kantor
ou les premières œuvres de Robert Wilson. Mais cela tient aussi, je crois, à un goût
du concret du corps, qui va de pair avec la part faite à l’irrationalité. Nous sommes
très souvent bien loin de Descartes, et bien les héritiers de Ghelderode et
Maeterlinck. Cette corporalité théâtrale entretient d’ailleurs une porosité avec
la danse, qui prend un peu le relais, en termes d’innovation, du théâtre corporel dans
les années 1990. Une danse toujours un peu impure, dramaturgiquement riche,
en dialogue permanent avec les autres arts, dont le théâtre.
CV Et qui à son tour contamine le théâtre, comme dans le travail sur l’inarticulé
d’Ingrid von Wantoch Rekowski, qui doit beaucoup à la danse sans en être… comme
celui de Nicole Mossoux et Patrick Bonté, ou d’Alain Populaire, ou même d’Ayelen
Parolin : on est là devant des formes qui n’entrent dans aucune catégorie, des œuvres
« interstitielles ».
AP Il ne faudrait pas pour autant que le lecteur croie que le langage articulé a
totalement disparu de nos scènes. Mais, il est vrai, la langue y est souvent désossée,
éclatée, ou simplement matière documentaire livrée dans sa brutalité authentique…
Il y a à cet égard une ambiguïté intéressante qui me semble parcourir la plupart
de ces spectacles : le rapport étrange que l’on voit apparaître entre jeu avec le réel
et artifice assumé. Bien sûr, la question du vrai et du faux est aussi vieille que le
théâtre, mais il y a ici une tension particulière, qui correspond sans doute à l’entre-
deux esthétique dans lequel nous nous trouvons, entre latinité et germanité, entre
France et Flandre.
CV Le choix des spectacles nous pousse en tout cas à poser la question de l’irruption
du réel. Souvent la frontière entre la réalité et l’artifice est floue, les deux
s’entremêlent… Joanne Leighton, on l’a vu, déconstruit ce rapport, en arrivant en
jogging et en demandant au public de choisir son costume, et c’est aussi le cas quand
Dussenne sert de la soupe pendant l’entracte de L’Annonce, ou même de Zugzwang
où, lorsqu’ils arrivent au théâtre, les spectateurs voient les comédiens attablés au
bar, et peuvent discuter avec eux avant et après la représentation – autant de
manières de briser le quatrième mur, de combler la distance entre la scène et la
salle. Encore que… il y a une intrusion du réel, certes, mais qui reste organisée,
stylisée, et qui fait partie de l’œuvre et de la représentation ; on reste dans l’artifice,
en fin de compte. C’est un peu différent avec les spectacles Rwanda 94, dans lequel
Delcuvellerie met sur scène une rescapée, ou Les Ambassadeurs de l’ombre, qui
donne la parole, au milieu de comédiens professionnels, à de « vraies gens », des
familles d’ATD Quart-Monde. Là aussi le réel, et pas dans ce qu’il a de plus reluisant,
participe d’une démarche esthétique, mais est également au service d’un message
social, ou politique.

16 17
comme le traitement atypique de l’espace scénique et le démantèlement des codes
du langage théâtral, le fort engagement du corps, ou encore un certain penchant
pour l’intrusion du réel dans le cadre artificiel de la scène – souvent dans une visée
politique – ce qui n’empêche pas qu’on trouve des approches esthétisantes, voire
une vraie beauté plastique à ces spectacles, qui bien souvent sont le fait de
démarches collectives. Au-delà de ces «révélations » toutefois, le théâtre et la danse
restent des objets insaisissables, qui nous résistent. Disons-le : ces « révélations »
transversales restent par essence fragmentaires et partielles. La spécificité des arts
de la scène, en effet, réside notamment dans leur caractère éphémère et dans
l’impossibilité intrinsèque d’en garder des traces – puisque même de haute qualité,
(et c’est rarement le cas), leur captation photographique ou vidéographique reste
nécessairement incomplète par rapport aux représentations elles-mêmes.
Concevoir dès lors une exposition et une publication sur ce sujet n’est pas chose
aisée. Plutôt que de rester sur une aporie, nous avons décidé de travailler sur
la fugacité même des traces laissées par le spectacle vivant, et de privilégier la
mémoire des spectateurs qui, même lacunaire, en dit souvent bien davantage qu’une
captation vidéo.
AP Cela nous permet aussi d’éviter l’écueil du fétichisme. Il n’y a rien de plus
dramatique, et de moins scénique, qu’un costume vide, un accessoire déteint, une
maquette poussiéreuse. J’aime ici que la mémoire du spectacle soit d’abord ce dont
on se souvient. Ainsi s’amorce, peut-être, au-delà des « sujets » même de ce livre (un
travail sur la mémoire et un essai d’analyse esthétique), une réflexion sur la manière
de représenter les arts de la scène en dehors de la représentation.
rarement accompagnées d’une recherche innovatrice en termes de langage théâtral.
Les théâtres les plus « engagés » politiquement sont rarement les plus audacieux
formellement, et c’est souvent délibéré de leur part, dans un souci d’accessibilité.
Ensuite, la politique culturelle du théâtre et de la danse a, d’une certaine manière,
favorisé cet état des choses : en donnant au « théâtre-action » la fonction d’être en lien
avec la société, on a un peu coupé ce lien pour le théâtre « d’art » (sans parler de la
danse… même si l’implantation du Centre chorégraphique à Charleroi a
heureusement fait bouger les choses, en forçant la prise en compte du public). Il faut
tenir compte aussi du goût que manifestent de nombreux artistes pour l’exploration
des mondes intérieurs, le caractère volontiers « psychanalytique » du théâtre belge
(un héritage de Maeterlinck, encore ?). Enfin, le politique n’est pas toujours là où on le
croit. Les grandes fresques esthétisantes de Frédéric Flamand sont en fait porteuses
de discours très messianiques sur l’évolution de la société. Le caractère transgressif,
iconoclaste, des pièces de Nicole Mossoux, d’Armel Roussel ou de Thierry Smits –
comme La Passion selon Pier Paolo Pasolini, d’ailleurs – portent sur des questions
de tolérance de l’autre et de tabous judéo-chrétiens à mon sens infiniment politiques,
comme l’est l’acte de Dominique Roodhofdt amenant sur le plateau, dans Le Paradis
des chiens, la parole des personnes âgées, des pensionnés, de ceux qui
« n’intéressent plus personne ». Et même des pièces qui semblent se concentrer sur
des névroses individuelles – La Terreur ou La Fontaine au sacrifice, pour citer des
exemples assez récents, d’une génération qu’on dit dépolitisée et narcissique – sont,
en creux, des critiques de société acerbes.
CV Est-ce que la question du politique, ce n’est pas aussi la manière dont on fait
du spectacle, dont on crée ? Même si nous avons ici cédé à la tentation de donner
la prééminence aux chefs d’orchestre, on sent bien, tant dans les récits qui en sont
faits que dans la manière dont s’ordonnent les distributions, qu’il y a beaucoup
d’énergies collectives, de dialogues entre artistes qui ne sont pas, ou peu,
hiérarchisés. Ainsi pour Real Reel, ils étaient deux à faire la mise en scène, et Pierre
Droulers disait que ce n’était pas lui seul, mais le Groupe Triangles qui avait créé
Hedges, en insistant sur le fait que ce n’était pas le fait d’une compagnie à proprement
parler, mais d’un collectif, un groupe.
AP Ne rêvons pas, les deux coexistent, il y a toujours des despotes et des démiurges.
Mais c’est vrai qu’il y a peut-être eu là une lâcheté de notre part : nous aurions
pu aller plus loin encore dans notre logique de l’œuvre, et citer les spectacles sans
valoriser spécialement les maîtres d’œuvre. Mais la réalité de la pratique est là,
et il s’agissait aussi de parler de la révélation de ces maîtres d’œuvre… Il reste que
les arts de la scène sont évidemment des arts du collectif, par définition : même en
solo, on a toujours besoin d’un œil extérieur, et d’un éclairagiste. Et de fait, dans bien
des cas, même si une personne est sacrée « metteur en scène », comme Philip
Marannes, ou Charlie Degotte, ou Armel Roussel, la démarche est en fait collective.
Et c’est encore plus vrai quand il s’agit de danse… Et puis il y a ceux qui
revendiquent nommément le collectif, avec les difficultés que cela comporte : le
Groupov (mais de manière particulière), le groupe toc, Transquinquennal… Qu’ils
se nomment ou pas, le fait est que la plupart de ces spectacles ont été créés dans des
logiques de « troupes » plutôt que d’institutions, et parfois dans des économies très
précaires : la hiérarchie, dans ces cas, est fortement bousculée, et le résultat théâtral
est forcément différent de celui d’un théâtre bien doté avec une équipe permanente,
comme en Allemagne ou en Pologne…
CV Au final, les traces d’un héritage émergent bel et bien de ces quarante ans
de scène francophone belge, et certaines innovations et particularités se révèlent,
1
/
5
100%