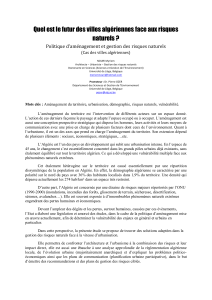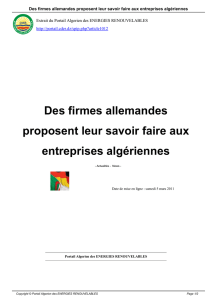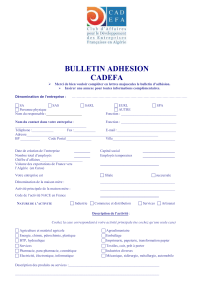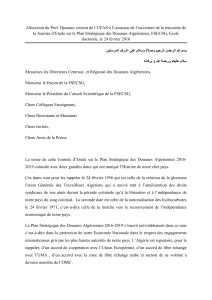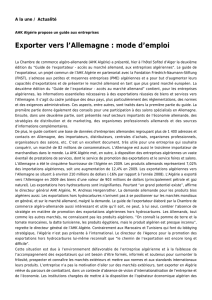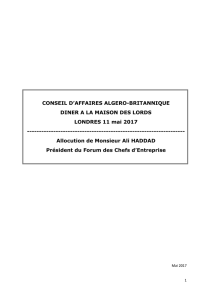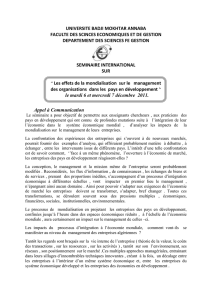Des Algériennes à Lyon 1947 - 1974 - Université Paris

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
ÉCOLE DOCTORALE II
Laboratoire de recherche
UMR 85 96 – Centre Roland Mousnier
THÈSE
Pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
HISTOIRE CONTEMPORAINE
Présentée et soutenue par :
Marc ANDRÉ
Le 4 avril 2014
Des Algériennes à Lyon
1947 - 1974
Volume 1
Sous la direction de :
Monsieur Jacques FRÉMEAUX, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne
Membres du jury :
Monsieur Olivier DARD, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne
Monsieur Jacques FRÉMEAUX, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne
Monsieur Jim HOUSE, Maître de conférences à l’Université de Leeds
Monsieur Benjamin STORA, Professeur à l’Université Paris 13
Madame Sylvie THÉNAULT, Directrice de recherche au CNRS

1
Position de thèse
Au début des années 2010, la France compte environ quatre millions de résidents
d’origine algérienne dont deux millions de bi-nationaux
1
. On en trouve 150 000 dans
l’agglomération lyonnaise, parmi lesquels 57 % ont la bi-nationalité
2
. Selon l’INSEE, 3,6 %
des enfants nés en 2011 en France métropolitaine ont un père d’origine algérienne avec la
plus forte proportion dans les départements de Seine-Saint-Denis (9,9 %), des Bouches-du-
Rhône (8,8 %) et du Rhône (7,8 %). Les statistiques disent combien l’histoire franco-
algérienne – dont l’immigration n’est qu’un aspect – a façonné la France autant que
l’Algérie
3
. Elles disent moins comment.
Cette histoire semblait, en effet, écrite pour l’essentiel comme une histoire d’hommes,
quasi-linéaire. Dans un premier temps, jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
l’émigration algérienne provenait d’une société rurale en crise. Puis, dans un deuxième temps,
une émigration davantage prolétaire prenait le relais jusqu’aux années soixante-dix. Enfin,
dans un troisième temps, une communauté algérienne s’implantait en France, relativement
autonome, grâce à la venue des femmes et des enfants
4
. Sociologues et historiens disposent
ainsi d’une catégorie d’analyse chronologique, la « génération » qui permet de répartir et
d’identifier commodément une population. Certes cette catégorie peut être modalisée,
notamment si l’on considère l’origine du phénomène : des Algériens étaient venus en
métropole dès la fin du XIX
e
siècle ou à la faveur du premier conflit mondial
5
, des
Algériennes s’y trouvaient en petit nombre dès les années 1930, légèrement plus nombreuses
dans les années 1950. Mais reste tout de même un penchant souligné par Edgar Morin : « La
connaissance scientifique fut longtemps et demeure souvent conçue comme ayant pour
mission de dissiper l’apparente complexité des phénomènes afin de révéler l’ordre simple
1
Sur ces estimations, lire Gilbert Meynier, « Après l'indépendance: les relations tumultueuses entre l'Algérie et
la France », in Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.),
Histoire de l’Algérie coloniale…, op. cit., p. 682. Également : Séverine Labat, La France réinventée. Les
nouveaux bi-nationaux franco-algériens, Paris, Publisud, 2010, 272 p.
2
Chiffres transmis par le consulat de Lyon en novembre 2013.
3
Les chercheurs en histoire tant en France qu’en Algérie émettent un avis de plus en plus éthique sur cette
histoire « franco-algérienne ». L’objectif serait d’aboutir à la réalisation de manuels scolaires bilingues comme
cela existe avec les manuels franco-allemands. Progressivement, des ouvrages initialement rédigés en français
sont traduits en arabes et édités en Algérie ou sont immédiatement conçus par des chercheurs et des maisons
d’édition des deux pays. Sylvie Thénault, « France-Algérie. Pour un traitement commun de la guerre
d’indépendance », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°85, 2005/1, pp. 119-128 ; Frédéric Abécassis, Gilbert
Meynier (dir.), Pour une histoire franco-algérienne, Paris, La Découverte, 2008, 250 p. ; Abderrahmane
Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Histoire de l’Algérie
coloniale…, op. cit.
4
Ces trois âges sont ceux décrits par Abdelmalek Sayad, La Double absence..., op. cit., p. 60.
5
Gilbert Meynier, L’Algérie révélée. La première guerre mondiale et le premier quart du XX
e
siècle, Genève,
Droz, 1981, 793 p.

2
auquel ils obéissent »
6
. Dans ce système de connaissance, à charge pour la pensée de « mettre
de l’ordre et de la clarté dans le réel » quand « le mot de complexité, lui, ne peut qu’exprimer
notre embarras, notre confusion, notre incapacité de définir de façon simple, de nommer de
façon claire, de mettre de l’ordre dans le réel »
7
. C’est pourtant de cette complexité qu’il
importe à la science de rendre compte. Or, l’immigration algérienne est complexe et ne saurait
se résumer à des séquences chronologiques simplifiées. Plus encore si l’on décide de se
concentrer sur les femmes algériennes entrées en France avant l’indépendance de l’Algérie
(elles sont 1 000 a minima) et résidant dans la région lyonnaise, il est impossible d’échapper
au face-à-face avec une « complexité ».
Il s’agissait dans cette étude de cerner un groupe humain de taille variable dans une
agglomération urbaine donnée, de saisir des parcours, des interactions et des malentendus
entre la société d’accueil et les personnes déplacées, loin des images décontextualisées que
l’on en produit. Recluses, les Algériennes forment une communauté que l’ethnologue peut
aborder. Déplacées, elles intéressent l’historien qui étudie les structures d’encadrement et
d’adaptation dans un contexte métropolitain. Opprimées, elles sont un enjeu de pouvoir pour
les hommes. Et des combattantes, on ne retient qu’un simple segment d’une vie pour
l’essentiel centrée autrement. L’arrivée d’Algériennes dans l’agglomération lyonnaise entre la
Seconde Guerre mondiale et l’indépendance de leur pays suppose l’écriture d’une histoire
mêlée, car faite de multiples contacts, tout autant qu’une histoire démêlée, car distinguant les
femmes entrées françaises en France des flux constants de la migration qui les maintiennent
dans un perpétuel statut d’immigrées.
Pour écrire un peu d’une telle histoire, il a fallu constituer un point de vue à l’égard de
différents types de sources. L’archive multiforme laissée par des institutions policières ou
associatives s’est en effet constituée selon une logique propre à ces institutions. Les femmes
suspectées ou aidées n’y paraissent donc jamais qu’à travers les partis pris des auteurs de
fiches ou de rapports. Souvent d’ailleurs, elles paraissent facilement reconnaissables à ces
auteurs au point que la femme algérienne des archives est d’abord une femme simplifiée.
Rappelons, à cet égard, le rapport de police dressé après le décès d’un militant messaliste en
janvier 1962 évoquant d’une phrase sa compagne, « la veuve Badri-Badri [qui] a eu de
nouveau trois enfants avec Badri Mostefa »
8
. Il s’avère que cette « veuve » a été un appui
essentiel du MNA comme le révèle un entretien. Plus encore, d’autres documents
6
Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Paris, Le Seuil, p. 9.
7
Ibid., p. 9.
8
ADR – 248 W 196 – Dossier Mostefa Badri.

3
administratifs la présentent comme une femme rapportée le plus souvent à son mari. Ainsi,
loin des événements politiques, les femmes n’apparaissent que rarement pour elles-mêmes
dans les archives : quand les familles demandent un logement HLM, seuls les hommes sont
les référents administratifs. Par exemple, Kheira Bounouri, totalement absente du rapport de
police faisant état de l’arrestation de son mari suite à une réunion de cadres FLN, n’est pas
non plus renseignée dans la liste des travailleurs algériens nécessitant un relogement en 1961.
Encore une fois, seul un entretien permet de remettre ce parcours en perspective et de mesurer
sa dynamique recherche de logement. Enfin, mais c’est peut-être le cas le plus simple du fait
de son évident parti pris, l’archive s’avère intéressée politiquement ou idéologiquement à
quelque image (autre simplification) d’une femme qu’elle voudrait emblématique. Par
exemple, le journal diasporique L’Algérien en Europe évoque régulièrement dans ses
colonnes, pour les années 1969-1972, une militante de l’Amicale des femmes algériennes.
L’entretien révèle toute la part de hasard qui conduit Akila Mezidi à la tête de la coordination
régionale de cette Amicale. Finalement, toutes les sources offrent des parcours tronqués de
femmes algériennes.
D’autres archives ont l’apparence d’un site archéologique où la femme algérienne
apparaît fragmentée. C’est le cas de la presse attachée à signaler les événements en fonction
de leur charge « événementielle », c’est-à-dire spectaculaire dans une acception situationniste.
En constituant ces faits divers en base de données, il devenait possible de distancier le
« spectacle » pour rendre apparent le fait historique. Le regard sur les Algériennes devient
cette fois plus apte à les décrire à l’origine d’un réseau symbolique de termes, d’images, de
postures sociales dont les tenants culturels (pour l’essentiel colonialistes) deviennent évidents.
Elles vivent, malgré tout, ailleurs que dans les rapports, les journaux, les dispensaires.
Elles vivent dans une complexité dont aucun outil ne rend compte mieux que l’entretien.
Cependant le risque devient inverse d’avoir affaire à une femme trop complexe pour
l’historien, trop individuée pour asseoir une lecture de la collectivité à laquelle elle appartient
aussi. La richesse de la parole singulière vient de sa poétique propre, des souvenirs qui se
suscitent les uns les autres (beaucoup moins selon un ordre chronologique qu’une logique
affective), de la confiance dans le destinataire de cette parole lui-même impliqué par sa
recherche. Pour poser un regard sur cette matière qui induise une connaissance historique, la
logique du recueil a prévalu. Dans le recueil, chaque entretien exprime une identité tandis que
leur chœur fait entendre un accord partagé qui change de nature entre l’avant-guerre et les
années soixante-dix sans cesser d’être un accord. Il est devenu possible de discerner un

4
territoire d’histoire pertinent. En regardant la ville de Lyon au regard des Algériennes, les
Algériennes au regard de la ville de Lyon, leur histoire en métropole a pris quelques formes.
Alors que voit-on ? D’abord, l’histoire des Algériennes, à Lyon comme dans les
centres urbains où quelques chapitres en ont été écrits, apparaît comme une histoire des
lectures successives que différents acteurs font d’elles. Elle est, en ce sens, une histoire de
regards. En effet, il n’est pas une institution qui échappe aux discours sur les Algériennes : le
personnel administratif de la préfecture, celui de la justice, les femmes ou hommes politiques,
les forces de l’ordre, les journalistes, les assistantes sociales, les membres de la société civile
(militants associatifs ou politiques) ou religieuse (hommes d’église, paroissiaux), tous
dressent des portraits de ces femmes qui favorisent la naissance de structures leur venant en
aide ou les contrôlant. Car les Algériennes sont vues généralement comme un groupe
homogène dans lequel le singulier, l’individuel, a bien peu de place. Deux grilles de lecture
convergent, qui partent des mêmes postulats et arrivent aux mêmes résultats. La première
porte un regard d’évidence sur ces femmes : elles seraient immédiatement lisibles comme
femmes musulmanes inadaptées à la vie en métropole. La seconde part de l’enquête de terrain
pour aboutir à des conclusions conformes aux modèles dominants. Des détails, relevés dans
les témoignages ou dans les rapports quasi-ethnographiques des assistantes sociales, illustrent
une culture double traditionnellement vue en termes de manquements. On a ainsi pu montrer
combien ces regards ont en commun de prendre les Algériennes en défaut (d’instruction,
d’hygiène, etc.). Les sources s’accordent d’ailleurs avec les entretiens pour mettre en
évidence la convergence d’idées reçues et d’expériences vécues où se voit principalement une
assignation à un rôle assez proche de celui qui leur est dévolu depuis un siècle. Une histoire,
écrite pour une part à partir de leur propre regard, apporte pourtant un certain nombre de
correctifs. Elles font preuve d’une résistance au prêt-à-porter de l’intégration et récusent les
panoplies souvent simplistes dont les acteurs sociaux prétendent les revêtir. Elles choisissent
les éléments d’une culture composite où toute leur histoire reste lisible pour elles. Dès lors,
leur histoire s’avère avant tout comme celle de contraintes réinventées par l’évolution même
de leur cadre de vie dans un héritage culturel encore prégnant. Elles obligent à les compter
sans vraiment que le cœur administratif y soit et restent mécomptées. Elles provoquent une
justice qui renonce, le plus souvent, à les considérer aussi responsables que leurs compatriotes
masculins. Elles adoptent aussi clandestinement les postures de combattantes que celles des
lectrices de revue où les chanteurs dits « Yé-Yé » font la une. Peut-on compter leurs trajets
valise à la main ? Évaluer le sens d’une coupe de cheveux « à la Bardot » quand bien des
jeunes filles du temps l’adoptent ? Une femme insiste sur les élections de « miss France » que
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%