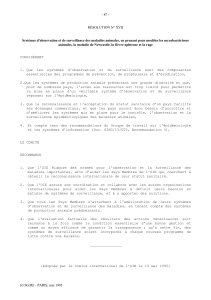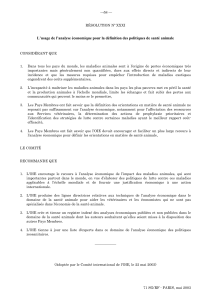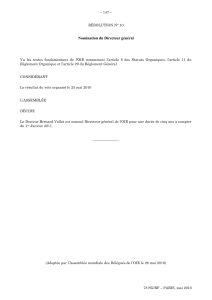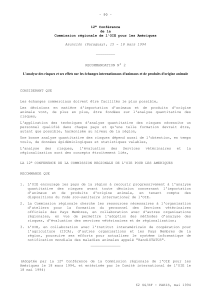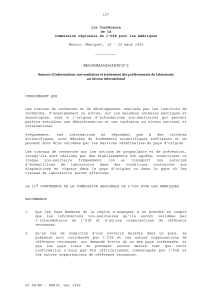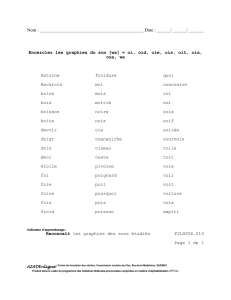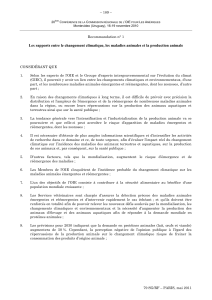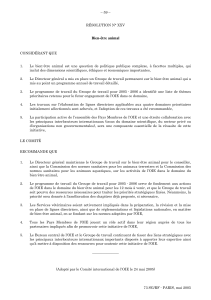17-eloit-577-584_chevalier 24/11/04

Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.
, 2012, 31 (2), 577-584
Le concept de bien public mondial,
promoteur d’une bonne gouvernance vétérinaire
M. Éloit
Organisation mondiale de la santé animale (OIE), 12 rue de Prony, 75017 Paris, France
Résumé
Originellement lié aux politiques économiques, le concept de bien public a
évolué, d’une part d’une application nationale à une reconnaissance mondiale
(bien public mondial) et, d’autre part, d’une application à la production de biens
à une prise en compte d’enjeux sociétaux (éducation, environnement, etc.) et de
droits fondamentaux dont le droit à la santé et à l’alimentation.
De par leurs actions, les Services vétérinaires, tels que définis par le
Code
sanitaire pour les animaux terrestres
de l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE), contribuent à l’amélioration de la santé des animaux et à la
réduction des pertes de production. Ils concourent ainsi directement et
indirectement tant à la sécurité alimentaire des populations qu’à la préservation
de leur santé et de leurs ressources économiques. Ainsi, leur organisation et
leur mode de fonctionnement sont-ils des éléments clés d’une gouvernance
efficiente, nécessaire pour atteindre ces objectifs.
De par sa mission stratégique de normalisation et grâce aux programmes que
l’Organisation déploie dans le cadre de son mandat au bénéfice des Services
vétérinaires de ses États Membres, l’OIE est un acteur majeur de la coopération
et de la gouvernance mondiale dans le domaine de la santé animale et de la
santé publique.
À ce titre, l’action des Services vétérinaires et de l’OIE mérite d’être reconnue en
tant que bien public mondial et d’être soutenue par des investissements publics
afin que tous les Services vétérinaires soient en mesure d’appliquer les
principes de bonne gouvernance et de respecter les normes internationales
relatives à la qualité des Services vétérinaires définies dans le
Code sanitaire
pour les animaux terrestres
et le
Code sanitaire pour les animaux aquatiques
de
l’OIE (Titre 3, respectivement « Qualité des Services vétérinaires » et « Qualité
des Services en charge de la santé des animaux aquatiques »).
Mots-clés
Bien public mondial – Gouvernance – Mondialisation – Normalisation – Santé publique
– Santé animale – Services vétérinaires.
Introduction
La mondialisation a multiplié les problèmes et complexifié
les modalités de leur résolution. Mais elle a aussi mis en
lumière les intérêts communs à des ensembles de pays,
voire aux citoyens, qu’il s’agisse de stabilité financière,
d’environnement, de santé ou d’accès aux savoirs. La
notion de « bien public mondial » (BPM) a ainsi
progressivement été conceptualisée et est désormais
largement utilisée pour légitimer la nécessité d’actions
publiques.
L’application de ce concept de bien public mondial au
secteur de l’agriculture, et plus particulièrement de
l’élevage, est cruciale dans un contexte de raréfaction de
certaines ressources, de changements écologiques des
zones de pâturages, d’émergence ou de diffusion de
maladies animales au-delà des frontières, et de crises
alimentaires durables. Il est donc intéressant d’en rappeler

578
Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.
, 31 (2)
2. un critère de non-exclusion des utilisations : l’usage ne
peut être réservé à certains et le bien est à la disposition de
tous.
À titre d’exemples : la lumière d’un phare guide
indistinctement tous les bateaux naviguant dans la zone ;
de même, le contrôle sanitaire des animaux et produits
animaux importés dans un pays par les Services
vétérinaires bénéficie à la collectivité des éleveurs en
abaissant le risque d’introduction de maladies pour
le bétail.
Ainsi, la production de ces biens publics relève-t-elle de
l’intérêt collectif. Mais comme elle est souvent peu
intéressante pour des acteurs privés qui visent la rentabilité
des investissements, il existe une forte probabilité que ces
biens ne soient pas produits, ou le soient en quantité
inadéquate. C’est pourquoi leur production par la
puissance publique apparaît comme la solution optimale et
elle devra être financée par l’impôt.
À partir des années 1990, la mondialisation va de pair avec
l’augmentation du poids des marchés, des décisions
économiques et du rôle des acteurs privés (7).
L’implication des pouvoirs publics, voire leur pouvoir,
pour infléchir les lois du marché sont mis en cause.
Souvent la recherche d’économies budgétaires et la
nécessité de rationaliser les dépenses ont conduit à des
restructurations et à la privatisation de certains domaines
relevant précédemment de la responsabilité du secteur
public. Les conséquences néfastes observées dans de
nombreux pays ont généré de profonds mécontentements
et l’incapacité des services publics à préserver des biens
d’intérêt général a été pointée du doigt. La
marchandisation des biens relevant de l’intérêt général
trouvait ses limites.
Parallèlement, l’émergence de préoccupations citoyennes
écologiques, voire la mise en œuvre de politiques
écologiques dans de nombreux pays contribuaient à
l’utilisation de ce concept dans une autre perspective, qui
n’est plus seulement économique.
Dans ce contexte, le débat sur les problèmes globaux est
renouvelé et le concept de bien public, formulé par Paul
Samuelson dans les années 1950 est adapté à la nouvelle
donne mondiale. La réflexion menée dans différentes
instances accrédite progressivement l’idée que les biens
publics les plus fondamentaux ne peuvent désormais être
que mondiaux.
Mais le consensus sur la définition d’un bien public
mondial s’avère difficile :
– certains conçoivent le concept de bien public mondial
comme un complément à l’ouverture des marchés par
l’introduction d’intérêts collectifs (paix et sécurité,
les fondamentaux afin d’en comprendre les tenants et
aboutissants, et notamment les implications pour les
politiques conduites en faveur des Services vétérinaires et
par ces Services. Car seule une utilisation à bon escient
permettra de conserver la pertinence du concept pour qu’il
demeure une notion protectrice.
Les Services vétérinaires nationaux sont des acteurs
institutionnels essentiels pour développer et mettre en
œuvre les politiques publiques garantissant la préservation
des ressources animales et contribuer à la réduction de la
pauvreté et de la faim dans le monde. Leurs actions en
matière de santé publique humaine contribuent également
au bien-être de la planète. C’est pourquoi, les moyens
structuraux et conjoncturels qui leur sont alloués pour
conduire à bien leurs programmes et assurer leurs
responsabilités selon les principes reconnus de « bonne
gouvernance » constituent des investissements dont les
bénéfices profitent au développement économique et social
de la collectivité.
À leurs côtés, l’Organisation mondiale de la santé animale
(OIE) œuvre à l’obtention d’un consensus international
pour l’élaboration de normes permettant une régulation
des échanges selon des règles sanitaires harmonisées. De
plus, l’adoption de normes et de lignes directrices en
matière de qualité et de bonne gouvernance des Services
vétérinaires contribue à la fédération des politiques et
améliore la confiance des bailleurs de fonds dans la
capacité des Services vétérinaires à gérer efficacement
les crises sanitaires ou à les prévenir pour en minimiser les
conséquences lorsque cela est possible.
Le concept
de bien public mondial
La notion de « bien public » (BP) a été longtemps réservée
aux biens nationaux et était plutôt appliquée au secteur
économique lorsque les défaillances du marché
encourageaient, voire légitimaient, l’intervention de la
puissance publique (3, 4, 6).
Dans ce domaine, les travaux de Paul Samuelson, prix
Nobel d’économie en 1970, sur les biens collectifs et sur
l’analyse économique des choix publics apparaissent
comme la référence historique.
Dans les années 1950, Paul Samuelson donnait une
définition d’un « bien public » reposant sur deux critères
principaux :
1. un critère de non-rivalité des consommations : la
consommation d’un bien public par une personne
n’entraîne aucune réduction de la consommation des
autres personnes ;

protection de l’environnement, etc.) et la prise en compte
de droits fondamentaux de la personne (droit à la santé, à
l’alimentation, etc.) nécessaires pour équilibrer une
mondialisation libérale du marché ;
– d’autres y voient plutôt un repli et un risque de blocage
qui représenteraient un retour à un interventionnisme
étatique considéré souvent comme inefficace.
De plus, les intérêts nationaux, les spécificités
socioculturelles ou les écarts de développement ne
facilitent pas l’obtention d’un accord unanime des pays sur
une telle définition.
Pourtant, le Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD) a tenté de donner une
définition en vue de conforter la légitimité des Objectifs du
millénaire pour le développement. Le PNUD a proposé un
classement en trois grandes catégories : les biens publics
mondiaux naturels (le climat, la biodiversité, etc.), les
biens publics mondiaux d’origine humaine (l’éducation, la
culture, etc.) et les biens publics mondiaux résultant de
politiques (la paix, la santé, la stabilité financière, etc.) (3).
Finalement, même si la typologie des biens pouvant être
reconnus comme biens publics mondiaux n’est pas
définitivement arrêtée, on peut cependant considérer que
ce qui se rapporte à la santé et à la sécurité alimentaire
bénéficie d’un consensus suffisant pour qu’il soit accepté –
tant par les États que par les organisations régionales et
internationales et les acteurs privés – que le concept
de bien public mondial est applicable aux programmes
de santé.
Qu’implique ce concept ?
L’universalité
En partant de la définition du bien public énoncée par
Paul Samuelson, Charles Kindleberger (5) définit les biens
publics mondiaux comme « l’ensemble des biens
accessibles à tous les États qui n’ont pas nécessairement un
intérêt individuel à les produire ».
Dans un domaine non économique, cette notion s’applique
parfaitement à l’environnement, à la qualité de l’air, de
l’eau, etc.
Cette définition souligne le caractère universel de ces biens
mais soulève également une question qui n’existe pas pour
les biens publics nationaux, à savoir celle de la
coordination entre les États liée à l’universalité du bien
public mondial, puisqu’il n’existe pas d’autorité
supranationale compétente pour gérer les problèmes
inhérents à la promotion et à la défense des biens publics
mondiaux.
Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.
, 31 (2) 579
La dimension intemporelle
ou transgénérationnelle
Les résultats positifs d’une gestion réussie ou, a contrario,
les conséquences néfastes d’une mauvaise gestion des biens
publics mondiaux, sont le plus souvent observables à
moyen ou long terme. Le décalage temporel entre un
évènement et son impact implique que la gestion des biens
publics mondiaux doit prendre en compte non seulement
l’intérêt de la génération présente, mais aussi celui des
générations futures (2).
Ainsi, les effets sur l’environnement et la santé de
l’utilisation irraisonnée de produits chimiques, les
déforestations massives pour gagner de nouvelles zones de
culture ou de pâturage, ou la surpêche de certaines espèces
de poissons modifiant l’équilibre de la chaîne alimentaire
marine, sont quelques exemples connus illustrant cette
notion.
L’universalité et la dimension intemporelle des biens
publics mondiaux redonnent une signification particulière
à la coopération internationale et à la gouvernance des
pouvoirs publics. En effet, l’exclusion de certaines
populations dans l’accès à ces biens (eau, alimentation,
santé, éducation, par exemple) tient souvent à un défaut de
politique de régulation internationale lorsque le niveau
national est lui-même défaillant.
La coopération internationale doit permettre (et faciliter) la
coordination entre les partenaires, et en premier lieu les
États. Les organisations internationales constituent un lieu
de concertation offrant une capacité d’expertise
indépendante et elles peuvent orchestrer la recherche du
consensus. Toutefois, la plupart des analyses soulignent
que la coopération internationale ne doit pas prédominer
sur le principe de subsidiarité, afin de maintenir un lien
entre la composante « coopération internationale des biens
publics mondiaux » et la composante « biens publics
nationaux ».
Une bonne gouvernance doit permettre de conforter les
capacités des pouvoirs publics à gérer de façon efficace et
équitable.
C’est pourquoi, ces mécanismes constituent désormais des
priorités pour la plupart des organisations internationales,
quel que soit leur mandat, à l’image :
a) de la mise en place d’un partenariat mondial en tant
qu’un des huit Objectifs du millénaire pour le
développement définis par le PNUD,
b) des éléments essentiels au bon fonctionnement des
systèmes de santé prônés par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) ou
c) des normes relatives à la qualité des Services
vétérinaires élaborées par l’OIE.

L’agriculture et l’élevage,
des priorités pour nourrir
la planète : la santé animale,
bien public mondial
L’agriculture et l’élevage ne sont pas considérés, en tant
que tels, comme des biens publics mondiaux mais ils sont
indirectement concernés du fait de leur impact sur la santé
humaine et animale.
En effet, certains biens publics mondiaux sont
interdépendants et des synergies peuvent même apporter
des bénéfices mutuels. Des progrès dans un domaine
peuvent engendrer des améliorations dans d’autres
secteurs.
La santé animale a pu ainsi être prise en compte grâce aux
interconnections avec les enjeux :
– de santé publique, liés aux zoonoses,
– de protection de l’environnement et de la biodiversité,
liés aux maladies et à la préservation de la faune sauvage,
– du développement durable, compte tenu de l’évolution
des systèmes de production.
Depuis plusieurs années, les crises alimentaires ont rappelé
aux décideurs mondiaux que « nourrir la planète » restait
une priorité primaire essentielle alors que les trois quarts
des familles pauvres ne subsistent que par leur production
agricole vivrière et que l’impact des maladies animales sur
leur cheptel obère significativement leurs ressources et
l’avenir de leurs enfants.
Désormais, non seulement la santé mais aussi l’agriculture
et l’élevage sont des sujets inscrits systématiquement à
l’agenda des grandes instances internationales G8 et G20.
Améliorer la production agricole est reconnu comme une
nécessité pour lutter contre la faim et la pauvreté.
La première réunion des ministres de l’Agriculture du G20,
tenue à Paris les 22 et 23 juin 2011 en est l’expression la
plus parfaite. Face à une situation toujours préoccupante,
les ministres ont rappelé la nécessité de politiques agricoles
plus efficaces à l’échelle mondiale et nationale et le besoin
d’une meilleure coordination internationale (8).
Les ministres ont notamment insisté « sur l’importance, en
matière de santé publique, animale et végétale, de renforcer
les réseaux internationaux et régionaux, l’établissement de
normes internationales tenant compte des différences
nationales et régionales, les systèmes d’information, de
surveillance et de traçabilité, la bonne gouvernance et les
services officiels, car ils permettent de détecter
Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.
, 31 (2)
580
précocement et de réagir rapidement aux menaces
biologiques, facilitent les flux commerciaux et contribuent
à la sécurité alimentaire mondiale. [Les ministres ont
encouragé] les organisations internationales, notamment
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), l’OMS, l’OIE, la Commission du
Codex Alimentarius (Codex), la Convention internationale
pour la protection des végétaux (CIPV) et l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) à poursuivre leurs efforts
de coopération permettant ainsi une meilleure mobilisation
des financements publics et privés pour des programmes et
initiatives. »
L’orientation des engagements des principaux bailleurs
de fonds publics (Banque mondiale, Union européenne)
ou privés (fondations) témoigne de la prise en compte de
cette nouvelle approche. La prévention et le contrôle
des maladies animales transmissibles et le risque pour les
populations sont considérés comme relevant de l’intérêt
général international. Et l’intérêt d’encourager
les programmes de prévention pour diminuer les risques
est également un message entendu (11). « Mieux vaut
prévenir que guérir » !
La crise économique et sociale liée à l’influenza aviaire dans
les années 2005-2006 a vraisemblablement permis cette
prise de conscience, confortée par plusieurs études
économiques internationales rappelant le coût exorbitant
des crises sanitaires dues à des maladies animales.
Ainsi, trois études économiques commanditées par l’OIE
sur la prévention et le contrôle des maladies animales dans
le monde, cofinancées par la Banque mondiale et
présentées lors d’une conférence organisée conjointement
par la Banque mondiale et l’OIE en collaboration avec
la FAO, ont-elles mis en évidence que le coût de la
prévention de ces maladies grâce à des réseaux de
surveillance appropriés d’éleveurs et de vétérinaires, restait
extrêmement faible comparé à celui des crises (cf. Partie I :
Analyse économique – Coûts comparés de la prévention et
de l’éradication des foyers). Ces études ont également
souligné l’importance de la gouvernance vétérinaire (9).
Dans la même ligne, le rapport publié par la Banque
mondiale en 2010 sous le titre People, Pathogens and Our
Planet; Volume 1: Towards a One Health Approach for
Controlling Zoonotic Diseases (1) a mis en exergue, chiffres à
l’appui, que les maladies animales ont un impact
économique essentiel sur la pauvreté et un impact
significatif sur la santé des populations, handicapant
l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le
développement. À titre d’exemple, les rédacteurs du
rapport estiment que les crises liées à l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB), au syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) et à la grippe aviaire due au virus H5N1 ont
coûté plus de 20 milliards de dollars US au titre des pertes
économiques directes au cours de la dernière décennie, et

Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.
, 31 (2) 581
plus de 200 milliards de dollars US en pertes indirectes
(fermeture de frontières, pertes de marchés, contrôle des
flux commerciaux, diminution du tourisme, etc.). Bien sûr,
cela est sans compter le coût récurrent des nombreuses
maladies d’élevage, de dimension zoonotique (brucellose,
tuberculose, etc.) ou non (mammites, parasitisme, etc.)
qui dégradent la productivité des élevages et grèvent les
revenus des éleveurs et des professionnels associés. En
conséquence, toutes actions visant à prévenir l’émergence
puis à contenir la propagation des maladies animales
apparaissent comme pouvant contribuer à limiter les
pertes économiques. Dans ce cadre, les investissements
consentis pour soutenir l’organisation structurée de
Services vétérinaires publics et d’organisations
professionnelles privées travaillant dans un partenariat
réciproquement bénéfique sont analysés par les grands
bailleurs de fonds mondiaux comme des investissements
de protection du bien public mondial qu’est la
santé animale.
Les Services vétérinaires
œuvrent pour la santé animale,
bien public mondial
Dans un monde où les frontières sont ouvertes et les
échanges transfrontaliers de plus en plus nombreux, la
probabilité qu’une défaillance locale se répercute au-delà
du territoire national est haute.
Les spécialistes s’accordent pour reconnaître
qu’un développement national responsable est le point de
départ et la pierre angulaire d’une mondialisation durable,
selon la formule « La coopération internationale
commence chez soi ».
Selon la définition donnée par le Code sanitaire pour
les animaux terrestres de l’OIE (10), les Services vétérinaires
s’entendent comme « les organismes publics ou privés qui
assurent – sous la responsabilité et le contrôle de l’Autorité
vétérinaire gouvernementale – la mise en œuvre, sur
le territoire d’un pays, des mesures relatives à la protection
de la santé et du bien-être des animaux terrestres
et aquatiques ».
Les Services vétérinaires sont en première ligne pour
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sanitaires et
des programmes de lutte contre les maladies animales.
Les objectifs de réduction des pertes de production, de
protection de la santé du cheptel et indirectement de
la santé publique par la prévention des zoonoses et des
infections d’origine alimentaire, conduisent les Services
vétérinaires à inscrire leur action dans des politiques plus
larges de lutte contre la faim, de réduction de la pauvreté
et de développement économique.
À ce titre, ils sont des acteurs essentiels pour la
préservation de l’état de santé des cheptels.
C’est pourquoi, il est primordial que les politiques
publiques soutiennent le développement et le
renforcement de Services vétérinaires nationaux structurés,
ayant les ressources humaines et les moyens financiers
adaptés à leurs missions et fonctionnant selon une chaîne
de responsabilité hiérarchisée. Toute défaillance des
moyens ou l’éclatement des missions entre plusieurs
services relevant d’autorités différentes ne peuvent qu’avoir
des conséquences négatives sur la pérennité et l’efficience
des programmes de santé animale.
Dès lors que la santé animale est considérée comme un
bien public, et dans un monde interdépendant où
l’harmonisation des politiques de santé et de bien-être
animal est devenue nécessaire pour une gestion collective
des maladies transfrontalières, il est souhaitable que ces
politiques s’inscrivent dans un cadre durable selon une
programmation cadre qui perdure au-delà des clivages
politiques nationaux ou des à-coups économiques.
Le rôle de l’OIE
Dans son discours prononcé lors du G20 des Ministres
de l’Agriculture (Paris, juin 2011), Monsieur Le
Maire, Ministre français déclarait : « Nous sommes
convaincus qu’une gouvernance mondiale forte est
indispensable pour atteindre la sécurité alimentaire
mondiale », témoignant ainsi que le « comment » de la
gestion de la mondialisation préoccupe les décideurs
politiques. La préconisation d’un renforcement de la
coopération internationale conforte les organisations
internationales, telles que l’OIE, dans leur mandat pour
favoriser l’interaction institutionnelle (8).
Les pays sont invités à dépasser les enjeux nationaux et les
instances internationales leur apportent un lieu de
concertation.
Reconnue par l’OMC comme l’organisation internationale
en charge de l’élaboration des normes sanitaires pour les
échanges internationaux des animaux terrestres et
aquatiques et de leurs produits dans le cadre du mandat
confié par l’Accord sur l’application des mesures sanitaires
et phytosanitaires (Accord SPS), l’OIE a une légitimité dans
la production d’un droit international en la matière.
La représentativité de l’OIE qui regroupe 178 Pays
Membres rend cet encadrement normatif d’autant plus
significatif et efficace.
Par ailleurs, au regard des caractéristiques d’universalité et
de la dimension transgénérationnelle du concept de « bien
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%