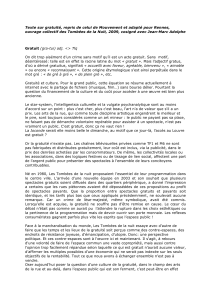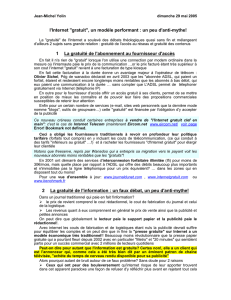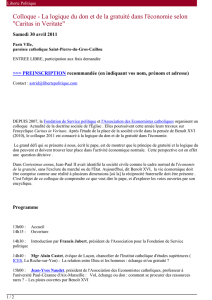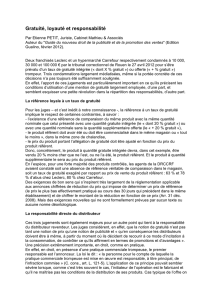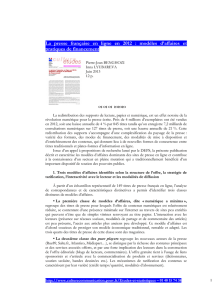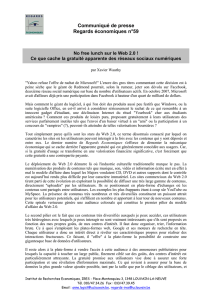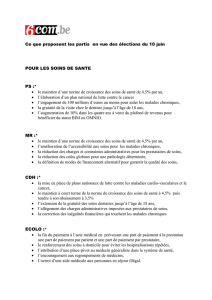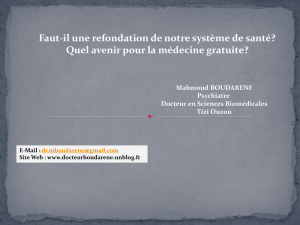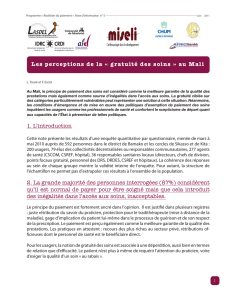Untitled - Presses des Mines


Joëlle Farchy, Cécile Méadel et Guillaume Sire, La Gratuité, à quel prix ? Circulation et
échanges de biens culturels sur Internet. Paris, Presses des Mines, Les Cahiers de l’EMNS,
2015.
© Presses des MINES – TRANSVALOR, 2015
60, boulevard Saint-Michel
75272 Paris Cedex 06
France
www.pressesdesmines.com
ISBN : 978-2-35671-201-1
Les illustrations appartiennent aux auteurs sauf mention contraire.
© Illustration de couverture : Quitterie de Castelbajac
Dépôt légal 2015
Achevé d’imprimer en 2015 (Paris)
Tous droits de reproduction, de traduction, d’adaptation et d’exécution réservés pour tous les pays.

La Gratuité, à quel prix ?
Circulation et échanges de biens culturels sur Internet

Collection Les Cahiers de l’EMNS
Joëlle Farchy et Camille Jutant, Qui a peur du marché de « l’occasion numérique ? ».
La seconde vie des biens culturels
Joëlle Farchy et Cécile Méadel (dir.),
Anna Bernard, Mathilde Gansemer, Jessica Petrou,
Télécharge-moi si tu peux. Musique, lm, livre

La Gratuité, à quel prix ?
Circulation et échanges de biens culturels sur Internet
Joëlle Farchy, Cécile Méadel et Guillaume Sire
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%