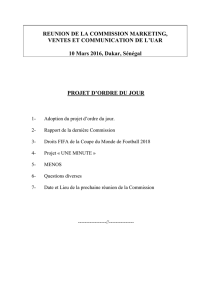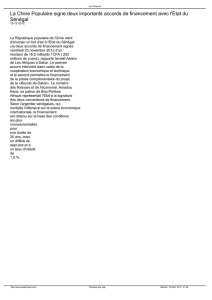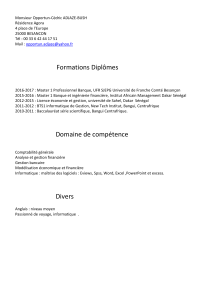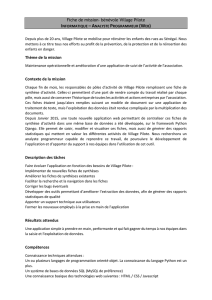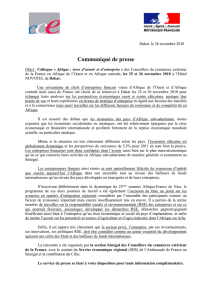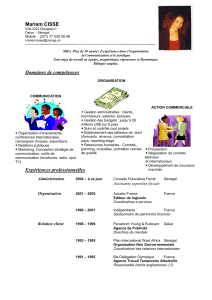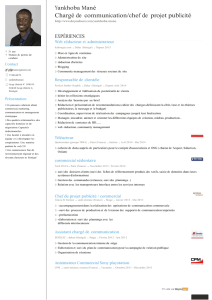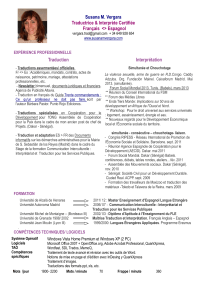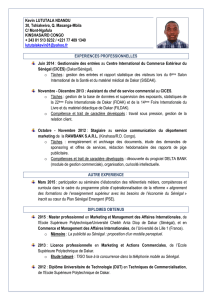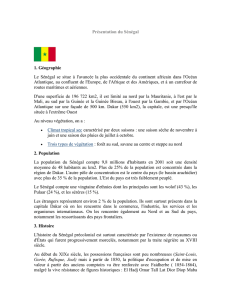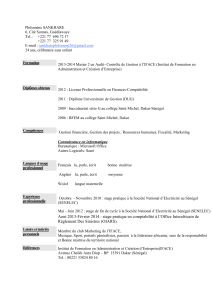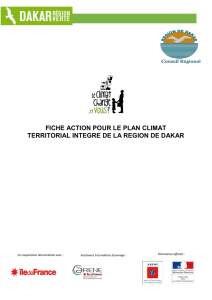le cancer vésical au sénégal, expérience du laboratoire d`anatomie

Médecine d'Afrique Noire : 1996, 43 (6)
Les cancers vésicaux, apparemment moins nombreux dans
le pays, n’expriment pas moins cette physionomie particu-
ière du “cancer africain”. Entrant dans un écosystème don-
né, ils posent d’emblée par leur simple présence sur une
terre d’endémie bilharzienne le problème étiologique du
cancer bilharzien.
Il nous a paru intéressant de rapporter l’expérience acquise
au cours de ces dernières années au laboratoire d’Anatomie
et de Cytologie Pathologiques du C.H.U de Dakar.
MATÉRIEL ET MÉTHODES D’ÉTUDE
Le matériel de ce travail concerne des dossiers utilisables
de cancers vésicaux colligés au laboratoire d’Anatomie
pathologique du C.H.U. de Dakar (Hôpital A. Le Dantec et
Faculté de Médecine) entre 1970 et 1993 soit durant
24 années.
Dans cette étude rétrospective, nous avons retenu 82 cas
concernant des biopsies ou pièces opératoires de vessie
tumorale. Nous nous sommes intéressés aux renseigne-
ments cliniques et paracliniques et à l’examen anatomo-
pathologique détaillé.
La plupart de ces dossiers provient des services chirurg i -
caux du CHU, de certaines structures sanitaires de Dakar
ou des autres régions du Sénégal.
L’étude anatomo-pathologique faite sur les prélèvements
biopsiques et les pièces opératoires n’a exigé que dans de
rares cas des techniques spéciales. Généralement un exa-
men macroscopique a été fait avant et/ou après fixation au
formol neutre à 10%.
La coloration standard à l’Hématoxyline-Eosine a suffi à
faire l’étude microscopique dans la plupart des cas.
Cependant certains aspects histologiques particuliers ont
nécessité des techniques spéciales telles que le P.AS, le
Mucicarmin et le Trichrome de Masson.
LE CANCER VÉSICAL AU SÉNÉGAL,
EXPÉRIENCE DU LABORATOIRE D’ANATOMIE
PATHOLOGIQUE DU C.H.U DE DAKAR (SÉNÉGAL)
J.M. DANGOU, V. MENDES, I.A. BOYE, G. WOTO-GAYE, P.D. NDIAYE.
Laboratoire d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques, Faculté de
Médecine Université C. Anta DIOP. Dakar (Sénégal).
INTRODUCTION
L’un des aspects de la pathologie des Tropiques est sans
nul doute le cancer chez le noir.
Au Sénégal, les manifestations de cette cancérologie tropi-
cale, sont dominées par les nombreux ulcères cancérisés de
jambe, les hépatomes malins, les néoplasmes du col utérin
et du sein, rencontrés quotidiennement dans la pratique
hospitalière.
RÉSUMÉ
Les cancers de vessie sont d’observation courante en
pratique quotidienne urologique à Dakar.
Entre Janvier 1970 et Décembre 1993, 82 cas de cancer
vésical ont été colligés au laboratoire d’Anatomie et de
Cytologie Pathologiques du CHU de Dakar.
La prévalence de cette pathologie est située à 2,3% de
l’ensemble des cancers au Sénégal. L’âge moyen de sur-
venue est de 46 ans avec atteinte plus précoce de la fem-
me.
Le Carcinome malpighien est le type histologique le plus
fréquent (62,2%) et n’est pas toujours associé à des
lésions bilharziennes.
Mots clés : Vessie, cancers, bilharziose
SUMMARY
Urinary bladder cancers are currently observed during
urologic practice in Dakar.
F r om January 1970 to December 1993, 82 cases of
bladder cancers were received at the department of
Pathology of Dakar University Hospital. The main
p revalence of this pathology is about 2,3% and it sur-
vains generally at 46 years old. Women are pre c o -
ciously affected.
Epidermoid carcinomias are more frequent (62,2%) and
do not always coexist with schistosomiasis.
Key-words : Urinary bladder, cancers, shistosomiasis.

Médecine d'Afrique Noire : 1996, 43 (6)
RÉSULTATS
1) Prévalence
Durant la période étudiée, la prévalence des cancers de
vessie par rapport à l’ensemble des cancers se situe autour
de 2,3%.
2) Répartition selon le sexe
Il y avait dans notre série 39 hommes soit 47,2% et
43 femmes soit 52,8%.
3) Distribution en fonction de l’âge
Elle est reprise au tableau 1.
Tableau 1 : Répartition des cas en fonction de l’âge
Hommes Femmes
Age (Années) Nb % Nb % Total
11-20 2 2,44 1 1,22 3
21-30 4 4,88 9 10,97 13
31-40 4 4,88 14 17,07 18
41-50 10 12,19 7 8,54 17
51-60 8 9,76 10 12,19 18
61-70 7 8,54 2 2,44 9
Plus de 70 4 4,88 0 0 4
L’âge moyen de survenue du cancer vésical est de 51,05
ans chez l’homme, 42,04 chez la femme et 46,69 ans pour
les deux sexes.
Le patient le plus jeune est de sexe masculin, il a 12 ans et
présente un lymphome lymphoblastique sans schistoso-
miase associée.
Le patient le plus âgé a 88 ans et souffre d’un adénocarci-
nome sans schistosomiase associée.
Sur les 82 cas, 51 (62,2%) ont moins de 50 ans et 27
(32,9%) entre 51 et 70 ans.
4) Aspects morphologiques
Les examens macroscopiques décrivent une masse à large
base d’implantation, nécrotico-hémorragique en surface ;
dans d’autres cas, la tumeur est exophytique, remplissant la
cavité vésicale, envahissant toute l’épaisseur de la paroi et
atteignant les organes voisins avec parfois perméation cuta-
née.
Les tumeurs furent classées histologiquement en 6 groupes
selon une légère modification du système du “British
Institut of Urology (Dukes ; 1959)” : cancer urothélial,
cancer métaplasique de type épidermoïde, cancer anapla-
sique, adénocarcinome, sarcome et tumeurs rares.
Tableau 2 : Répartition des cas
en fonction du type histologique
Types histologiques Nombre %
Cancer malpighien 51 62,2
Cancer urothélial 22 26,6
Adénocarcinome 5 6,1
Sarcome 3 3,7
Lymphome 1 1,2
Total 82 100
Les cancers malpighiens apparaissent histologiquement
plus ou moins bien différenciés avec une maturation kérati-
nienne sous forme de perles cornées.
5) Association cancer vésical-schistosomiase
Dans 9 cas sur 82 patients soit 11% en valeur relative, nous
avons retrouvé au sein de la tumeur ou à son voisinage
dans la paroi vésicale, des oeufs de schistosome, il s’agis-
sait de Schistosoma haematobium.
La tumeur associée à cette parasitose chez 7 sujets est de
type épidermoïde, et, chez les deux autres, elle est papil-
laire urothéliale. Les autres tumeurs à savoir les adénocar-
cinomes, les sarcomes et le lymphome ne comportaient pas
de signes histologiques de bilharziose sur les prélèvements
examinés.
6) Distribution géographique des patients
Notre laboratoire reçoit des échantillons venant de Dakar,
sa banlieue mais aussi de toutes les régions du Sénégal.
Par ordre de fréquence dans notre série, les Ouolofs pas-
sent en tête (42,6%), suivis par les Toucouleurs (15,8%),
les Peulhs (14,6%) et les Sérères (12,2%). Les autres
ethnies se partagent le reste.
DISCUSSION
Un certain nombre de réserves sont à faire avant tout com-
mentaire. Au Sénégal, comme dans la plupart des pays
J.M. DANGOU, V. MENDES, I.A. BOYE, G. WOTO-GAYE, P.D. NDIAYE.
363

Médecine d'Afrique Noire : 1996, 43 (6)
africains et même dans certains pays industrialisés, il
n’existe pas de données statistiques précises sur le nombre
de patients cancéreux.
Le faible nombre de cas dans notre série est dû au fait que
de nombreux patients n’ont pu bénéficier d’un examen
anatomo-pathologique pour des raisons économiques ou
techniques.
Nos chiffres sont alors sous-estimés et doivent être revus à
la hausse.
La prévalence du cancer vésical au Sénégal est de 2,3% de
l’ensemble des cancers ; elle est à peu près identique à celle
observée en Afrique noire (Tableau 3) et dans la série publiée
à Dakar en 1987 par DIAGNE et Collaborateurs (2).
Tableau 3 : Prévalence du cancer vésical dans
certains pays africains d’après Malick (1)
Pays Fréquence Cancer Vésical
Kenya (Linsell, 1968) 1,0%
Ghana (Edington, 1956) 2,1%
Nigéria (Edington, 1967) 2,3%
Sénégal (Dangou 1994) 2,3%
Sénégal (Diagne, 1987) 2,4%
Tanzanie (Linsell, 1968) 2,6%
Soudan (Malick, 1975) 3,1%
Ouganda (Davies, 1965) 4,1%
Mozambique (Pratees, 1958) 7,6%
Egypte (A. Nasr, 1962) 11,0%
La plupart des travaux de la littérature (3, 4 ,5) montre une
prépondérance masculine du cancer de vessie. Mais à
Dakar cela n’a pas été retrouvé.
La répartition des cas selon l’âge fait apparaître que 62,2%
des patients ont moins de 50 ans et l’âge moyen du cancer
vésical est de 46 ans. L’atteinte plus précoce de la femme
ne trouve pas de justification. DIAGNE et co-auteurs (2)
dans une série de 336 observations trouvent que l’âge
moyen de survenue se situe autour de 35 ans.
L’analyse des données ethniques est peu probante et sujette
à de nombreuses cautions.
A Dakar, la population est cosmopolite et on y retrouve un
panorama des différentes ethnies sénégalaises. L’ o r i g i n e
géographique exacte des patients est alors difficile à pré-
ciser.
Les données histopathologiques montrent une prépondé-
rance du Carcinome malpighien (62,2%). Ce chiff r e
concorde avec celui des pays où l’endémie bilharzienne
sévit (1). Mais nos coupes ne retrouvent des lésions bilhar-
ziennes que dans 11 cas. Ce taux est relativement faible
compte tenu de l’importance de l’endémie bilharzienne
sévissant essentiellement dans la partie nord du Sénégal et
dans le bassin casamançais.
Il est à noter que sur une biopsie l’absence d’oeufs de bil-
harzie n’exclut pas une infestation bilharzienne ; l’appré-
ciation d’une relation entre le degré d’infestation et le type
de cancer est alors délicate.
Ceci nous amène à nous interroger sur le rôle étiopatho-
génique de la bilharziose dans la survenue du cancer vési-
cal au Sénégal.
Trois grands groupes de facteurs sont incriminés dans la
genèse du carcinome vésical ; les agents infectieux au 1er
rang desquels arrivent la bilharziose, jouent indubitable-
ment un rôle déterminant.
Mais comme le montrent nos échantillons les lésions bil-
harziennes ne coexistent pas toujours avec le cancer. Les
agents carcinogènes vésicaux “certains” (essentiellement
toxiques) n’ont pas été retrouvés dans les antécédents de
ces patients.
Il est permis de penser qu’en dehors de la bilharziose, en
Afrique un nombre non négligeable d’autres facteurs, en
l’occurrence irrittatifs et viraux concourent à la genèse de
ce néoplasme. L’hypothèse d’une infection virale par un
type du groupe des Papoviridae (HPV) mérite de retenir
l’attention.
CONCLUSION
Le cancer vésical à Dakar présente une physionomie par-
ticulière ; cette étude ne nous apporte aucun fait permettant
d’affirmer de façon formelle l’étiologie exclusivement bil-
harzienne de ces cancers. Mais de nombreuses observa-
tions cliniques et épidémiologiques nous incitent à penser
que la bilharziose vésicale comme du reste les cystites
chroniques diverses, les rétentions d’urine, les lithisases
vésicales et les prédispositions raciales et individuelles,
apportent quelque contribution dans la genèse de ces
tumeurs.
LE CANCER VÉSICAL… 364

Médecine d'Afrique Noire : 1996, 43 (6)
365 J.M. DANGOU, V. MENDES, I.A. BOYE, G. WOTO-GAYE, P.D. NDIAYE.
La lutte contre le sous-développement par les travaux
d’irrigation en zone tropicale risquent d’en augmenter la
fréquence. Il devient primordial d’affiner les méthodes de
diagnostic précoce que sont la cytologie urinaire et la cys-
toscopie, afin d’appliquer des thérapeutiques adéquates et
efficaces au moment opportun.
BIBLIOGRAPHIE
1 - M.O. MALICK, B. VERESS, E.H. DAOUD, A.M. EL HASSAN
Pattern of bladder cancer in the Sudan and its relation to schistosomiasis :
a study of 225 vesical carcinomas.
J. Trop. Med. Hyg. 1975 78 (10-11) : 219-223.
2 - B.A. DIAGNE, M. BA, S.M. GUEYE, A. WANDAOGO, A. TOURE,
A. MENSAH
Les particularités des cancers vésicaux en milieu sénégalais : analyse de
336 observations.
Bull. Soc. Frçse. Canc. Privé 1987 16 (6) : 95-100.
3 - K.G. BRAND
Schistosomiasis-cancer : etiological considerations.
Acta Tropica, 1979, 36, 203-214.
4 - J.P. COULAND, A. MOULONGUET
Le cancer sur vessie bilharzienne : A propos de six observations.
Annales d’Urologie, 1986, 20 (3) : 213-217.
5 - J. DOCQUIER, B. SOURABIE
Cancer de vessie. Aspects épidémiologiques, cliniques et histologiques en
République du Niger.
Acta Urologica Belgica, 1987, 55 (3) : 373-379..
1
/
4
100%