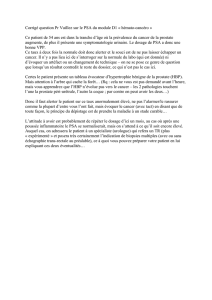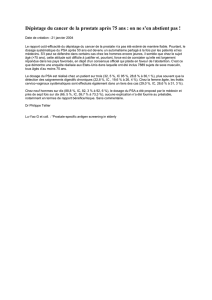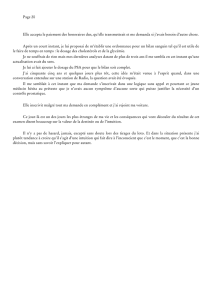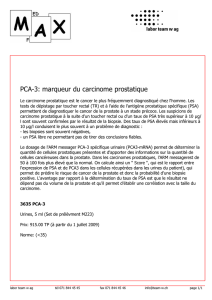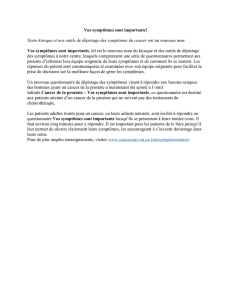Télécharger l`article

la Revue Médico-Chirurgicale
du CHU de Charleroi
Dans ce numéro hors série :
La clinique de la
prostate

2
La Revue Médico-chirurgicale du CHU de Charleroi, RMC, a vu le jour en 2009.
Elle est disponible sur le web http://www.chu-charleroi.be/ RMC. Son intérêt est
de rapporter une information médicale utile à l’usage pratique. Elle permet aux
membres de l'ISPPC de présenter des articles originaux touchant des sujets mé-
dicaux, paramédicaux, statistiques et autres.
Notre esprit d'ouverture est bien entendu présent et une invitation à collaborer
avec d'autres institutions est souhaitée. Une participation des médecins généra-
listes qui aimeraient présenter des sujets qui les tiennent à cœur est bienvenue.
Comme vous l’avez constaté, nous innovons avec ce premier numéro « hors
série » de la RMC consacré à l'urologie.
Lorsque le Professeur Wespes, soucieux de tenir à jour des informations récentes
sur le cancer de prostate, nous a soumis un projet intitulé « La Clinique de la Pros-
tate », c’est avec un réel plaisir que notre équipe de la RMC a accepté de publier
ce projet en toute indépendance et en format papier.
Grâce à votre collaboration, nous souhaitons poursuivre, tous ensemble, cette
magnifique aventure : à vos plumes
Dr Olivier Gilbert, Rédacteur en Chef RMC
• Introduction : ........................................................................................ 2
• Hypertrophie bénigne de la prostate (HPB) : ......................................... 4
Cancer de la prostate :
• Prévention : alimentation, compléments nutritionnels ............................ 6
• Classification de Gleason ...................................................................... 8
• Le dépistage du cancer de la prostate : utilité du PSA ........................ 10
• Classification du Cancer prostatique ................................................... 14
• Traitement chirurgical .......................................................................... 17
• Traitement radiothérapique.................................................................. 18
• Traitement hormonal du cancer de prostate ....................................... 20
• Traitement du cancer prostatique devenu hormono-résistant ............. 22
Rédacteur en Chef
Docteur Olivier Gilbert
Rédacteurs Adjoints
Docteur Guy Bruninx
Docteur Philippe Rondeaux
Responsable Informatique
Docteur André Vandenberghe
Secrétariat
Madame Béatrice Pol
Maquette & mise en page
Monsieur Frédéric Noël
Président d’Honneur
Docteur Philippe Gilbert
Comité de la Revue
Docteur Sofiane Boulares
Docteur Dany Brohee
Docteur Eric Carlier
Docteur Nabil Daoudi
Docteur Sebastien Debroux
Docteur Didier Dequanter
Docteur Badih El Nakadi
Docteur Eric Guerin
Docteur Benoit Guillaume
Monsieur Lambert Lesoil
Docteur Joëlle Philipp
Docteur Thibaut Richard
Monsieur Serge Stenuit
Éditorial
Sommaire
Comité de rédaction

3
Clinique de la prostate
Introduction
À partir de la cinquantaine, l’homme peut souffrir de
problèmes prostatiques. La glande prostatique est un organe
sexuel secondaire masculin, située au carrefour urogénital et
qui sécrète un liquide nécessaire aux spermatozoïdes.
Par l’augmentation de son volume, l’adénome prostatique
peut entraîner des symptômes irritatifs ou obstructifs qui
altèrent la qualité de vie du patient.
Plus insidieux, le cancer de prostate est devenu le premier
cancer de l’homme après 60 ans et la deuxième cause de
mort par cancer.
Nous avons créé une véritable clinique de la prostate avec
pour but de prendre en charge les patients touchés par ces
symptômes prostatiques ou chez qui un cancer asymptoma-
tique de la prostate a été révélé. Nous avons souhaité réaliser
une mise au point actualisée de ces deux pathologies en
rapportant succinctement les dernières données scientifiques
rapportées dans la littérature tout en les assimilant à notre
pratique quotidienne.
Professeur Eric Wespes

Docteur Daniel Naômé
4
Hypertrophie bénigne de la prostate (HPB)
La prostate est sous androgénodépen-
dance et a un rôle dans la fertilité en
sécrétant le plasma séminal. D’un point de
vue physiopathologique, le déséquilibre du
rapport androgènes/oestrogènes et le rôle
de la dihydro-testostérone (5 α-réductase)
participent au développement de la patho-
logie prostatique.
Dans la genèse des troubles mictionnels,
interviennent une composante mécanique
(volume et forme de la prostate) et une
composante fonctionnelle (dysectasie cer-
vicale) ; l’évolution se fait habituellement par
poussées.
Ces troubles mictionnels sont
recherchés à l’anamnèse :
•pollakiurie diurne et nycturie ;
•dysurie ;
•impériosité (urgences mictionnelles) ;
•incontinence urinaire ;
•pesanteur pelvienne.
Des questionnaires validés sont disponibles
et permettent de quantifier objectivement
les désordres prostatiques.
Plusieurs stades évolutifs de
l’HPB sont décrits :
stade I : prostatisme = symptomatologie
fonctionnelle = lutte.
stade II : rétention chronique = décom-
pensation.
stade III : rétention chronique avec disten-
sion = distension.
Ces différents stades peuvent entraîner un
retentissement sur la vessie (vessie de
force, diverticules, résidu post-mictionnel)
et sur les voies urinaires supérieures (uré-
téro-hydronéphrose, insuffisance rénale).
Les complications de l’adénome
prostatique peuvent être :
•l’insuffisance rénale ;
•l’incontinence urinaire par regorgement ;
•l’infection urinaire ;
•la lithiase vésicale ;
•la rétention aiguë (mécanisme mécanique
et/ou fonctionnel) ;
•l’hématurie.
Cette symptomatologie et ces complica-
tions sont et seront les signes d’appel de
la pathologie prostatique.
Le diagnostic de l’adénome
prostatique est confirmé par :
•la biologie : fonction rénale et PSA
(< 4 ng/ml) sensible mais peu spécifique ;
•l’échographie prostatique par voie trans-
rectale (Fig. 1) évalue le volume de la
prostate et son organisation mais reste
peu fiable pour le dépistage du cancer
(PSA-densité = Concentration PSA/Vo-
lume échographique) ;
•la débitmétrie apprécie et chiffre la mic-
tion en quantifiant la dysurie ;
•enfin, la fibroscopie permet de visualiser
l’hypertrophie prostatique et de vérifier
l’intégrité vésicale en cas d’hématurie.
Coupe transversale
Coupe longitudinale
Fig. 1 : Echographie prostatique par voie transrectale.

5
Le traitement
Tous les adénomes de la prostate ne doi-
vent pas être traités. La surveillance aura
pour but d’évaluer l’évolution de la patho-
logie. Seuls les patients perturbés par les
troubles prostatiques seront traités.
Le traitement médical s’est étoffé
au cours des dernières années :
•la phytothérapie : Urgenin° (Extr. Sabal
Serrulatum et Echinacea purp), 3 x 30
gtt/j et Prosta-Urgenin/Prostasérène
(Serenoa Repens), 1 gél. à 320 mg/j,
leurs effets par rapport au placebo sont
cependant faibles ;
•les alpha-bloquants : Hytrin (Térazosine)
1 co à 2 ou 5 mg/j au coucher, Omic
Ocas (Tamsulosine) 1 co à 0,4mg/j, Xatral
(Alfuzosine) 1 co à 5 ou 10 mg/j (surtout
en cas de dysurie sur pathologie cervi-
cale), surtout pour des prostates de petits
volumes avec un effet rapidement évalua-
ble ;
•les inhibiteurs de la 5-α-réductase (traite-
ment hormonal) : Proscar (Finastéride)
1 co à 5 mg/j, Avodart (Dutastéride) 1 co
à 5mg/j, ils sont prescrits pour des pros-
tates dont le volume excède 50 g, leur ef-
ficacité n’est appréciée qu’après quatre
à six mois de traitements ;
•combinaison d’un ß-bloquant et d’unin-
hibiteur de la 5-α-réductase, Combodart
(Dutastéride 0,5 mg + Tamsulosine 0,4
mj) 1co/j.
Le traitement chirurgical consiste en :
•la résection endoscopique de la prostate
(volume inférieur à 50 cc en échographie) ;
•l’adénomectomie chirurgicale par voie
transcapsulaire (Millin) ou transvésicale
(Hryntschak).
Les indications de la chirurgie reposent sur
la sévérité de la symptomatologie et son
impact sur le confort du malade, les com-
plications et le volume de l’hypertrophie
prostatique.
Parmi les complications opératoires, il faut
retenir les hémorragies, l’infection urinaire,
l’incontinence et le syndrome de résection
endoscopique, du à la résorption de liquide
opératoire. Depuis peu, nous disposons de
résecteurs à courant bipolaire utilisant du
sérum physiologique et permettant d’éviter
ainsi l’hyponatrémie. De plus, certaines
électrodes vaporisent le tissu prostatique et
réduisent ainsi le saignement (Fig. 2).
A côté des techniques conventionnelles, il
existe des fibres lasers dont les résultats
sont variablement appréciés.
Les plaintes postopératoires peuvent
consister en une persistance de la pollakiu-
rie, une reprise de la dysurie (sténose, réci-
dive d’adénome ou apparition d’un cancer
sur coque restante), une incontinence
urinaire et des troubles sexuels (éjaculation
rétrograde).
Le rôle du médecin généraliste est impor-
tant dans l’information du malade et sa sur-
veillance dans le postopératoire immédiat
(infection urinaire) et à long terme (contrôle
annuel, PSA et TR).
En conclusion, le diagnostic d’hypertrophie
prostatique repose principalement sur
l’anamnèse, l’utilisation de questionnaires
validés et le toucher rectal.
Le bilan complémentaire comprend le do-
sage du PSA, l’échographie prostatique
par voie transrectale et la débitmétrie.
Dans les petites hypertrophies prostatiques
symptomatiques, le traitement médical
améliorera les symptômes.
La chirurgie reste indiquée dans les symp-
tomatologies rebelles à ce traitement ou
d’emblée dans les gros adénomes, surtout
s’ils sont responsables de complications.
Fig. 2 : Electrode en forme de champignon
renversé avec un courant bipolaire pour la
vaporisation du tissu prostatique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%