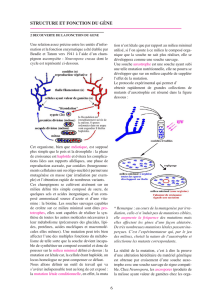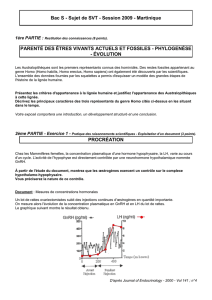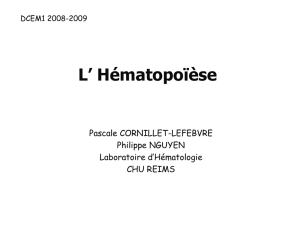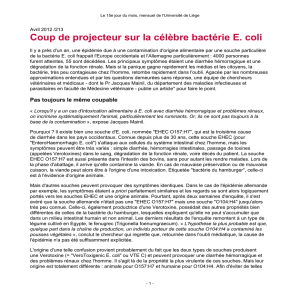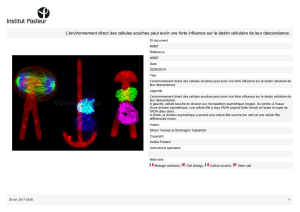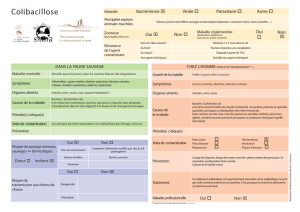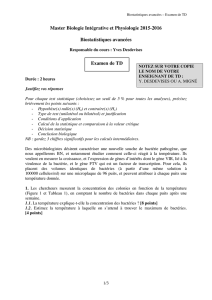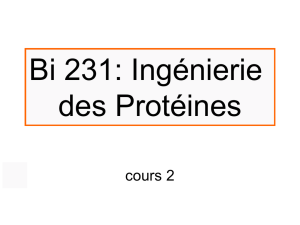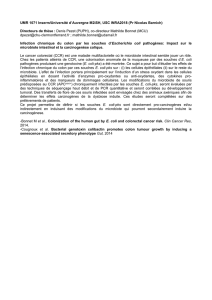Web 4 Fiche 4

1
Web 4 Fiche 4.1
LE CONCEPT D'ORGANISME MODÈLE ET SES LIMITES
L. Paolozzi
QU'EST-CE QU'UN ORGANISME MODÈLE ?
La Biologie de la moitié du siècle dernier a connu un développement extraordinaire, qui en a
fait une des grandes aventures intellectuelles de l’homme. Ces progrès ont été liés au
développement des méthodes d’études des organismes vivants au niveau moléculaire, et à la
convergence d’un ensemble de connaissances provenant de disciplines différentes déjà
développées, la génétique, la biochimie, la microbiologie, auxquelles se sont adjointes la
biologie moléculaire, la microscopie électronique, puis la bio-informatique, et encore d'autres.
Ces méthodes ont été appliquées à l’étude d’un nombre très restreint d’organismes par rapport
aux millions d’espèces décrites ou répertoriées à travers les siècles par les naturalistes. Ces
organismes, dits modèles, correspondent à quelques espèces particulières de plantes, d’animaux,
de micro-organismes procaryotes et eucaryotes ou de virus, plus appropriées que d'autres pour
étudier un phénomène spécifique ou pour répondre à une question donnée. Les découvertes ou
concepts qui dérivent de l’étude d’un organisme ou d’un système modèles conduisent à établir
des généralisations, et donc des prédictions pour tous les autres organismes ou systèmes
biologiques équivalents.
Cette définition peut être étendue à celle de système modèle en biologie, qui se réfère cette
fois non plus à un organisme, mais plutôt à un complexe macromoléculaire particulier,
constituant une machinerie (appareil de réplication, de transcription, de traduction, moteur
flagellaire, etc.), ou à un élément de cet organisme (membranes, systèmes de transport,
organites, etc.) ou d'un groupe d'organismes. Ces mêmes principes s’appliquent à l’étude des
virus (par exemple les capsides virales comme modèle d’assemblage de protéines en complexes
fonctionnels).
Le choix d’un organisme plutôt que d’un autre comme “modèle” peut être lié au hasard ou
longuement réfléchi. La manifestation d’un phénomène intéressant, encore inconnu chez

2
d’autres espèces, peut devenir rapidement matériel d’étude pour de nombreux chercheurs. Le
choix du modèle peut aussi avoir été dicté par des exigences expérimentales. Un certain nombre
de critères de choix sont communs à plusieurs organismes modèles ; ils concernent le cycle de
développement, qui si possible doit être court, les dimensions de l’organisme (petite taille de
l’adulte chez les organismes supérieurs, pour des raisons d’encombrement), la facilité de
reproduction en laboratoire ou la facilité à pouvoir en disposer, le coût, et encore d’autres
critères. Certains sont plus ou moins spécifiques du domaine d'étude envisagé. Les mêmes
concepts s’appliquent aux organismes de tous les domaines et aux virus.
IMPORTANCE DU CHOIX D'UN ORGANISME MODÈLE EN BIOLOGIE
L’importance du choix de l’organisme modèle pour l’étude d’un phénomène donné trouve de
nombreuses illustrations si l’on parcourt quelques-unes des étapes importantes de l’histoire de la
génétique. La découverte par Gregor Mendel en 1865-1866 des lois de la transmission des
caractères héréditaires, applicables à tout eucaryote ayant une méiose classique, en est un
excellent exemple. Le pois (Pisum sativum) fut choisi par G. Mendel car il possédait un certain
nombre de caractéristiques favorables pour les études qu'il envisageait : disponibilité de plants
avec des couples alléliques bien définis pour plusieurs caractères (couleur et forme des pétales
et des fruits, taille de la plante) ; structure de la fleur (avec étamines et pistil enfermés dans le
pétale en carène) rendant possible soit l’autofécondation soit des fécondations croisées (en
enlevant les étamines avant que le pollen ne soit mûr et en fécondant avec les étamines d’une
autre plante). Le temps de reproduction est relativement court (un an) ; les descendants sont
nombreux et fertiles, et peuvent être suivis sur plusieurs générations.
Un organisme peut être choisi comme modèle pour sa possession d'une manifestation
phénotypique ou physiologique inconnue chez d’autres organismes caractéristiques et suscitant
l’intérêt scientifique. Citons par exemple la variégation des fleurs ou des feuilles chez certaines
plantes. Le concept de mutation, développé durant les années 1901-1903 par le botaniste
hollandais Hugo De Vries, prend naissance de l’observation d’une variété de plante herbacée
sauvage, l’onagre, ou herbe aux ânes (Oenothera lamarckiana). Cette plante à fleur, originaire
d’Amérique du Nord, fut introduite en Europe comme plante ornementale. De Vries s’aperçut
qu’un petit nombre de descendants de cette plante présentait des variations brusques et
discontinues de leur aspect, apparaissant en une seule génération. Ces différences, si marquées
qu’elles pouvaient être interprétées comme représentant de nouvelles espèces, furent décrites
comme des mutations. En 1909, Carl Erich Correns, botaniste et généticien allemand, s'intéressa
à une autre plante ornementale, la belle-de-nuit (Mirabilis jalapa), en raison de ses feuilles
panachées vert et blanc, comme modèle d’étude de l’hérédité cytoplasmique. D’autres
organismes devinrent des modèles d’étude dans des domaines plus vastes. C’est le cas de la
drosophile, matériel privilégié des travaux de génétique des eucaryotes. Ce choix amena
Thomas Hunt Morgan et ses collaborateurs, par sélection de mutants et analyses de croisements
entre couples différant par leur composition allélique, effectuées sur la seule espèce Drosophila
melanogaster, à établir, en 1915, la théorie chromosomique de l’hérédité. Ce travail colossal jeta
les bases de la génétique moderne. La Drosophile est un modèle excellent pour le travail
classique de génétique : cycle vital bref (12 jours), élevage facile et peu coûteux, facilité
d'obtention de mutants, nombreux phénotypes facilement observables, et se prête bien aux
manipulations de biologie moléculaire. À cette même période, un autre organisme, le maïs (Zea

3
mays), devient aussi un modèle grâce à sa souplesse d'utilisation (mutations, reproduction,
croisements contrôlés). En 1953, après une vingtaine d’années d’expériences de cytogénétique
et de génétique formelle sur cette plante, Barbara McClintock (Prix Nobel de biologie et
médecine en 1983) établit le concept de transposition génique. En 1963, Sydney Brenner (prix
Nobel de biologie et médecine en 2002) propose d’utiliser le ver nématode Caenorhabditis
elegans pour l’étude de la différenciation et du développement des animaux (développement
neuronal) par l'approche moléculaire. D’autres modèles, le batracien Xenopus laevis (pour
différentes problématiques de biologie moléculaire), la souris (Mus musculus) pour les études
d’immunologie et de pharmacologie, sont aussi devenus classiques. Le cas de X. laevis, choisi
pour la facilité de son élevage, est intéressant : on peut induire l’ovulation à n’importe quelle
période par injection d’hormone gonadotrope, et ses œufs, de grandes dimensions, permettent
d’observer facilement l’embryogenèse. La souris est le modèle du mammifère le plus proche de
l’Homme, avec un génome de dimension presque identique, dont 99 % des gènes ont un
homologue chez l’Homme.
DES MICRO-ORGANISMES PROCARYOTES ET EUCARYOTES
COMME MODÈLES
La première trace d’une formulation du concept d’organisme modèle concerne un procaryote et
remonte à 1877-1878. Elle se trouve dans une publication de Joseph Lister dans la revue
Transactions of the Pathological Society of London. Le but de cette publication était de prouver
de façon définitive l’origine microbienne de la fermentation lactique. Pasteur avait montré en
1854 que les hydrates de carbone présents dans le lait étaient transformés en acide lactique et
alcool amylique, et que cette acidification du lait résultait de l’activité d’un « ferment
particulier, une levure lactique ». La « levure lactique », écrivait Pasteur était « différente de
celle de la fermentation alcoolique ». C’était en fait une Bactérie. La présence dans ces
expériences d’autres micro-organismes n'avait pas permis de prouver définitivement le rôle de
cette « Bactérie » dans la fermentation. Le mérite de Lister fut d’utiliser pour ses études une
culture bactérienne pure, et ainsi d'apporter une preuve définitive du rôle de la Bactérie. Il
observa en effet qu’une culture pure de ces Bactéries, qu’il désignait comme Bacterium lactis,
ensemencée dans des échantillons de lait stérilisé, permettait d’obtenir la production d’acide
lactique et le caillement du lait. La publication de Lister contient en outre la première ou une des
premières formulations du concept de modèle en biologie.
L’importance des procaryotes, et en particulier Escherichia coli, dont les souches K12 et B,
comme organismes modèles possibles ne s’imposera que bien plus tard, dans les années 1940.
Cette bactérie, isolée par le pédiatre allemand Theodor Escherich, décrite en 1886 comme
Bacterium coli commune, et rebaptisée plus tard Escherichia coli en son honneur, possède un
certain nombre de caractéristiques idéales (tab. F4.1-1) qui permettent de réaliser plus
facilement des expériences de génétique sur un organisme unicellulaire par rapport à d’autres
organismes comme la Drososphile et les mammifères étudiés à cette époque. Choisi comme
organisme modèle dès les années 1940 par le « Groupe du Phage » (Web 16, Fiche 16.2) aux
Etats-Unis et par celui de Génétique microbienne de l’Institut Pasteur par J. Monod et A. Lwoff
puis par F. Jacob, E. coli sera au centre du développement de la biologie moléculaire et des plus
grandes découvertes de la biologie du siècle dernier. Citons par exemple l’importante

4
démonstration par S.E. Luria et M. Delbrück en 1943 de l’origine spontanée des mutations et du
rôle de la sélection dans ce processus, avec comme modèle la résistance à l’infection au
bactériophage T1 (Chap. 10), découverte qui permettra d’étendre les concepts développés dans
ce travail à tout organisme vivant, montrant la possible universalité de ce modèle. On disposera
très vite d'un vaste nombre de mutants nutritionnels de cette bactérie ; on en découvrira la
sexualité, ce qui permettra d’effectuer des croisements génétiques (Chap. 12). Les études
effectuées sur cette bactérie, et celles qui continuent de nos jours, constituent une bonne partie
du contenu des différents chapitres de ce livre.
Tableau F4.1-1 - Caractéristiques principales d’Escherichia coli
Caractéristiques
Physiologie
Facile à cultiver, dans des milieux nutritionnels synthétiques,
avec de nombreuses sources alternatives de carbone, ou dans
des milieux complexes
Temps de génération rapide (de l’ordre de 20 min en milieux
riches)
Génétique
Parmi les nombreuses souches, la souche K12, non-pathogène,
est l’un des organismes les plus connus au niveau moléculaire.
Système excellent pour l’approche génétique : génome de
dimension moyenne parmi les procaryotes, disponibilité d’une
vaste collection de mutants, croisements génétiques faciles,
hôte de nombreux types de plasmides et bactériophages.
Possibilité de transformation artificielle.
E. coli K12 et ses phages ont été à la base de découvertes
fondamentales en biologie moléculaire et un outil précieux pour
la mise au point de techniques de génétique et biologie
moléculaire
Biochimie et Biologie
moléculaire
La biochimie de cette bactérie est très développée
Hôte excellent de nombreux vecteurs obtenus par les
techniques de génie génétique
Si E. coli a été un organisme idéal pour l’étude d’un grand nombre de processus de biologie
de base, son absence de reproduction par un processus de sexualité a été pour de nombreux
chercheurs des années 1940 une limite à l’extension de la génétique mendélienne. Ainsi dès la
fin des années 1940, le généticien Boris Ephrusi fit le choix de la levure Saccharomyces
cerevisiæ, organisme unicellulaire eucaryote qui se multiplie par division végétative et par
croisement, pour les études sur l’expression mendélienne des gènes. Ce choix devait conduire à
la découverte inattendue d’une forme nouvelle de génétique dite non mendélienne, celle d’une
hérédité « en dehors du noyau », qui a été localisée ultérieurement dans « des particules extra-
nucléaires que sont les mitochondries » comme affirmaient B. Ephrussi et P. Slonimski, dans un
article de 1949. Au cours des décennies qui suivront, les études sur S. cerevisiæ devaient
conduire au concept fondamental que les principales fonctions cellulaires et leur modalité

5
d’exécution sont conservées de la levure aux mammifères, Homme compris (voir cours de
biologie cellulaire).
LES LIMITES DU CONCEPT DE MODÈLE
Si un organisme modèle donné présente de nombreux avantages d’études, il comporte aussi un
envers la médaille, non seulement celui de ses limites intrinsèques, mais aussi celui des limites
de la généralisation de son statut de système ou organisme modèle. Aucun organisme modèle ne
peut fournir les réponses à toutes les questions que l’on peut se poser en biologie. C'est le
danger de la tendance trop facile à l’extrapolation des observations du modèle au reste du
monde vivant. Pendant des décennies E. coli et ses virus ont représenté le système vivant le plus
étudié au niveau moléculaire. Seules une dizaine d'autres procaryotes, tous des Bactéries, ont été
étudiés simultanément, au début uniquement pour quelques caractéristiques importantes
absentes chez E. coli (tab. F4.1-2), sans pour autant remettre en question l'« universalité » de
cette bactérie comme modèle. C’est le cas par exemple de B. subtilis, dont les études initiales
étaient limitées à sa capacité de sporulation et de transformation.
Tableau F4.1-2 - Principales espèces bactériennes utilisées comme modèles
Espèce
Intérêt d’étude
Escherichia coli
génétique et biologie moléculaire bactériennes
Salmonella enterica
génétique et physiologie
Bacillus subtilis
sporulation, transformation, sécrétion de
protéines
Caulobacter crescentus
différenciation
Myxococcus xanthus
différenciation
Synechoccus, Synechocystis
photosynthèse, rythmes circadiens
Streptomyces spp.
métabolisme secondaire, antibiotiques
Rhizobium spp.
symbiose plante-bactérie (fixation de l’azote et
différenciation cellulaire)
Agrobacterium tumefaciens
Interactions plante-bactérie
transgénèse
Bactéries pathogènes
modèles spécifiques d’une maladie donnée
La situation était un peu différente en ce qui concernait les bactéries pathogènes, dont
beaucoup ont été isolées pour leur infectiosité spécifique, puis étudiées pour en comprendre la
pathogénicité et élaborer des moyens en vue de leur neutralisation (Chap. 17 ; 18).
Inversement, la reconnaissance des spécificités des Archées, qui constituent actuellement un
domaine distinct, a longtemps été oblitérée. Peu connues encore maintenant en raison de leur
identification récente et des difficultés d'étude d'une majorité d'entre elles, ces procaryotes
étaient soit ignorés soit assimilés aux autres Bactéries. L'établissement de leurs originalités, et
donc la remise en question de la généralisation appliquée antérieurement, ont permis d'enrichir
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%