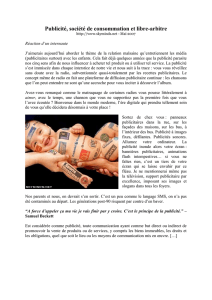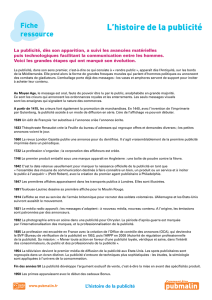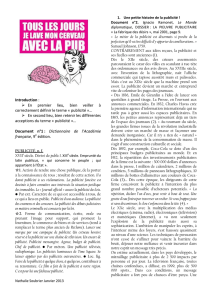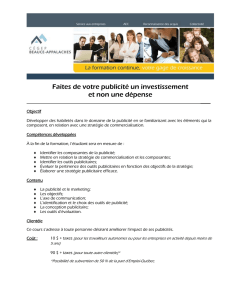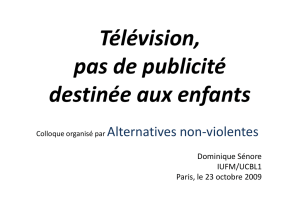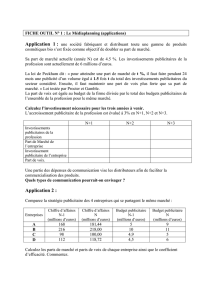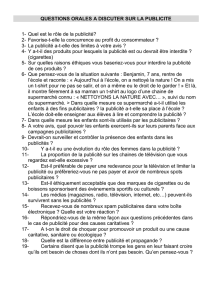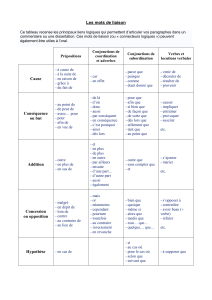I. Les grands courants historiques d`analyse de la communication

Médias et communication ( M. Regourd )
- 1 -
Médias et communication
Le cours sera une introduction aux problèmes liés aux rapports entre médias et
communication.
Nous sommes tous les jours confrontés aux médias. Notre représentation du monde est en
partie construite à travers les représentations médiatiques ( voir, par exemple, la
représentation qui a été faite des élections en Irak ). Il s’agira, dans ce cours, de porter un
regard critique sur ce phénomène, et non pas de faire de la sémiologie.
Chapitre 1 :
Définitions et caractéristiques générales de la
communication
La notion de communication est très floue, très générale. Il n’y a qu’à voir les multiples
utilisations qui sont faites de ce terme aujourd’hui. On parle de société de communication,
celle-ci étant fondé sur le principe de liberté ; on parle également de “révolution de la
communication“ ( à l’heure où la révolution en tant que phénomène politique semble
impensable ).
“Communication“ peut être considéré comme un mot-valise, ou comme un “colosse
terminologique aux pieds d’argile“ ( Bougnoux ). C’est un archétype de ce que l’on appelle
un polysème.
Sur le terrain de ces études, l’école de Palo Alto part du précepte suivant : on ne peut pas ne
pas communiquer. Vivre en société, c’est communiquer. D’où l’immensité du champ couvert
par la communication. Les terrains sont très variés, les vecteurs de la communication n’ont
aucun rapport les uns avec les autres.
“Communication“ vient du latin “communicare“ et “communio“, qui signifient à l’origine la
mise en commun, le partage ; il y a une logique de transmission.
À partir du XVIème siècle, on désigne sous la notion de communication les moyens par
lesquels les individus peuvent se rencontrer, par lesquels ils entrent en relation les uns avec
les autres, au sens d’un déplacement physique. Le premier usage correspond donc aux voies
de communication. Puis apparaît l’idée que l’on peut communiquer sans déplacement
physique ( notamment par le courrier, qui est une activité monopolistique régalienne depuis le
XIème siècle ). C’est à partir du XVIIIème siècle que la communication désigne les diverses
modalités de transmission et de réception des messages, des signes, le rapport entre un
émetteur et un récepteur avec, entre les deux, un vecteur ( le médium, qui donnera le mot
“média“ ).
-> Quand on parle de communication, on désigne à la fois des moyens de communication et le
processus de transmission.

Médias et communication ( M. Regourd )
- 2 -
Les domaines de la communication sont extrêmement variés. Il peut s’agir de tous les
processus au terme desquels des individus transmettent des messages à d’autres individus en
vue de modifier leur comportement ( un message n’est jamais neutre ; il a une finalité ). Les
problèmes de communication concernent aussi bien la communication politique ( la
communication et la politique sont même consubstantielles ), la publicité, la communication
institutionnelle, la culture, l’art, les divertissements… Dans tous ces cas, néanmoins, on
retrouve un itinéraire qui correspond à la définition canonique de la communication telle
qu’elle a été formulée par Harold Laswell ( politologue ) : « qui dit quoi, par quel canal, à qui,
avec quels effets ? » ( émetteur, message, medium, récepteur, but = grille d’analyse courante,
“modèle heuristique“ ). Ce modèle a été critiqué par toute une série de courants ( dont l’école
de Francfort ), notamment parce qu’ils s’agit d’une approche formaliste ou fonctionnaliste,
qui évacue tout déterminisme de type social, politique, culturel… c’est-à-dire postule que les
rapports de communication seraient libres. Cela dit, il permet de bien cadrer les rapports du
média à la communication, et permet de s’adapter à une diversité d’angles d’étude ou de
disciplines ( sociologie, technologie, sémiologie, droit, économie… ). Le fait que la
communication intègre ces diverses approches a donné lieu à la reconnaissance d’une
discipline universitaire autonome : les sciences de l’information et de la communication. Des
disciplines spécifiques ont également été mis en œuvre. Exemple : la médiologie ( Bougnoux,
Régis Debray… ), qui étudie les médiations sociales permettant de comprendre comment les
sociétés évoluent ( les perceptions changent en fonction du médium, alors que la réalité reste
la même ).
L’étude des processus de communication a été caractérisée par une évolution progressive
centrant la communication d’abord sur le rôle joué par l’émetteur, puis sur le rôle joué par le
récepteur, puis sur le rôle joué par le média lui-même. Quel est l’élément surdéterminant dans
le processus de communication ? Lorsque l’on se pose cette question, on est renvoyé à trois
étapes. Méthodologiquement, il ne faut pas considérer que lorsqu’une nouvelle approche
apparaît, elle efface toutes les précédentes ( voir Archéologie du savoir de Foucault : en
matière de connaissances, la strate précédente ne disparaît pas ; on a des étapes
sédimentaires ).
I. Les grands courants historiques d’analyse de la
communication
Il faut d’abord signaler qu’il y a une interdépendance entre les acteurs et les observateurs de la
communication. L’opposition entre le conceptuel et l’opérationnel est une fausse opposition.
Première phase : un centrage sur l’émetteur
L’un des exemples est celui de la propagande politique. Voir Le viol des foules de Serge
Tchakotine, relatif au poids de la propagande dans la politique. La caricature absolue de ce
type de modèle est fournie par les régimes totalitaires. On a alors un processus unilatéral,
autoritaire, c’est-à-dire postulant que l’émetteur peut mécaniquement changer le
comportement des récepteurs ( voir l’expression “piqûre hypodermique“ appliquée à la
publicité ).
En matière politique, on peut citer l’utilisation qui est faite des grands médias par le pouvoir.
Exemple : le monopole public de radio-télévision sous De Gaulle et Pompidou ; De Gaulle

Médias et communication ( M. Regourd )
- 3 -
parle de “voix de la France“. Aujourd’hui encore, la plupart des hommes politiques sont
amenés à penser que leur notoriété et leur légitimité dépendent de leur champ d’occupation
des médias, et en particulier de la télévision.
À l’origine, les concepteurs de la publicité pensaient que leur message produisait un effet
quasiment mécanique. Le récepteur serait purement passif.
Deuxième phase : le rôle actif / sélectif du récepteur
C’est la théorie dite “des effets limités“, construite en opposition aux théories où l’émetteur
est prédominant. Voir les travaux de Paul Lazarsfeld, dans les années 1950. Initialement, il
s’agit de travaux empiriques, quantitatifs, basés sur les enquêtes statistiques. Lazarsfeld a
étudié en particulier les réceptions des messages radiophoniques en période d’élection. Le
constat est relativiste, nuancé : il n’y a pas d’effet mécanique ou absolu du message. On met
en évidence le rôle des “guides d’opinion“ : le message produit un effet, mais jamais
directement. Il passe par la médiation de guides au sein de chaque groupe social.
La communication repose sur une interaction, une interdépendance entre l’émetteur et le
récepteur. Il en découle un modèle “conversationnel“ ou “circulaire“ de communication,
opposé à l’unilatéralité. Selon cette analyse, l’influence du message n’est ni totale ni
immédiate, dans la mesure où les récepteurs réagissent sélectivement par rapport aux
informations qui leur sont communiquées. Dans bien des cas, les messages que nous recevons
ne sont perçus et retenus que dans la mesure où elles aboutissent à renforcer les opinions
préexistantes. Exemple : les gens achètent tel ou tel journal parce qu’ils savent qu’ils y
trouveront des informations confortant leurs points de vue.
-> La perception et la mémorisation varient considérablement d’un individu à un autre, d’un
groupe social à un autre, d’une époque à une autre, etc… c’est-à-dire en fonction de tout ce
qui constitue l’environnement du récepteur.
Une autre théorie : celle de la disparité des savoirs. On est dans une approche moins
relativiste. Il s’agit de mettre en évidence les différences de culture d’un groupe à un autre, et
leurs conséquences sur la réception des messages. Les processus de communication peuvent
considérablement renforcer les inégalités : dans certains cas, des récepteurs ne sont pas en
mesure de décrypter les messages, contrairement à d’autres récepteurs, ce qui renforce les
positions existantes. Dans nos sociétés, c’est ce genre de constats qui a généré des politiques
pédagogiques, éducatives à propos des moyens de communication. Le postulat consiste à dire
que l’enjeu principal des grands médias est de combler les disparités de savoir entre les
individus. Cette théorie est aujourd’hui complètement dépassée, à cause de la
marchandisation des médias.
Patrick Champagne a travaillé sur ces questions et sur les cultural studies. La culture n’est pas
une donnée immédiate. Il y a deux grands types de médiatisation aujourd’hui : l’école et les
grands médias ( télévision ). Une tendance, le multiculturalisme, consiste à dire que toutes les
cultures se valent. Conséquence : on renonce à tout volontarisme culturel, laissant les gens
dans la culture qui est la leur. Cela permet d’exonérer la puissance publique de toute
intervention culturelle. Le “tout culturel“ est le type de reproches que l’on a pu adresser à
Jack Lang quand il était ministre de la culture.
-> Des études empiriques faites sur la réception des grandes séries américaines ont révélé des
différences sensibles. Le poids des cultures constitue une sorte de filtre à la réception.
Troisième phase : le rôle central des médias

Médias et communication ( M. Regourd )
- 4 -
Depuis les travaux de MacLuhan, et de ceux de l’école de Francfort, a été mis en lumière le
rôle central des médias.
MacLuhan : « le message, c’est le médium ». Voir La galaxie Gutenberg et Pour comprendre
les médias. Sa thèse est la suivante : « les médias agissent comme des moules qui
surdéterminent les messages mis en circulation ». Exemple : « le télégraphe raccourcit la
phrase, le téléphone crée la call-girl, la radio a pour conséquence Hitler ». Il n’y a pas de
régime totalitaire sans média de masse. Malgré les controverses qu’il a suscitées, MacLuhan
met en avant la notion de déterminisme technologique. Il distingue les “médias froids“
( exemple : la presse écrite ) et les “médias chauds“ ( qui neutralisent toute distance et,
finalement, ne sont pas porteurs d’information ).
L’école de Francfort est incarnée par Adorno et Horkheimer. Elle est prolongée par Habermas
et Marcuse. Ce courant considère que l’introduction des mass médias ont totalement bousculé
les modalités traditionnelles de la régulation sociale, de la régulation politique et de la place
de la culture. C’est la nature même du contenu du message qui est transformée. Cette thèse est
fondée sur une critique des médias de masse en tant que tels, qui provoquent une logique de
standardisation, qui évacuent toute forme de débat public, et qui produisent un “homme
unidimensionnel“ ( Marcuse ). Le capitalisme avancé engendrerait, par l’intermédiaire des
médias de masse, une société close, unidimensionnelle, fondée essentiellement sur une culture
purement distractive, distrayante ( “les industries culturelles“, la production en séries,
“l’entertainement“ ). Pour Marcuse, les mass médias provoquent un consensus général aliéné
par la consommation des marchandises.
Orwell, qui n’a rien à voir avec l’école de Francfort, parle de “société télécranique“. C’est la
société la plus totalitaire qui n’aura jamais existé, selon lui, parce qu’elle permettrait les
lavages de cerveau.
Habermas reprend une citation d’Adorno : « la rationalité technique est devenue la rationalité
de la domination » ( Dialectique de la raison, Adorno, 1947 ).
-> L’espace public ( 1960 ). La reconnaissance d’un espace public commence au XVIème
siècle. Avant cela, on ne considérait que des espaces privés. L’espace public se crée sur la
base du rôle fondamental de l’opinion publique. L’Etat constitutionnel ne se crée lui-même
que sur la reconnaissance d’un espace public. Mais cet espace est caractérisé par des rapports
de communication. À la parole seule légitime d’un pouvoir absolu se revendiquant d’un droit
divin, supposé fondé sur des lois de la Nature, se substitue un pouvoir nouveau : celui de la
parole publique, de la communication publique, caractérisé par le développement de
déclarations, de la presse écrite, etc… Cela conduit à ce qu’Habermas appelle “la
dégénérescence de la parole publique“, avec l’apparition des grands médias, qui ne sont que
des lieux de pure consommation ( culture de masse ). Habermas montre que la vie politique
publique n’existe plus qu’à travers des stratégies d’image. On a une “corruption de l’espace
public“ par les médias.
=> Il n’y a pas de neutralité du média.
Dans ce cadre, l’ensemble des analystes admettent que les grands moyens de communication,
dont la télévision, structurent de manière essentielle les modes de pensée, les formes de
représentation sociale, et même les modes d’organisation. D’où la notion de “pouvoir
médiatique“. L’agenda politique est en partie déterminé par les médias. Le pouvoir
médiatique est caractérisé par une culture uniformisante qui tend à se substituer aux autres
formes d’autorité. Ce sont les grands médias qui créent eux-mêmes les événements et qui
façonnent des représentations plus ou moins autonomisées par rapport au réel. Habermas
parle de “confusion entre le symbolique et le réel“.

Médias et communication ( M. Regourd )
- 5 -
La société de communication a changé les rapports entre l’émetteur et le récepteur dans la
mesure où elle utilise des procédés beaucoup plus subtils que la propagande politique
primaire, qui provoque des réactions négatives et sélectives.
-> Guy Debord, La société du spectacle : notre société ne fonctionne que sur une immense
accumulation de spectacles et de représentations. Le vécu serait complètement dévoré par la
représentation ( exemple : le “diktat“ des marques ). Selon cette approche, les citoyens
deviennent de simples consommateurs de marchandises.
Pour Vaneigen ( Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations ), « ceux qui parlent
de communication quand il n’y a que des rapports de choses répandent le mensonge et le
malentendu, réifient davantage ».
Edgar Morin parle lui de “l’industrialisation des âmes“.
Baudrillard : dans la société du spectacle, « nous sommes dans le règne du simulacre, cadre
dans lequel la frontière entre le vrai et le faux peut devenir indécelable ».
Voir aussi Umberto Eco, L’ère du faux.
Selon l’approche médiologique, c’est le médium qui l’emporte sur les messages, c’est la
technologie médiatique qui définit le modèle de communication à chaque grande étape
historique. On pourrait distinguer trois grandes périodes :
la période de la tradition orale, que Régis Debray qualifie de “logosphère“
la “galaxie Gutenberg“ ( MacLuhan ) ou civilisation de l’écrit ( “graphosphère“ )
l’âge de la toute puissance de l’image et de l’électronique ( “vidéosphère“ ). Pour
Debray, il n’y a pas de mémoire car il n’y a pas d’écrit.
Le poids de l’outil de médiation aboutit à l’idée selon laquelle la réalité telle qu’on peut
l’imaginer objectivement se voit substituer de simples représentations du réel.
Exemples :
Timisoara. En décembre 1989, les “soviétologues“ pensaient que le retour en arrière
des régimes soviétiques n’était pas possible. Or, le totalitarisme de l’est s’effondre.
L’un des pays qui restent est la Roumanie ; une révolution éclate. Dans une logique
d’inflation, les médias multiplient les hypothèses sur le nombre de morts. C’est dans
ce contexte que l’on découvre le charnier de Timisoara, dont toute la presse s’empare.
En fait, ce charnier n’existait pas ; il s’agissait de restes chirurgicaux d’un hôpital situé
pas loin. L’agenda médiatique a fait que tous les journaux se sont précipités sur cette
nouvelle. Les rapports internationaux estiment le nombre de victimes de la révolution
roumaine à 766. Or, les médias, à l’époque, ont multiplié ce chiffre par 100 environ.
Pendant ce temps, les Etats-Unis faisaient 4000 morts en intervenant au Panama, mais
personne n’en parlait.
la première guerre du Golfe ( à la suite de l’intervention de l’Irak au Koweït ). Cette
guerre, dont on a aucune image, a été qualifiée de “guerre propre“, de “guerre
chirurgicale“. Or, elle a fait approximativement 200000 morts, essentiellement dans la
population civile. On s’accorde à dire que, postérieurement à la guerre, l’embargo a
causé 1 million de victimes.
la guerre de Bosnie. Les hypothèses inflationnistes vont bon train, et sont, là encore,
totalement déconnectées de la réalité.
II. Les grandes tendances du traitement médiatique
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%