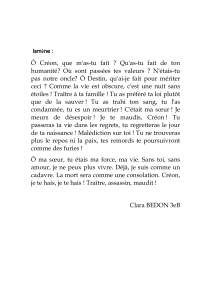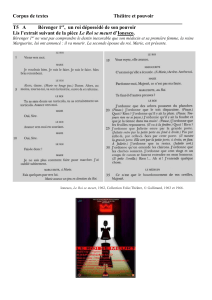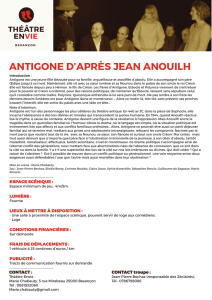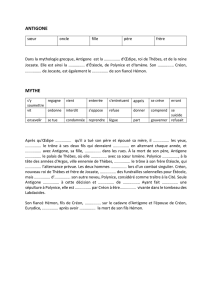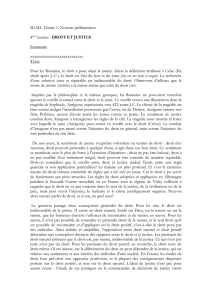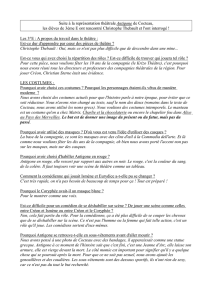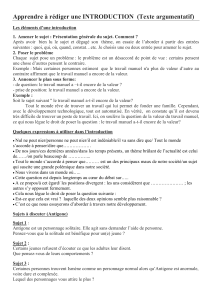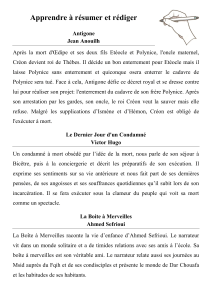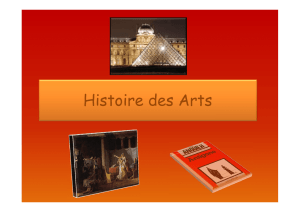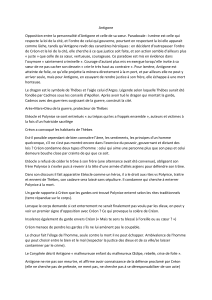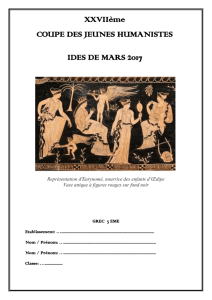II - lycée Marc Bloch

II. Une leçon de politique en contrepoint
1) le pouvoir par obligation : la corvée à assumer
« un matin » + « tout d’un coup » : soudaineté du pouvoir : événement qui n’était pas prévu : rappel
tacite ici de la lutte entre les deux frères qui a laissé le trône vide
« je me suis réveillé » : il ne l’a pas choisi, cela lui est « tombé dessus »
« il fallait » + « j’aimais », « pouvais », « refusait » = imparfait qui donne l’impression d’un passé qui
parait loin désormais
« comme un ouvrier », « un ouvrage » = le pouvoir est une besogne à accomplir, un travail à faire
« J’ai dit « oui » » : Créon est en opposition avec Antigone qui est du côté du NON (aux obligations que
suppose la charge de roi)
« écoute moi » = Créon demande qu’on l’écoute et qu’on le comprenne
> le verbe est répété ensuite : « st-ce que tu le comprends cela ? »
« Tu m’amuses ! » Créon essaie de garder la face ? expression d’une sagesse face à l’exaltation
adolescente
CALME de Créon au début : « écoute-moi », « je te l’ai dit »
commence à perdre son sang froid : exclamation « oui, c’est cela ! », avant l’explosion
« le cadavre de ton frère qui pourrit » : force de l’image corps mort, violence et rappelle du fait que c’est
l’origine de tous ses ennuis
2) les obligations du pouvoir
opposition marquée : « seulement, je me suis senti… » ; « il faut pourtant ») : l’obligation est ici
signifiée
« eh bien » : lassitude de Créon ?
« être obligé » : champ lexical des obligations
« te faire tuer » : encore l’image du roi et de ses sbires : il ne va pas tuer lui-même Antigone, mais
c’est l’exercice du pouvoir par les mains des gardes qui exécutera la sentence
Créon est du coté de l’obligation et de l’impératif : « aie pitié de moi, vis »
Créon va défendre l’idée de devoir payer parce qu’on est le chef : champ lexical : répétition du verbe
payer (relever : j’ai assez payé)
« ne m’oblige pas » : encore le vocabulaire de l’obligation tourné vers le personnage du roi
essaie d’amadouer Antigone, en lui parlant de son fils et de l’amour
« payer maintenant » : devoir expliquer ses décisions passées
3) métaphore de la barque à mener : une allégorie de la situation en France ?
« bon dieu » ; « petite idiote » ; « pour tirer au moins leurs os de là » ; « toutes ces brutes vont
crever » ; « elles ne pensent qu’à leur peau » « on tire dans le tas » : langage qui devient presque
grossier >> anachronisme qui nous éloigne de l’Antiquité durant laquelle se passe normalement la
scène
>> met en place la métaphore de la situation en France, en 1944
Métaphore filée de la barque comme image de l’état à gouverner : « la barque », « cela prend l’eau »,
« le gouvernail », « le bout de bois », « piller la cale », « les officiers », « se construire un petit
radeau » >> métaphore suffisamment flou pour qu’elle puisse justement englober la situation
contemporaine à la pièce = l’occupation et les réactions des français (expliquer les termes « petites
affaires »)
Rapidité de réaction face aux problèmes : longues phrases avec rythmes croissant :
« et le mât craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer (futur proche : urgence), et toutes ces
brutes… » >> construction anaphorique qui montre la simultanéité et l’urgence dans laquelle se trouve
Créon pour réagir (il n’a pas « le temps de se demander si)
Passage du « on » au « vous » : de l’indéfini à l’adresse directe persuader Antigone mais aussi le
public : tentative de justification ici
Aboutit à un « tu » qui s’adresse aussi bien à lui-même qu’à Antigone
Question finale : adresse pour persuader
La conclusion reste à faire. Il est nécessaire de reprendre brièvement les éléments que vous aurez développés
dans votre explication, en ouvrant sur le texte et la signification de la pièce.
1
/
1
100%