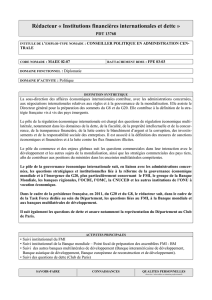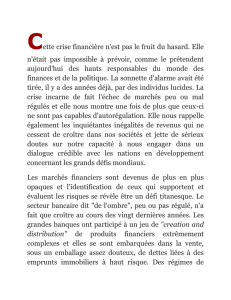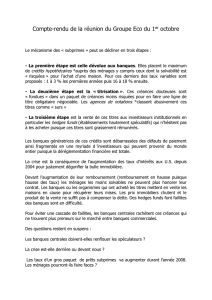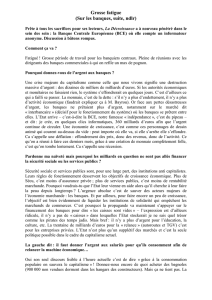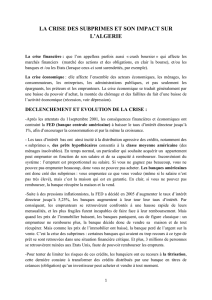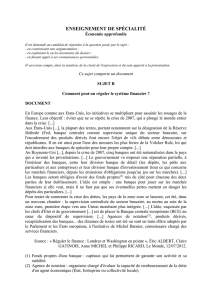La crise mondiale : nature et impact (s) – Rachid Boudjema

La crise mondiale : nature et impact (s)
Par
Dr Rachid BOUDJEMA
Juin 2009

2
Table des matières
1. Quel est le Constat général ?
2. Quelle est l’intensité de la crise ?
3. Quelle est la date de survenance de la crise ?
4. Quel est l’épicentre de la crise ?
5. Quel est le degré de contagion de la crise ?
6. Que signifie la crise de manière abstraite ?
7. Que signifie la crise de manière concrète ?
8. Quelles sont les causes apparentes de la crise ?
9. Quels sont les indicateurs apparents de la crise ?
10. Crise et Organes de contrôle et de surveillance
11. Quel vieux débat la crise remet-elle en l’honneur ?
12. Quelles ont été les réactions individuelles des Etats face à la crise ?
13. Quelle a été la réaction collective des Etats face à la crise ?
14. Quelles sont les conséquences du plan de sauvetage du capitalisme sur les
équilibres budgétaires et financiers des Etats ?
15. Quels sont les effets économiques et sociaux mondiaux de la crise ?
16. Quels sont les effets économiques et sociaux de la crise dans les pays
développés ?
17. Quels sont les effets économiques et sociaux de la crise sur les PED ?
18. Quels sont les effets économiques et sociaux de la crise sur l’Algérie ?
19. En guise de conclusion : six enseignements
Annexes

3
1. Quel est le Constat général ?
Selon que l’on privilégie l’aspect scientifique ou l’aspect social et moral, nous
avons la chance ou la malchance d’être témoins d’un malaise profond de
l’économie mondiale que les sciences sociales qualifient de crise et dont les
effets sont ou seront ressentis, bien que de façon différenciée, par l’ensemble
des pays du monde.
1
2. Quelle est l’intensité de la crise ?
La crise est grave au sens où elle détraque sévèrement l’un des ressorts
essentiels du système capitaliste mondial, à savoir la finance. En effet, certains
économistes considèrent cette crise comme la plus sévère depuis celle 1929 et
d’autres la comparent du point de vue de son intensité même à celle de 1929.
Mais dans les deux cas, cette crise stipule que « le système financier dans
lequel a fonctionné le monde, ces dernières années, ne marche plus ».
2
3. Quelle est la date de survenance de la crise ?
La crise survint ouvertement à la fin de l’année 2008, c’est-à-dire, quelque vingt
ans après la chute du mur de Berlin, l’effondrement de l’URSS et la mise en
œuvre du Consensus de Washington. Il s’agit donc d’une crise d’une
mondialisation de type libéral ou d’un libéralisme de type mondialisé. En
d’autres termes, c’est la crise du modèle de croissance par le marché, supposée
ininterrompue.
4. Quel est l’épicentre de la crise ?
La crise s’est produite aux États-unis: elle affecte donc d’abord l’économie de
marché la plus puissante du monde. Aussi, a-t-elle un lien intime avec le niveau
de développement du centre nerveux du capitalisme mondial.
1
En réalité, l’économie mondiale est représentée par les économies qui réalisent l’essentiel
de la richesse mondiale (G8 et quelques nations émergentes regroupées dans le G20). Il
suffit que la croissance économique de ces nations donne des signes d’essoufflement pour
que tous les pays du monde en reçoivent l’impact.
2
Entretien avec P. Krugman in Revue l’Expansion, Novembre 2008, PP.132-136

4
5. Quel est le degré de contagion de la crise ?
La crise eut très vite un fort degré de contagion internationale permis par la
mondialisation des flux financiers. Elle s’est vite propagée aux pays d’Europe,
au Japon et aux nations émergentes. Il s’agit là d’une preuve patente que les
Etats-Unis ont une capacité d’entraînement qui les érige pour le bien et pour le
mal, en moteur de l’économie mondiale.
6. Que signifie la crise de manière abstraite ?
La crise d’aujourd’hui est vue à l’instar de toutes les crises du capitalisme,
comme une anomalie observée dans le fonctionnement jugé normal ou normatif
de la logique du profit. Cette anomalie est évidemment temporaire: elle
suppose attendu le retour à l’état normal des choses. Aussi, contrairement à
certains diagnostics et pronostics hâtifs, cette crise est-elle loin de signifier
« mort du capitalisme »
7. Que signifie la crise de manière concrète ?
La crise a une manifestation financière. En d’autres termes, il s’agit :
- d’abord, d’une crise de liquidités ou d’un assèchement des crédits, voire une
incapacité des banques de trouver des financements de court et moyen terme
pour assurer leurs affaires au jour le jour: les banques disposant de liquidités
ont préféré les déposer à la Banque centrale à un certain taux (3,25% au
niveau de la BCE) plutôt que de les prêter à d’autres banques. A titre
d’illustration, entre septembre et le 21 octobre 2008, les dépôts à la banque
centrale européenne passaient de 0 à 230 milliards de dollars ;
- ensuite, d’une crise de confiance (ou de capital), c’est-à-dire, une incapacité
des banques de trouver des investisseurs prêts à leur faire confiance, face à la
dépréciation de leurs actifs et à la chute des cours bousiers.
Au nom de ces manifestations concrètes de la crise, bon nombre de décideurs
politiques et économiques se sont autorisés à séparer (à tort) la sphère
financière de la sphère réelle du capitalisme et à parler de dérapage ou de
perversion du capitalisme financier au lieu de crise du capitalisme (tout
court). La crise d’aujourd’hui rappelle en réalité un des fondamentaux de
l’économie selon lequel la finance est une contrepartie d’une opération réelle.
Elle ne peut être ni déconnectée durablement d’elle, ni se développer
durablement sans elle.

5
8. Quelles sont les causes apparentes de la crise ?
La crise s’explique par des causes apparentes contradictoires :
- pour certains, c’est l’absence de régulation de la finance internationale qui
en est à l’origine ;
- pour d’autres, c’est au contraire l’excès de régulation financière
internationale qui a incité les institutions financières à y échapper par la mise
en œuvre de produits financiers de plus en plus complexes. « Les inventions
magiques du système bancaire note P. Krugman l’ont fait volé en éclats »
3
.
Ces inventions magiques sont résumées dans la titrisation
4
.
9. Quels sont les indicateurs apparents de la crise ?
La crise est aujourd’hui identifiée à partir d’un certain nombre d’indicateurs :
chute des indices boursiers; réduction ou cessation des crédits aux entreprises ;
fermeture d’entreprises; ralentissement de l’activité de production ; pertes
d’emplois.
10. Crise et Organes de contrôle et de surveillance
En raison de la complexité de ses mécanismes d’irruption et de diffusion, la
crise a défié les Agences de Notation, les Conseils d’Administration des
banques, les Normes IFRS, les règles prudentielles du Comité de Bâle et les
institutions financières internationales notamment le FMI.
11. Quel vieux débat la crise remet-elle en l’honneur ?
La crise d’aujourd’hui replace au centre des discussions idéologiques et
scientifiques la vieille question du rôle de l’Etat et du marché dans le
processus de croissance. En d’autres termes, la croissance doit-elle être laissée
aux seules forces du marché (Smith, Hayek, Friedman, etc.) ? Ou exige- t-
elle une intervention active de l’État (Keynes, Stiglitz, Krugman) ?
Alternativement, le capitalisme semble rejeter un modèle pour l’autre. Et c’est
cette flexibilité ou cette absence dogmatique qui lui donne la force historique
d’être et de survivre.
3
Voir l’Expansion, N° 735 , Novembre 2008 P.132 et suiv.
4
Voir annexe 1.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%