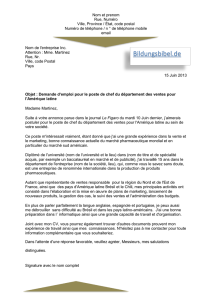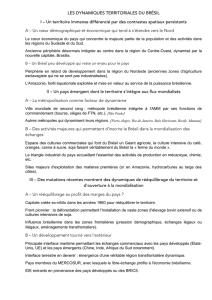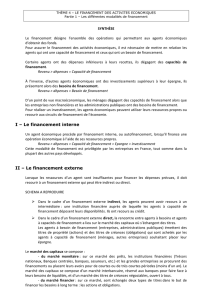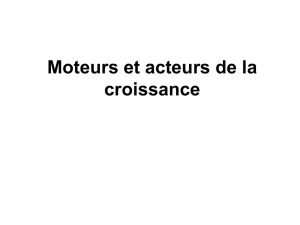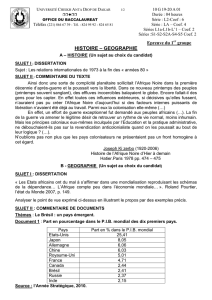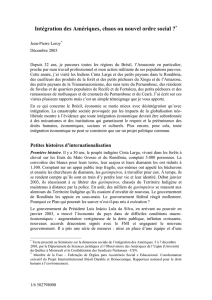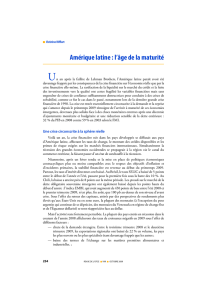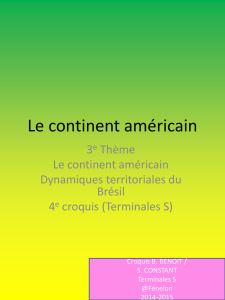La crise asiatique : hasard ou nécessité

QU’EST-CE QU’UNE CRISE SYSTEMIQUE ? QUELS SONT LES FACTEURS QUI
CONTRIBUENT A L’ALIMENTER ?
Définition : Une crise systémique part d’un état de dysfonctionnement et par effet de contagion, peut se
propager à l’ensemble du système économique & financier international.
Ex : fonds de pension US LTCM
Cause : volatilité des capitaux
Spéculation
Les 3D :
- déréglementation
- désintermédiation
- décloisonnement des capitaux
LES REPERCUSSIONS DE LA CRISE
"Les Etats-Unis ne peuvent être les éternels importateurs en dernier ressort" de la planète, tonnait le vice-président Al Gore à
Davos.
Il est vrai que, en 1998, la forte augmentation de la demande intérieure américaine (plus de 5 %) a été satisfaite par un surplus
de la production nationale (3,5 %), mais aussi et surtout par un gonflement des importations - et donc une aggravation sensible
(1,5 % du PIB) du déficit commercial. L'Europe a satisfait, elle, l'essentiel de sa demande supplémentaire (3 % environ) par
une augmentation de sa production, n'enregistrant qu'une très faible réduction de son surplus. Le Japon a connu, lui, une forte
contraction de sa consommation, dont ont souffert aussi bien les producteurs nippons que ses fournisseurs étrangers.
Pour Bercy, les Etats-Unis et l'Europe ont enregistré en 1998 une dégradation de leurs balances commerciales vis-à-vis de
l'Asie en crise, d'une même ampleur en valeur absolue - une perte nette de 30 milliards de dollars pour l'Europe, de 27
milliards pour les Etats-Unis - ou en proportion du PIB (0,35 % dans chaque cas). Les ventes européennes en Asie ont baissé
de 25 %, celles des Etats-Unis de 19 %. La dégradation exceptionnelle de la balance commerciale des Etats-Unis est davantage
liée, fait-on valoir à Bercy, à leurs échanges avec la Chine et avec l'Europe.
Evaluer le partage du fardeau à travers les seuls échanges commerciaux n'a en réalité guère de pertinence. La dépression
asiatique fait ressentir ses effets à travers
- les pertes des institutions financières (celles subies par les banques japonaises, allemandes et françaises sont plus élevées
que celles des banques américaines),
- le reflux des capitaux (plus massifs vers Wall Street que vers Tokyo, Francfort et Paris),
- l'effondrement des prix des matières premières, etc.
Cela étant, les Américains mettent le doigt sur un défi réel pour les pays industriels. Les Etats-Unis et l'Europe ont jusqu'à
présent plutôt tiré des bénéfices de la crise asiatique. Il va leur falloir maintenant en supporter les coûts.
Pour sortir de la crise, les pays asiatiques vont reprendre leurs exportations vers les pays riches. Ceux-ci doivent s'apprêter à
accueillir leurs produits, hypercompétitifs puisque dopés par les dévaluations. Si l'Europe a raison de dénoncer les excès
américains - une consommation effrénée notamment -, elle n'a aucune justification à accumuler de gigantesques surplus
commerciaux et d'épargne, alors même qu'elle souffre d'un chômage massif. Il ne s'agit pas, pour les années à venir, de
"partager un fardeau", mais de contribuer, chacun selon ses moyens - et ceux de l'Europe sont considérables -, à la relance de la
croissance mondiale.
La planète impuissante face au virus de la crise
Hier l'Asie et la Russie, aujourd'hui le Brésil : l'économie mondiale semble entraînée dans une spirale sans fin.
Après avoir largement contaminé les pays émergents (asiatiques et latino-américains), puis les nations en transition (la Russie
et d'anciens compagnons de route de la défunte URSS), un redoutable virus financier campe aux portes de l'Occident.
L'Amérique admet à présent que l'" effet samba " de la crise brésilienne risque de faire tanguer son économie, bien plus que ne
l'avait fait en son temps l'" effet tequila " consécutif à la crise du peso mexicain, durant l'hiver 1994.
De son côté, l'Europe, contrainte de composer avec un net ralentissement conjoncturel de son activité, doit se préparer à tester
la réelle solidité du " bouclier " que constitue théoriquement l'euro, au regard des chocs que ne manqueront pas de subir
l'un ou l'autre des onze pays de l'Euroland les plus engagés dans ces zones à risques.
A commencer par l'Espagne. Deuxième investisseur en Amérique latine (derrière les Etats-Unis), 12 % de ses exportations
vont vers les pays latino- américains dans lesquels les banques espagnoles sont par ailleurs fortement engagées.

Car la principale leçon à tirer est bien celle d'une contamination bien plus rapide que lors de précédents sinistres, et que
personne ne sait circonscrire, à défaut d'avoir pu l'éviter. Le meilleur exemple de cette paralysie collective est la confection, en
toute hâte, d'un plan de sauvetage préventif de près de 42 milliards de dollars (36 milliards d'euros) destiné à sauver le Brésil...
et qui n'a quasiment servi à rien. Le real a été dévalué et le drapeau noir flotte désormais sur la marmite brésilienne tandis que
l'Amérique latine, fortement intégrée commercialement (notamment au sein du Mercosur), est mise à rude épreuve.
En Asie orientale, d'où le mal est venu, la convalescence est douloureuse et les risques de rechute ne sont pas à écarter. ces
pays avaient bâti leur prospérité sur un réseau commercial dont le Japon était le centre nerveux. C'est ce système qui,
pendant deux décennies, a fourni au développement de la région une certaine autonomie par rapport aux cycles conjoncturels
des Etats-Unis ou de l'Europe. C'est lui aussi qui, aujourd'hui, contribue à entretenir et à aggraver un marasme régional qui a
rapidement gagné d'autres rives.
Cette vélocité interpelle les experts : alors que la crise du peso était restée cantonnée au Mexique et partiellement à
l'Argentine, celle du bath thaïlandais a pris en trois semestres une dimension mondiale. Pour l'expliquer, ils mettent en
avant deux facteurs : si la dépréciation du taux de change a réduit les fragilités structurelles au Mexique, elle les a
aggravées en Asie.
Ensuite, le potentiel de transmission des crises a été plus important en Asie qu'en Amérique latine.
La contagion a emprunté deux voies :
un canal financier via un désengagement rapide des capitaux installés dans les pays émergents;
une contagion économique via une déflation lente dont l'essentiel reste probablement à venir.
A cela il faudrait ajouter les risques inhérents à la fragilité du soubassement bancaire et financier dans tous les pays
incriminés et contaminés. Un problème vital auquel veulent s'attaquer notamment les autorités chinoises, sachant qu'il peut
saper l'ensemble de l'édifice.
LE ROLE DU SYSTEME FINANCIER INTERNATIONAL
L'assèchement du crédit dans les pays en crise est un frein au redémarrage de leurs économies
Depuis le début de la crise asiatique, les pertes accumulées par les plus prestigieux établissements de la planète se chiffrent en
milliards de dollars. Mais les risques pesant sur le système bancaire mondial n'ont éclaté au grand jour que le 23
septembre dernier, avec la débâcle du plus important fonds de placement spéculatif américain, Long Term Capital
Management (LTCM).
Ce jour-là, le président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, n'a pas mis plus de quelques heures pour réunir une
quinzaine de banques chargées de sauver l'établissement de la faillite. Et sortir d'un mauvais pas tous ceux qui avaient fort
imprudemment prêté quelque 100 milliards de dollars (87 milliards d'euros) à ce " hedge fund " qui, comme la loi l'autorise,
fonctionne dans la plus parfaite opacité.
L'aventure est intervenue quelques semaines après le défaut de paiement sur la dette russe, sur laquelle LTCM avait
beaucoup spéculé en achetant les fameux GKO, des titres au rendement exceptionnel. On parla pour la première fois de
risque systémique, mais la catastrophe fut évitée.
Le système bancaire est en effet un des maillons-clés dans la propagation de la crise.
Pour financer une croissance économique effrénée, les banques des Dragons ont prêté des sommes colossales et
empoché des bénéfices à la hauteur tant que les projets financés trouvaient acquéreurs. Quand la conjoncture s'est
retournée, en 1997, la Thaïlande se retrouva avec un stock immobilier invendable et la Corée du Sud avec des
infrastructures industrielles à ne plus savoir qu'en faire. Les établissements financiers, eux, face, à des clients
insolvables, furent dans l'impossibilité de rembourser, à leur tour, les prêts qu'ils avaient contractés auprès de banques
étrangères.
Ce marasme a eu au moins une conséquence : fermer les vannes du crédit, pourtant indispensable pour soutenir
l'activité. Le manque de liquidités fut d'autant plus violent que, pour défendre les monnaies locales, les banques
centrales ont imposé des taux d'intérêt extrêmement élevés.
Jusqu'à l'affaire LTCM, les pays riches se sont prétendus à l'abri d'une telle catastrophe en chaîne qui aboutit à ce que
les économistes appellent un " credit crunch ". Les banques ont joué à sauve-qui-peut en rapatriant les capitaux qui
pouvaient l'être et en provisionnant le reste. Pourtant, à la fin de l'année dernière, en dépit d'un discours rassurant, les signes
d'un durcissement du crédit étaient indéniables. " Au troisième trimestre, le volume des emprunts obligataires a chuté de 50 %
par rapport au trimestre précédent, souligne Eric Chaney, économiste chez Morgan Stanley. Si l'on admet que la demande de
crédit n'a pas varié, ce résultat traduit bien un rationnement du crédit. "
La chute du Brésil est une mauvaise nouvelle supplémentaire pour les banques occidentales. Fin juin 1998, leurs engagements
atteignaient sur le continent latino-américain 296 milliards de dollars (257 milliards d'euros) contre 325 milliards (283
milliards d'euros) pour l'Asie, selon les derniers chiffres publiés par la Banque internationale des règlements (BRI). Et les
Européens, loin devant les Américains, détenaient plus de 60 % de ce total.
De façon presque surprenante, le débat sur un possible risque systémique ne s'est pas réouvert. Faut-il en conclure que le gros
de la tempête est passé ? " La situation est beaucoup plus saine qu'au moment de la crise russe, explique Eric Chaney. Le
marché a fait un ménage brutal. Beaucoup de hedge funds ont été liquidés. Et ceux qui restent sont beaucoup moins
dangereux que LTCM. "
" Les chiffres de la BRI sont surestimés, ajoute pour sa part Patrick Artus, le directeur des études de la Caisse des dépôts et
consignations. Les difficultés du Brésil étaient anticipées depuis plusieurs mois, ce qui laisse supposer que les banques ont eu

le temps de se désengager. " Et puis le Brésil, à l'inverse de la Russie, ne s'est pas jusqu'à présent déclaré en défaut de
paiement.
Reste que la forte dévaluation du real, le maintien de taux d'intérêt très élevés, avec une dette extérieure de 80 milliards de
dollars (69,5 milliards d'euros) à plus de 60 % contractée à court terme, pourraient vite rendre la situation intenable. Le
scénario d'un rééchelonnement n'est d'ailleurs plus écarté.
" Cela aurait obligatoirement des conséquences sur le comportement des banques occidentales sur leur marché domestique ",
prévient Régis Khaber, de la société de Bourse Aurel. Son calcul est simple, lorsqu'une banque perd 1 milliard de francs (0,15
milliard d'euros) sa capacité à prêter est réduite de 12,5 milliards (1,9 milliard d'euros), compte tenu des règles prudentielles
qu'elle doit respecter. Or, d'après des estimations officieuses, les banques pourraient, au bout du compte, perdre dans la
bataille, qui n'est pas encore terminée, 40 % des prêts qu'elles ont consentis aux pays en crise, soit, selon ce calcul, plus de 100
milliards de dollars ! (87 milliards d'euros). Une bombe comparable à LTCM. Le " credit crunch " ne serait plus alors une
simple hypothèse d'école. Mais de cela aucun banquier ne veut, pour le moment, entendre parler.
" Les choses ont en fait radicalement basculé, à partir du moment où des responsables politiques ont été mis en cause à travers
le financement des partis, à la fin des années 80. Les hommes politiques ont alors représenté les boucs émissaires un peu
faciles de la délinquance économique et financière, puisqu'on les identifiait alors comme les seuls responsables. Le problème
est différent quand ce sont les entreprises qui sont en cause : le fait délinquant est plus difficilement personnalisable parce que
les responsabilités sont très intriquées et que la délinquance s'exerce dans des réseaux peu formalisés.
- Comment la lutte contre la corruption est-elle devenue petit à petit un thème prioritaire pour les gouvernements ?
- Toute autorité politique a besoin de légitimité. Or, à partir du moment où les politiques ont été interpellés, à travers le
financement des partis et les relations plus ou moins obscures qu'ils entretenaient avec les grands groupes financiers, il est
devenu nécessaire, pour eux, de montrer qu'ils pouvaient se saisir du problème.
" Toute la question est de voir jusqu'à quel point les déclarations d'intention sont suivies d'effets. Il y a quand même eu quatre
lois successives sur le financement des partis, ce qui a bien montré que, au moins pendant un certain temps, les pratiques
n'avaient pas changé. De la même façon, les accords internationaux contre la corruption, qui sont une bonne chose, se font dans
une assez grande hypocrisie : on accepte, par exemple, que des paradis fiscaux signent la convention de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) sur la corruption des fonctionnaires étrangers. En fait, il faut prendre
acte de ces nouveaux engagements afin de revendiquer régulièrement leur application et leur évaluation.
- Pensez-vous que la justice est aujourd'hui suffisamment armée pour lutter contre la délinquance économique et financière ?
- Sincèrement, non. D'une part, la justice est une institution qui ne prend pas d'initiatives, qui n'est pas self-starter : elle est
toujours saisie par des plaintes de justiciables ou des informations qui lui sont transmises. Or, en matière économique et
financière, la dilution de l'information est extrême, beaucoup plus que pour les atteintes aux biens et aux personnes. La justice
pénale n'est donc informée qu'après toute une série de filtres. Elle peut ainsi devenir le jeu de règlements de comptes entre
actionnaires et être instrumentalisée.
" D'autre part, le contentieux économique et financier est traité par des organismes différents, qui ont leurs logiques propres,
comme l'inspection du travail, la direction générale de la concurrence ou l'administration fiscale. Or ces administrations ne
transmettent à la justice que les affaires dans lesquelles elles ont échoué, et leurs critères d'appréciation pour les poursuites
restent d'un flou absolu. Ce qui pose la question de la cohérence de la politique pénale et de la définition de critères de gravité
des infractions. Les infractions économiques n'ont d'ailleurs jamais été réunies dans un livre du code pénal, elles sont
dispersées dans plusieurs lois. Sur le plan pratique, c'est évidemment un handicap pour les magistrats. Sur le plan symbolique,
cela signifie qu'on n'a pas jugé suffisamment important d'inscrire les questions économiques et financières dans la définition
des grandes dimensions de l'ordre social. L'abus de bien social, par exemple, est inscrit dans la loi sur les sociétés et le délit de
banqueroute a été sorti du code pénal.
" Enfin, la justice n'a pas les moyens d'appréhender la réalité de l'entreprise dans son ensemble. Elle ne l'aborde que par des
angles successifs : le droit du travail, le droit commercial, le droit civil ou pénal. Il faudrait plutôt penser à une spécialisation
de la magistrature économique, qui aurait accès à toutes les informations concernant une entreprise, et qui aurait vocation à
traiter tous les conflits qui s'y présentent. L'action judiciaire aurait alors une vraie cohérence face à l'acteur qu'elle prétend
réguler. Cela pourrait déboucher sur des décisions qui chercheraient un équilibre entre, d'un côté, la loi et, de l'autre,
l'opportunité économique et l'équité sociale."
BRESIL
La crise au Brésil, une menace pour ses voisins
La politique adoptée par le Brésil, après la crise mexicaine de 1994, a échoué. Non seulement elle n'a pas permis à la
croissance économique de décoller, mais elle a entraîné un alourdissement du service de la dette. Le gouvernement espérait
que les réformes structurelles mises en place dans le secteur public (prévoyance, administration et fiscalité), ainsi que les
revenus tirés des privatisations, suffiraient à combler le déficit public à temps. Mais cela supposait de disposer de
suffisamment de capitaux extérieurs pendant cette transition. C'était sans compter avec la crise asiatique de 1997, qui a eu un
très fort effet de contagion en provoquant à la fois le retrait des capitaux les plus volatils et des attaques spéculatives contre le
real. Le gouvernement a riposté par l'augmentation des taux d'intérêt. Ceux-ci ont atteint jusqu'à 50 % : Fatal pour la
croissance...

Dans un premier temps, la politique gouvernementale a néanmoins réussi à maintenir le régime des changes en vigueur. Le
Brésil pensait avoir obtenu un répit : grâce à un retour des capitaux, les réserves de change ont atteint, lors du premier semestre
1998, plus de 70 milliards de dollars. Mais la question des déficits publics n'était pas réglée pour autant. Le défaut de paiement
de la Russie a porté le coup de grâce, en provoquant un mouvement de fuite des capitaux.
La politique économique du président Fernando Henrique Cardoso.
Le Brésil a souscrit récemment un accord avec le Fonds monétaire international destiné à lui permettre de recevoir un prêt total
de 41,5 milliards de dollars (38 milliards d'euros) pour sortir de la crise. En contrepartie, le Brésil s'engage à faire des
économies de 23,5 milliards de dollars cette année, à travers un sévère plan d'ajustement fiscal et des coupures budgétaires. -
(AFP.)
AFRIQUE
L’Afrique est touchée par le biais des matières premières
Déclenché par la crise est-asiatique, l'effondrement général des cours des produits de base, du pétrole au cacao en passant par
les métaux, atteint de plein fouet les pays exportateurs. Depuis l'été 1997, les prix des produits pétroliers ont reculé de près de
40 % et ceux de tous les autres produits d'environ 25 %. A l'exception de l'Afrique du Sud, le continent africain avait échappé à
la débâcle financière, faute, il est vrai, de marchés à attaquer. La crise l'a rattrapé à travers les matières premières, source
principale de ses revenus. Au-delà de la seule Afrique, la perte de richesse des pays exportateurs de produits de base risque, en
définitive, d'être néfaste pour les pays industrialisés, dont les débouchés se réduisent.
LA CRISE DES CHANGES
Brésil et Russie, deux économies face à une crise de change
Inévitablement, la décision de laisser flotter le real brésilien fait écho à la crise du mois d'août 1998, lorsque la Russie décréta
un moratoire sur sa dette interne et laissa filer la valeur du rouble contre le dollar. Le real en 1994, comme le rouble en 1995, a
été ancré au dollar au sein d'une bande de fluctuation à dépréciation contrôlée. Cette politique s'avère efficace pour combattre
l'inflation, mais elle s'accompagne de taux d'intérêt élevés à l'origine d'une hausse du service de la dette interne, et se traduit
par une surévaluation qui finit par précipiter la crise de change.
La comparaison de certains agrégats macroéconomiques (rapportés au PIB) renforce l'impression de similitude : dette publique
à court terme de l'ordre de 15 % en Russie et approchant 20 % au Brésil (fin 1997), déficit public (8 %) et dette extérieure
(supérieure à 30 %) équivalents dans les deux pays (mi-1998). Ce tableau succinct qui laisse craindre un " effet samba " aussi
destructeur que l'" effet vodka " cache cependant des différences marquées quant aux fondements réels des deux économies, en
particulier dans les choix d'industrialisation et d'insertion internationale.
La dépendance commerciale constitue l'un des handicaps de la Russie : les hydrocarbures représentent environ deux
cinquièmes de ses ventes externes, la chute sévère du prix du pétrole depuis l'automne 1997 provoquant un choc exogène. A
l'inverse, la diversification accrue des exportations du Brésil constitue un antidote aux chocs sectoriels sur les matières
premières. Elle découle d'une politique d'industrialisation - par substitution aux importations - sur laquelle est venue se greffer
une stratégie de promotion des exportations, où firmes multinationales et entreprises d'Etat (avionneur Embraer, sidérurgiste
Vale Rio Doce,...) jouent conjointement un rôle moteur.
En matière de régionalisation, 1991 fut une année-clé pour les deux pays : création du Mercosur donnant le feu vert à la
formation d'une union douanière entre le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay (le commerce réciproque Brésil-
Argentine a ainsi connu un essor spectaculaire de 360 % en valeur entre 1990 et 1995), et instauration de la CEI qui regroupe
la plupart des Républiques de l'ex-URSS.
INTÉGRATION RÉGIONALE Malgré l'accord d'avril 1994 sur la zone de libre-échange de la CEI, la volonté de ses Etats
membres de protéger les marchés nationaux finit par prévaloir. La Russie participe à la " désintégration commerciale " de l'ex-
URSS, au moment où le Brésil s'implique dans un processus vertueux d'intégration régionale dont le rythme d'ouverture est
plus rapide que celui du commerce multilatéral.
Avant l'éclatement de l'Union soviétique, les échanges russes avec ses actuels partenaires de la CEI comptaient pour plus des
deux tiers de son commerce total, contre moins du tiers aujourd'hui. Ils sont de plus caractérisés par un très faible taux
d'échange intrabranche, héritage de l'ancienne division socialiste du travail entre les Républiques où l'hyperspécialisation était
de règle (gaz, pétrole et bois à la Russie, coton à l'Ouzbékistan, acier à l'Ukraine, etc.). Or le succès d'une régionalisation
dépend davantage de l'essor du commerce intrabranche que du commerce interbranche. C'est justement le cas des deux
puissances dominantes du Mercosur. Mais la forte croissance de leurs échanges intra-industriels depuis le milieu de la décennie
80 est aujourd'hui menacée par les tensions bilatérales que ne manque pas de susciter la chute du real.
Les changements structurels brésiliens et l'inertie du système industriel russe conduisent à opérer une distinction entre "
économie émergente " et " marché financier émergent ". Si la première désignation ne va pas sans l'autre, la réciproque n'est
pas vraie. La capitalisation boursière de la Russie s'est rapidement déconnectée de la base réelle de son économie, qui n'a
connu qu'une seule année de croissance, d'ailleurs bien timide (0,8 % en 1997) depuis le démantèlement de l'Union soviétique.

La qualité d'économie émergente n'est cependant pas une garantie contre les crises de change brisant les systèmes d'ancrage-
dollar. Le maintien d'une parité surévaluée suppose une discipline budgétaire accrue pour la crédibiliser, sans quoi la hausse
des taux d'intérêt doit s'y substituer. Or, c'est un cas critique de policy mix associant déficit public et taux élevés qui est adopté
au Brésil, susceptible donc de provoquer un cercle vicieux d'augmentation de la dette interne puis sa restructuration. L'extrême
rigueur de la politique monétaire tient aussi aux attaques répétées subies par le real au gré de la contagion asiatique puis russe
dans un contexte de libéralisation des flux de capitaux.
Si l'" effet samba " était à l'origine d'un " effet tango ", pourrait-on cette fois invoquer l'indiscipline fiscale d'un pays sud-
américain considéré parmi les plus vertueux en la matière ? L'adoption d'un ensemble de mécanismes régulateurs de prévention
des effets de contagion est aujourd'hui un défi pour la stabilité de l'économie mondiale. Le nouveau système de crédit
d'urgence du Fonds monétaire international (FMI), destiné à enrayer les fuites de capitaux de pays émergents exagérément
malmenés, en constitue peut-être les prémices.
PAR CATHERINE MERCIER-SUISSA ET JEROME TROTIGNON
RUSSIE
RUSSIE : augmentation du chômage
la crise financière du mois d'août a fait 1,1 million de chômeurs, fixant le taux de chômage à 12,4 % de la population active, en
augmentation de 4,8 % par rapport à l'année précédente, selon les dernières données du ministère russe du travail citées
mercredi 3 mars par l'agence Interfax. - (AFP.)
SOLUTIONS
Paris propose que l'Europe soit associée à l'organisation de la sécurité régionale en
Asie orientale
POMONTI JEAN CLAUDE
Alain Richard, ministre français de la défense, propose de privilégier une approche stratégique des relations entre l'Europe et
l'Asie orientale. La fin de la guerre froide, a-t-il expliqué au Monde à Bangkok, à l'occasion d'un voyage à Singapour, à Bruneï
et en Thaïlande, a débouché en Extrême-Orient sur "un climat d'incertitude", de "quasi- fluidité stratégique", qui invite à la
mise en place de "l'architecture d'une sécurité régionale pour le XXIe siècle". L'Europe, ajoute-t-il, doit être présente au côté
des Etats-Unis dans un projet qui doit donner à la notion de "sécurité", à la lueur de la crise asiatique actuelle, son "sens le plus
large possible" en incluant les données "socio-économiques".
Le ministre français suggère de donner au dialogue eurasiatique, vieux de trois ans, sa véritable dimension. En février 1996,
lors du premier sommet entre l'Union européenne et l'Asie de l'Est, le dynamisme des économies asiatiques, en dépit des ratés
de la locomotive japonaise, avait un peu occulté l'aspect stratégique des relations entre les deux régions. On s'en était tenu à
l'établissement du lien manquant entre les trois pôles de développement économique de la fin du siècle, l'Amérique
septentrionale, l'Europe occidentale et l'Asie orientale. L'ASEM, Asia-Europe Meeting, avait ainsi formé le côté manquant du
triangle dont les deux autres côtés sont l'alliance atlantique et l'APEC,la coopération économique Asie-Pacifique.
Depuis, dit Alain Richard, la crise asiatique "a clairement démontré l'existence d'un effet de dominos" affectant les intérêts de
l'Europe. Les investissements directs européens en Asie de l'Est, proches de 80 milliards de dollars (71 Mds Euros), sont
comparables à ceux des Etats-Unis ou du Japon. Trois millions d'emplois, en Europe, sont liés au commerce eurasiatique.
L'Europe a donc "un intérêt direct et substantiel au maintien de la paix et de la stabilité en Asie". Mais comment développer
une association qui soit le produit d'une vision globale de l'équation asiatique ?
Le "partenariat" doit "donner davantage de substance" au côté eurasiatique du "triangle politique et stratégique" entre
l'Amérique, l'Europe et l'Asie
Le ministre de la défense rejette une "division simpliste" des tâches entre les Etats-Unis, le Japon et l'Europe. "La solidarité
européenne dans le domaine de la sécurité ne peut se réduire à offrir une aide économique ou humanitaire; de la même façon,
la contribution américaine à la stabilité régionale ne peut se limiter à la présence de la VIIe flotte", a-t-il résumé dans une
allocution prononcée le 24 février à Singapour. Le "partenariat" auquel il pense doit donc s'élaborer d'une autre façon afin "de
donner davantage de substance" au côté eurasiatique du "triangle politique et stratégique" entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie.
Paris propose donc, dit-il, l'amorce d'un "dialogue stratégique de haut niveau" avec plusieurs pays asiatiques, comme cela est
déjà le cas avec le Japon, depuis 1994, ou la Chine et la Corée du Sud, depuis 1996. Il s'agit de consolider liens et accords avec
les pays d'Asie du Sud-Est. Pourquoi, dit-il, à l'exemple de la Grande-Bretagne, ne pas associer l'Europe à des exercices
militaires conjoints ? Le Forum régional de l'Asean, ajoute-t-il, est "essentiel". Créé en 1994 par l'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est, cette tribune consacrée aux problèmes de sécurité, réunit l'UE, les Etats-Unis et d'autres pays d'Asie. La
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%