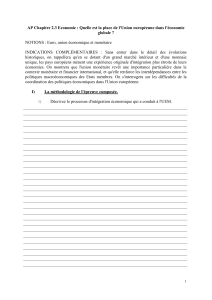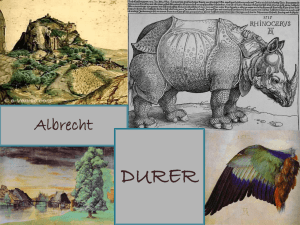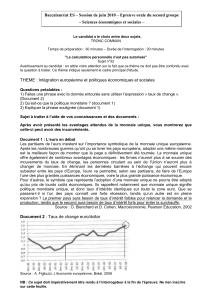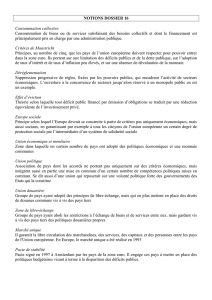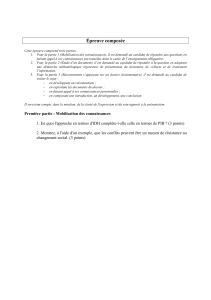Économie Internationale Macroéconomie de la globalisation Il se

1
Économie Internationale
Macroéconomie de la globalisation
Il se peut que vous trouviez des erreurs de plan dans ce document notamment pour le
chapitre 3 où le plan du professeur m'a échappé, et pour les chapitres 5 et 6 où le plan
a été changé!
Chapitre 1
De l'économie internationale à la globalisation de l'économie
I Petit dictionnaire des questions d'économie
A) Notions commerciales
Commerce international : ce sont les exportations et les importations, c'est l'ensemble des
échanges qui se trouvent réalisés entre les résidents et les non-résidents. Ce sont des échanges entre
des pays, donc le commerce international est un échange qui se réalise entre un national et un
étranger. Mais cela n'a pas de sens en économie. On préfère parler de résident et non résident.
Les résidents : agents économiques dont l'activité principale se réalise à l'intérieur d'un pays.
Certaines exportations réalisées en provenance de la France peuvent très bien être réalisées par des
firmes étrangères (comptabilisée dans la balance des paiements, même si FMN étrangère!!).
Le commerce international comprend deux sous-catégories
Les échanges de bien : échanges qui vont porter sur des marchandises, des matérialités
Les échanges de service : échanges qui portent sur des entités non matérielles (tourisme...)
→ La question du commerce internationale a longtemps été une question « seconde » lorsque l'on
examine la dynamique des économies occidentales car ces exportations ne représentaient qu'une
part relativement faible de l'activité économique. Le taux d'extraversion des économies (USA) ou
coefficient d'ouverture : 5% en 1970, aujourd'hui l'on doit être de 40 ou 50 %. Il y a une imbrication
des économies.
→ Intérêt pour le cours du commerce international : les éléments chiffrés, mais aussi les
déterminants de l'économie internationale (excédent de la BC allemande vs celle française,
portugaise...). Savoir expliquer, comprendre les déséquilibres, de plus il faudra aborder la question
de l'explication de la spécialisation internationale.
→ La spécialisation internationale : c'est pour un pays le type de produits, de production dans
lesquelles les entreprises vont se spécialiser, vont accroitre leur offre pour servir à la fois la
demande domestique et le marché mondial alors qu'il est des secteurs d'activité qui ne font pas
l'objet de production à l'intérieur des frontières, et donc font l'objet de spécialisation à l'étranger.
Ex : aviation Airbus et Boeing, deux économies se sont spécialisées Europe et USA. À l'inverse, la
spécialisation de la chine on va trouver des exportations de produits intermédiaires et de produits
assez banals. S'intéresser à la spécialisation c'est s'intéresser à la manière dont le marché mondial
donne une place à chacun de pays sur la scène internationale, le marché mondial.
Crise : c'est un moment particulier au cours duquel sur un ensemble de marchés interviennent des
décrochages tout à fait significatifs de certains prix (prix relatifs des devises ou taux de change, ou

2
celui des obligations, ou des obligations) dans des conditions qui peuvent induire des conséquences
lourdes sur le système économique. Ces crises pouvant également induire des fragilités
individuelles. Quand on parle de crise on parle d'un marché (crise du NASDAQ..), c'est sur ce
marché que se matérialise le décrochage mais en même temps ces crises vont toucher des agents
individuels (banques, BC, Etats...). C'est un concept très large (tous les types de prix vont donner
une interprétation en terme de crises) mais il y a aussi beaucoup de similarités. Elles combinent des
facteurs fondamentaux lourds (macroéconomiques) et des facteurs purement psychologiques (d'où
contagion de crises).
Délocalisations : décisions prisent par des entreprises qui jusqu'alors réalisaient toute ou partie de
la production d’un bien sur un territoire donné et donc délocalisent leurs activités vers d'autres pays.
C'est un phénomène très marquant de la période contemporaine et s'explique par le fait que les
entreprises sont de plus en plus des entreprises qui se sont internationalisées, c'est donc indiquer que
les activités de production ne sont plus réalisées au sein d'un seul espace national mais font l'objet
d'une décomposition internationale des processus de production DIPP (ex : Peugeot, Renault...).
Cet exemple est intéressant car met en avant plusieurs phénomènes :
1) L'on peut délocaliser tel ou tel état dans la fabrication d'une voiture sans pour autant réaliser
la fabrication de cette voiture à l'extérieur.
2) Cela veut dire que tous ces échanges qui vont être réalisés entre Renault France et Renault
Roumanie. On va comptabiliser cela comme des exportations et des importations entre ces
deux pays. Ce sont des échanges qui se réalisent à l'intérieur d'un même centre de décision.
Ce sont des échanges qui échappent au marché. Dans le cadre américain, les échanges
intra-firmes représentent 40 % du commerce international américain (échanges hors
marchés). Au cœur du phénomène de délocalisation est l'accentuation de ce phénomène avec
réduction séculaire des couts de transport et possibilité de pouvoir accéder rapidement à ces
input (produits intermédiaires), cela incite les entreprises à accentuer ce phénomène.
→ Cela est aussi un phénomène inquiétant car cela veut dire que certains types d'emplois sont de
plus en plus exportés, avec des conséquences salariales (depuis 25 ans au niveau des secteurs ou au
niveau des pays, cela a induit une pression beaucoup plus forte sur les salaires non qualifiés dans les
pays développés, il y a une relation entre l'accentuation de la globalisation en terme productif et la
pression sur les salaires non-qualifiés et donc sur les inégalités de revenus, car la compétition
oppose de plus en plus les non-qualifiés des pays riches et ceux de pays émergents, mais
développement pour les emplois qualifiés comme les informaticiens avec le cas de l'Inde).
Déréglementation : cela implique la réglementation. Il faut parler des règles qui accompagnent,
encadrent, chapotent le fonctionnement des marchés. Les marchés n'existent jamais sans qu'il y ait
des institutions, des règles qui en assurent le fonctionnement. Il y a beaucoup de règles de droit
(droit de la propriété intellectuelle, droit du travail, règles fiscales, droit dans le domaine de la
protection de l'environnement, droit de la concurrence, droit des sociétés).
→ Depuis le début des années 80, le monde occidental s'est lancé dans un processus de
déréglementation, c'est-à-dire de mise en cause d'une partie de ces règles afin de conforter les
mécanismes de marché, de « libérer les initiatives », de favoriser l'innovation, à l'initiative de
nouveaux élus (Reagan, Thatcher). Dans le domaine des flexibilités, dans le droit de la propriété
intellectuelle beaucoup d'allégements sont intervenus.
→ On peut l'observer sur deux plans pour le commerce international (plan commercial et plan
financier).
1) Sur le domaine commercial depuis plusieurs siècles les Etats ont imposé des protections
tarifaires (droits de douanes, droits qu'ils prélèvent sur les produits fabriqués à l'étranger : 40

3
% en 1933, or tout au long de l'après-guerre il y a une tendance à la réduction de ces droits
de douane, cela participe à l'accentuation des compétitions, des concurrences, sur un marché
mondial de moins en moins segmenté et de plus en plus intégré (cela n'est pas achevé cela
dépend des modèles, exemple de l'agriculture).
2) Sur le domaine financier, depuis les années 50 la dimension financière a été étroitement
contrôlée. Il y avait des contrôles des changes, des contrôles sur les capitaux, de même
l'entrée de capitaux dans les pays en voie de développement était contrôlée. Le prix sur le
marché des devises (taux de change) était étroitement contrôlé. À partir des années 70 pour
les taux de change, les années 80 pour les pays développés (90 pour les PEVD), on est entré
dans une véritable déréglementation de la finance : forte diminution du coût des transferts
d’épargne. Cette déréglementation a été le point de départ d’une évolution explosive de la
finance. Depuis une vingtaine d’années, le commerce international de la finance a une
croissance deux fois plus rapide que le PIB mondial. Mais les mouvements de capitaux
(échange d'actifs financiers) ont sans doute bénéficié d’une croissance 4 fois plus élevée que
la croissance du PIB. La globalisation, c’est aussi une financiarisation de l’économie
mondiale.
Il doit exister des liens entre ces notions.
Déséquilibre d'une balance de paiement. Une balance des paiements est un document, c'est le
bilan de tous les échanges que réalise un pays avec l'étranger et en particulier quand l'on parle
d'excédent ou de déficit on parle des excédent ou des déficits courants.
On parle de la balance courante, ce sont les exports ou imports commerciaux (biens plus d'autres
choses subsidiaires). Quand un pays est en déficit de la balance courante il est importateur de
devises, à l'inverse l'excédent entraine une exportation de l'épargne. Car les pays doivent réaliser
leur opérations dans différentes devises, les exportations seront réglées en devises, donc un pays
déficitaire doit fournir aux autres plus de devises qu'il ne reçoit, dès lors s'il ne les obtient pas par le
commerce il faut les obtenir par les entrées de capitaux. S'il y a un déséquilibre positif, il exporte
plus que ce qu'il importe, il obtient plus de l'étranger de devises que ce qu'il doit fournir au reste du
monde, il ne peut rien en faire à l'intérieur d'un pays, et donc directement ou indirectement ces
excédents de devises vont se retrouver au sein des pays qui eux sont déficitaires. Il y a donc une
sorte de compensation nécessaire.
→ Exemple : chine, pays asiatiques/USA. C’est exactement ce qui se passe depuis une dizaine
d’années entre les Etats-Unis et la Chine. Les pays exportateurs de pétrole exportent des produits
mais importent beaucoup moins. Ils replacent leurs capitaux notamment aux Etats-Unis.
→ Cela ne peut pas être fait naturellement, ces taux d'intérêts qui les justifient, qu'il y ait une
rentabilité de l'épargne au niveau international, cela se fait par les BC ou autres..; cela met en place
un circuit de l'épargne. Cela créé la globalisation financière.
Géographie économique : la globalisation a pour conséquence de réduire la géographie à néant.
Elle dilaterait l'espace, et créera un espace mondial (global village) et dans lequel la contrainte
géographique aurait disparue. En réalité cela est inexact du côté du commerce international, on
constate que même si les marchés sont de plus en plus ouverts, même si les entreprises s'intéressent
au marché mondial quand elles définissent un pays, il subsiste néanmoins un phénomène de
polarisation à l'intérieur de certaines zones (UE : pays ouverts davantage sur leurs voisins, pour la
France : Allemagne, Italie, Espagne environ 65% du total). Braudel parle d’ « économie monde ».
On retrouve ce phénomène en Asie, notamment concernant les partenaires commerciaux de la
Chine. Aux Etats-Unis, il y a une forte intensité des échanges commerciaux avec le Canada et le
Mexique.

4
Cette notion de régionalisation se trouve renforcer par des accords politiques, des banques de
développement (BERD, Banque du Sud peut être un jour...) : NAFTA, MERCOSUR...La
géographie n'a pas totalement disparue.
La seconde globalisation (cf. S. Berger) : la taille de l'ouverture des marchés (en matière de
commerce, de finance) que nous connaissons aujourd'hui était la même à la veille du premier conflit
mondial (car de 1850 et 1914 : on observa un phénomène comparable à celui d'aujourd'hui, une
extraversion de plus en plus marquée sur les économies extérieures et des mouvements des capitaux
double.) Après le 1GM, en revanche on observa un contrôle des changes, une interdiction de la
sortie des capitaux, la guerre ferme les économies sur elles-mêmes. Lorsque l'on reconstruit après
2GM l'économie, on le fait en conservant nombre de réglementations (sur le plan financier et celui
commercial). Dans notre période de crise, il existe toute une série de mesures envisagées. Donc ce
que l'on vit aujourd'hui, avait déjà été vécu. Donc c'est de nos jours la seconde mondialisation
B) Notions plus financières
Dictature des marchés financiers : cette notion journalistique rend compte néanmoins d'un
phénomène. Que devient l'attitude/la capacité des Etats à mener des politiques économiques que ce
soit dans le court terme pour répondre à des évolutions de la conjoncture, que ce soit dans la longue
période pour influer sur l'emploie... face à l'ampleur, le caractère incontrôlé des crises qui marque
les marchés financiers?
→ Exemple de la politique monétaire : manipulation des taux d'intérêts... dépend de la bonne
volonté du marché, elles dépendent des incitations que les investisseurs vont y trouver (les BC se
demandent comment vont réagir les marchés...). De plus, les Etats craignent de ne pas parvenir à
financer leurs déficits budgétaires (autrefois ce financement se faisait par les BC avec la création
monétaire), aujourd'hui cela se fait grâce aux marchés (exemple de l'Allemagne : émission de bons
du trésor mais les taux ont dû être relevé pour attirer les investisseurs / la prime de risque est ce que
l'on exige en cas de risque élevé). Quelle autonomie des Etats face au marché, et à la finance
globale?
Les fonds : fonds souverains, fonds de placements, fonds pension, hedge funds. Quels sont les
opérateurs emprunteurs et investisseurs qui s’endettent, qui prêtent ? C'est un ensemble de fonds qui
sont plus communément appelés des investisseurs. Ce sont des agents à qui sont confiées des
masses d'argent énorme, et qui vont gérer à l'échelle planétaire cette épargne.
1) Hedge funds : sont au cœur de la finance mondiale, avec grande prise de risque.
2) Les fonds souverains : (sont liés à une souveraineté nationale) ce sont à nouveau des
investisseurs, qui sont contrôlés par des Etats, ce sont des Etats de pays qui disposent de
ressources naturelles qui dégageant des excédents (Norvège, Algérie, Russie, OPEP) et qui
vont réinvestir sur les marchés financiers. Ils jouent aussi un rôle de recomposition de
l'épargne sur les marchés financiers, en arbitrant entre des investissements directs et des
investissements de portefeuille.
→ Quand on parle de transferts de capitaux ont distinct
les IDE ((FDI en anglais) investissements de long terme que réalisent soit des entreprises
soit des fonds et donc qui sont assez peu volatiles, par exemple : les fonds souverains du
golfe persique). Certains sont ainsi chargés de gérer pour leurs pays l’après-pétrole, en
dégageant des recours sur investissement permettant de dégager de la richesse. Leur horizon
est 2060-2080. Ce type d’investisseurs ne va pas changer la localisation de ses avoirs tous
les mois ou après lecture de la presse. Ces investissements sont placés dans des entreprises
suffisamment solides, dont la taille est la plus importante (en France, le CAC 40, dont près
des 2/3 est contrôlée par des investisseurs longs étrangers), et

5
les investissements de portefeuille (investissements à court terme, avec des entrées et
sorties sur les marchés fréquentes, créant par le comportement spéculatif de la volatilité sur
les marchés).
Comportement spéculatif : il y a des opérations qui se déploient dans un monde incertain car ce
développement se fait dans le futur. Donc on fait des prévisions, on anticipe. Dès lors on spécule
(on regarde loin). Dès que l'on travaille à une certaine échéance, on doit prévoir, et c'est pour cela
que la psychologie des marchés joue souvent un rôle primordial.
Titrisation : il faut étudier la façon dont se différencient les diverses catégories des opérateurs
financiers.
→ Au premier rang : les banques. Elles collectent des dépôts et avec ces liquidités, elles accordent
des crédits. Cela on l'appelle l'intermédiation. Mais aujourd'hui ce modèle est remis en cause. Des
banques collectent des dépôts dans un pays pour donner à des débiteurs dans un autre pays. Ce
mécanisme d'intermédiation est de plus en plus dépassé par un autre mécanisme financier qui est la
titrisation.
→ Les emprunteurs (entreprises, Etats...) plutôt que de s'adresser à des banques, émettent des titres,
des actifs et donc proposent sur des marchés financiers ces actifs (obligation, action..) et ces actifs
ce qui vont les acquérir vont être rémunérés, sans qu'il y ait des intermédiaires. Cette substitution
est la titrisation. La titrisation est la substitution de financements par des émissions d'actifs à des
investissements par l'intermédiaire des banques.
→ Mais cela peut entrainer une chaine de prise de risque qui peuvent dans certaines occasions
donner naissance à des crises (risque de changes, ..) ces titres comportent d'autant plus de risque
qu'ils ne sont pas conservés mais revendu sur les marchés.
Banques Centrales : elles répondent à un certain nombre de fonctions qui sont d'un caractère
macroéconomiques. Elles sont chargées de mener les politiques monétaires (fixent taux d'intérêt,
contrôlent l'évolution de la liquidité) et sont chargées d'assurer la stabilité financière par
conséquence elles sont des acteurs publiques.
→ Mais elles sont différentes de Etats. Les BC sont pratiquement toutes indépendantes : un mandat
leur est confié par les Etats, leurs responsables sont désignés par les Etats, mais une fois désignés ils
sont indépendants. Leur rôle essentiel est l'injection de liquidité.
→ Or Ce qui crée la complexité de la chose, c’est la globalité des marchés, une circulation accrue à
l’échelle internationale : des logiques globales se définissent. Les marchés sont de plus en plus
globaux, l'épargne circule à l'échelle internationale et face à cela les institutions, les instruments
d'intervention qui peuvent être mobilisés sont ceux de banques centrales mais qui a priori
interviennent de manière non coordonnées. Elles mènent des politiques dans leur intérêt propre sans
réellement se préoccuper des répercussions dans le reste du monde.
→ Cette indifférence des banques centrales est un révélateur d’une sorte de contradiction entre les
tendances qui se dessinent sur les marchés (des fonds, des entreprises travaillant à l’échelle globale)
et des banques centrales peu coordonnées, intégrant assez peu les externalités, les conséquences sur
le système d’action locale.
Comment, en tant qu'économiste en utilisant un certain nombre d'outils, peut-on arriver à
comprendre ces phénomènes? Il faut construire des schémas d'interprétation.
Allocation efficience des ressources : principe même de l'économie. C'est d'utiliser un certain
nombre de mécanismes qui permettent de répartir des ressources rares afin de conduire à un degré
maximum de bien être matériel et donc le niveau le plus élevé possible de production des richesses.
Et de ce point de vue, le mouvement de libéralisation des marchés a été justifié par le fait qu'en
donnant une taille plus grande au marché, en permettent aux économies nationales de se spécialiser
dans les domaines où elles ont une capacité concurrentielle plus grande que les autres, il participe à
une allocation qui rend un niveau de bien-être meilleur. Cela permet notamment à des pays en
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
1
/
73
100%