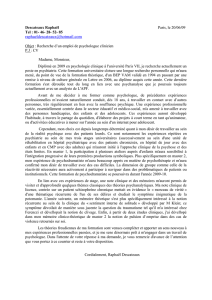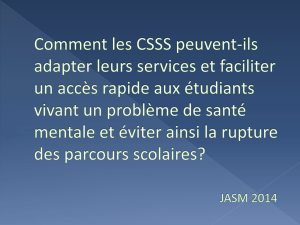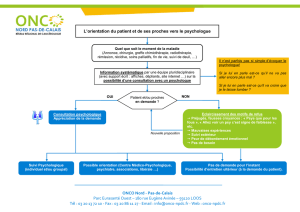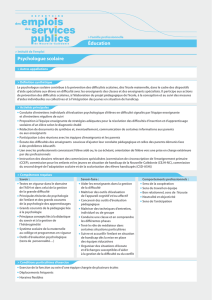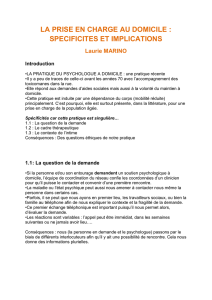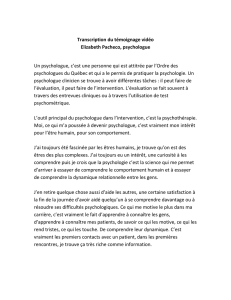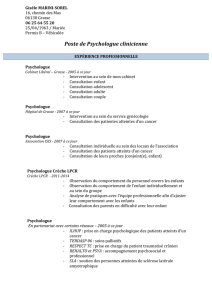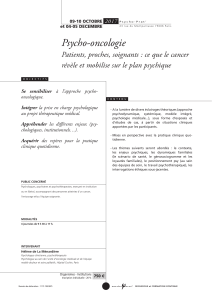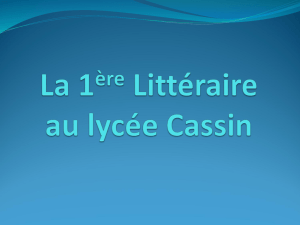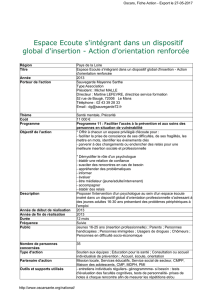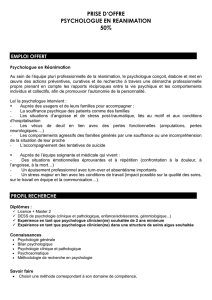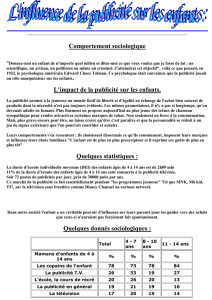Cours du 05 mai 2010. 2h : Le travail du psychologue à l`Unité

FD Page 1 08/06/2017
Cours du 05 mai 2010. 2h :
Le travail du psychologue à l’Unité Thérapeutique
Familiale Adulte. CHG Robert Ballanger
1. Historique, constitution de l’équipe, le projet institutionnel
a) Historique et projet institutionnel
L’UTA FA [Unité thérapeutique d’accueil familial adulte] a été créée en 1993. L’objectif était
alors d’offrir à des patients adultes le plus souvent schizophrènes une alternative à
l’hospitalisation. Il s’agissait de patients suffisamment stabilisés mais encore trop fragiles et
trop dépendants pour affronter seuls l’extérieur même avec le soutien des équipes de secteur.
Plusieurs années ont été nécessaires pour développer le service et stabiliser l’équipe. Il faut
toujours par ailleurs convaincre de l’utilité de ce type de prise en charge peu répandue.
Il faut présenter l’U.T.A.F.A en la distinguant d’une unité de placement social destinée à des
patients de psychiatrie. Comme je vais le développer, la dimension thérapeutique de l’accueil
familial est centrale dans nos pratiques. Si l’U.T.A.F.A a pour objectif de sortir des patients
de l’hospitalisation, il n’est pas l’objectif ultime, englobant bien d’autres dimensions dans la
prise en charge et le soin du sujet psychotique. C’est ainsi que l’U.T.A.F.A se positionne
comme une interface, une membrane (avec toute la dynamique qui la constitue et la définit)
entre le dedans et le dehors…
C’est une unité fonctionnelle intersectorielle c'est-à-dire qu’elle s’occupe de la prise en charge
de patients psychotiques adultes du service de psychiatrie B mais aussi des autres services de
psychiatrie de l’hôpital.
Très concrètement, il s’agit d’accueillir des patients adultes et de guider leur prise en charge
au quotidien par une famille d’accueil elle-même recrutée par l’hôpital. Les familles ne sont
pas des thérapeutes ; ce qui rend le travail thérapeutique c’est le travail d’équipe qui rend
l’accueil familial thérapeutique. Le rôle et les places des membres de l’équipe de l’U.T.A.F.A
sont donc très différents de ceux que l’on peut rencontrer habituellement au sein d’un service
d’hospitalisation ou même d’un service d’hospitalisation à domicile. C’est avant tout un
travail institutionnel dans lequel les décisions sont concertées et partagées.
L’U.T.A.F.A. est une unité de soin se préoccupant des aménagements du réel permettant à un
patient psychotique stabilisé (mais évidemment pas asymptomatique) de mener une vie dans
la société. L’objectif de l’UTA FA est de permettre une insertion sociale des patients de
psychiatrie dans la société, qu’elle passe par une insertion professionnelle ou non. Dans ce
cadre, elle œuvre à la prévention des rechutes et à l’amélioration de la qualité de vie des
patients. Elle porte en elle un projet de société : résister à la désinsertion sociale des personnes
porteuses de handicap.
L’objectif des entretiens avec le médecin ou la psychologue n’est pas la mise en place d’une
psychothérapie en face à face mais de permettre, par l’écoute des patients et des familles
d’accueil, de guider, soutenir et éclairer le travail infirmier à domicile. L’objectif de cette
prise en charge est de permettre une meilleure insertion du patient psychiatrique dans le tissu

FD Page 2 08/06/2017
social et lui donner des voies d’étayage lui permettant de mieux vivre avec ses troubles et sa
psychose.
La prise en charge au sein de l’U.T.A.F.A. repose sur deux piliers principaux : les visites à
domicile faites par les infirmières (plus occasionnellement accompagnées du médecin et/du
psychologue) et des entretiens à l’hôpital, dans les locaux de l’U.T.A.F.A. Ainsi le patient et
la famille d’accueil sont reçus en alternance par le médecin ou le psychologue
(éventuellement accompagnés d’une infirmière) pour des entretiens bimensuels entre lesquels
se placent les visites à domicile. L’essentiel du travail de l’équipe de l’U.T.A.F.A. consiste
donc en un aménagement continuel de l’environnement du patient. Même si un cadre est posé
avec les familles d’accueil, celui-ci doit être en permanence réajusté afin de ne pas se
rigidifier et garder son intérêt thérapeutique.
De ce fait, l’U.T.A.F.A. se place dans la perspective de la réhabilitation psychosociale.
L’expression de « réhabilitation psychosociale » porte toujours à polémique et divergence.
Expression à la mode ? Pas seulement, avec les bouleversements que connaît aujourd’hui
l’hôpital… elle est fille de la sectorisation (Le Guillant, Bonnafé, Mignot…) mais
aujourd’hui, elle n’a plus vocation d’être hospitalo-centrée. Elle est hors des limites physiques
de l’hôpital car ce dernier n’a pas vocation d’être le centre de la vie de la personne prise en
charge en psychiatrie. L’un de ses intérêts premiers est de limiter les effets de désinsertion et
de désadaptation sociale engendrés par la prise en charge en psychiatrie. Elle ne se substitue
en cela pas aux soins psychiatriques, mais vient compléter le dispositif. Elle privilégie la
qualité de vie et ne se situe pas dans une vocation curative. On pourrait la penser à la manière
de la rééducation fonctionnelle…
En recentrant les objectifs de la politique de soin et par là même le Sujet atteint de psychose,
elle participe à la resubjectivation du patient. Elle en fait le point de départ et le centre de tous
nos dispositifs et de toutes nos interventions. De ce fait, elle modifie nos pratiques et les
limites de l’hôpital, décentrant le travail de réseau et amenant une redéfinition du rôle et de la
place du service de psychiatrie et des soignants.
La réhabilitation psychosociale est avant tout pragmatique, prise dans le réel ; elle s’intéresse
avant tout à l’individu, à ses potentialités et à son environnement. Elle se propose de
permettre au Sujet atteint de psychose à se maintenir dans la Cité. Vivre avec sa maladie sans
perdre le lien social, surtout lorsque celle-ci est chronique, représente en effet tout l’enjeu de
la démocratie sanitaire…
b) Constitution de l’équipe
Depuis son ouverture en juin 1993, l’U.T.A.F.A a connu bien des bouleversements
institutionnels et des modifications de l’équipe qui la constitue.
A l’origine, l’équipe se constituait : d’un médecin psychiatre, responsable de l’unité à mi-
temps, de deux psychologues à mi-temps, d’une assistante sociale à mi-temps, d’une
surveillante à mi-temps, de trois infirmières à mi-temps et d’une secrétaire à 80%.
Aujourd’hui, l’équipe se constitue : d’un médecin responsable à mi-temps, d’une psychologue
à temps plein, d’une infirmière à temps plein et d’une seconde à mi-temps et d’une secrétaire
à 80%. La réduction des effectifs et la réorganisation de l’équipe ont eu inévitablement des
conséquences sur l’organisation du travail, menaçant l’équilibre du collectif de travail.
2. Le travail du psychologue

FD Page 3 08/06/2017
Complexe et multidimensionnel, le travail du psychologue, inspiré par la psychodynamique, à
l’UTAFA se compose de temps effectifs d’entretiens comptabilisables, tout comme les temps
de réunions mais il ne se limite pas à cela. Le travail du psychologue est avant tout, dans cette
unité, un travail institutionnel. Inséparables l’une de l’autre, la clinique et la théorie
s’alimentent l’une l’autre. C’est justement ce qui fait la richesse et la complexité du travail du
psychologue clinicien. La dimension de recherche infiltre ma pratique de psychologue tout
autant qu’elle l’alimente. Ainsi je pourrai déterminer cinq dimensions de mon travail qui ne
peuvent être déliées les unes des autres sauf à retirer le sens de mon travail : le travail clinique
d’entretien (auprès des familles et des patients), le travail cliniquo-institutionnel des réunions,
le travail institutionnel et la réflexion sur l’organisation de travail, la formation et la
recherche.
a) Les entretiens
C’est sans doute la partie la plus quantifiable du travail du psychologue. Néanmoins, le travail
fait en entretien ne peut pas non plus se réduire à la comptabilisation d’un temps passé avec le
patient ou la famille. Le travail de psychologue clinicien en entretien se décrit d’abord et
avant tout par la description d’une posture. Le psychologue n’est pas celui qui est garant du
cadre de travail prescrit par l’institution aux familles d’accueil mais celui qui pense la manière
dont les individus travaillent à l’intérieur de ce cadre. De ce point de vue, sa place est
spécifique et non interchangeable.
Ces entretiens sont proposés aux patients admis en famille d’accueil mais aussi aux familles
d’accueil et éventuellement, en cas de demande, aux familles d’origine des patients pris en
charge par l’UTAFA.
De manière plus ponctuelle et à la demande de l’équipe infirmière, il peut m’arriver de
participer à des visites à domicile lors desquelles (entretien au domicile de la famille
d’accueil, en situation donc, entre l’infirmière, la famille d’accueil et le patient).
b) les réunions
Les réunions de synthèse
Lors de ces réunions, l’éclairage donné par le psychologue concerne les processus à l’œuvre
dans la prise en charge des patients. Il s’agira pour moi de « penser le travail » non seulement
de l’équipe mais surtout des familles d’accueil. Les entretiens avec les patients n’étant pas des
entretiens psychothérapiques type CMP, il s’agira certes de réfléchir à la psychopathologie
présentée par le patient mais surtout en ce qu’elle guide la prise en charge et donne sa couleur
au travail des familles d’accueil.
Les présentations de patients
Dans un premier temps, les équipes soignantes viennent présenter le patient qu’ils proposent à
l’admission en famille d’accueil à l’UTAFA. Lors de ces réunions, le psychologue a un rôle
d’écoute et d’analyse de la demande de ces équipes, plus que d’expertise clinique en
psychopathologie. Il s’agit d’analyser le projet formulé par l’équipe soignante et de réfléchir à
nos possibilités (ou nos impossibilités) à y répondre au moment de cette présentation. Même
si la réunion ne se solde pas par une admission du patient en famille d’accueil, cette réunion
sera le premier temps d’élaboration d’un projet qui pourra éventuellement devenir commun
dans un temps ultérieur. S’en suivent les premiers rendez-vous (avec une des infirmières) lors
desquels il s’agit d’entendre la demande des patients qui ne se confond pas et même est à
l’opposé de celle des équipes soignantes qui ont proposé le projet. Il s’agira alors parfois de
résister pour faire entendre la parole du sujet…

FD Page 4 08/06/2017
Avec les personnes postulant au poste de famille d’accueil
Là encore il s’agit de faire émerger une demande claire, cela nécessitant parfois plusieurs
entretiens. Une fois que cette demande est claire, la décision sera prise en équipe de proposer
à l’administration la candidature qui nous avait été initialement présentée. Le psychologue ne
pourra pas dans ces entretiens ni tenir la place d’un analyste ni celui d’un chargé de
recrutement.
Avec les institutions médico-sociales et les thérapeutes en CMP
Passerelle entre « l’intra » et la société, l’UTAFA coordonne les prises en charge mises en
place autour d’un patient et à partir de la vie quotidienne dans un espace familial. De ce point
de vue, le psychologue assure là également une mise en lien des « différentes parties de vie »
du sujet patient de psychiatrie. Passerelle, l’UTAFA entre donc comme composante de la
continuité des soins mis en place autour d’un patient ce qui nous amène à devoir
régulièrement prendre des temps de synthèses avec nos collègues thérapeutes tant de l’intra-
hospitalier que sur les structures extra-hospitalières (CMP, CATTP, HDJ…) mais aussi
médico-sociales (tutelles, ESAT, foyers d’hébergement etc.)
c) le travail institutionnel
Le temps « informel » avec l’équipe
Ce travail institutionnel, informel comporte plusieurs strates : le travail sur les liens
transférentiels qui unissent patients et équipe mais également les membres de l’équipe entre
elle, prise de distance dans la relation au patient mais également [r]établissement des liens
attaqués par la psychose… Ce temps de travail institutionnel ne s’arrête pas sur une journée, il
ne se comptabilise pas et déborde même, selon moi, le strict temps de travail. Il ne se confond
pas sur un temps de réunion, c’est le temps passés avec les infirmières, la secrétaire ou même
d’autres intervenants, extérieurs à l’UTAFA dans la prise en charge du patient. C’est un temps
de « l’entre-deux », au décours d’un café, dans un coin de la salle de réunion, au passage
d’une porte… C’est ce travail qui met du lien dans la prise en charge du patient. C’est ce
temps de travail, parfois très court et parfois très long, qui permet la synthèse et l’unification
des investissements que les membres de l’équipe font d’un patient. Autrement dit, c’est un
temps essentiel, fondamental mais non évaluable si ce n’est en situation même de travail. Il ne
rentre pas dans les grilles d’évaluations, ne souffre d’aucune cotation.
Cette fonction de lien est aussi présente entre les équipes, entre les structures de prise en
charge, au sein des groupes familiaux autant qu’au niveau intra-psychique des patients.
Projet pour 2010 : les groupes de famille d’accueil : constitution
d’identité professionnelle et prévention de la souffrance au travail.
A recevoir régulièrement les familles d’accueil en entretien pour les entendre parler de leur
travail, il est apparu la nécessité de la mise en place d’un étayage sur un collectif. Voici le
projet rédigé et destiné à se mettre en place en 2010 :
Fondement théorique de la création du groupe de parole destiné aux familles d’accueil.
Le placement thérapeutique en famille d’accueil de patients adultes de la psychiatrie
convoque les limites du cadre et du dispositif thérapeutique classique essentiellement parce
qu’il s’appuie sur le travail de personnes initialement non formées à l’accueil et au travail

FD Page 5 08/06/2017
auprès de tels patients. Ces familles n’ont pas reçu de formation concernant l’approche des
troubles psychiatriques. Sous le terme générique de « famille d’accueil », nous entendons
qu’il s’agit d’une personne recrutée par l’hôpital mais qui ne se trouve pas seule dans la prise
en charge à leur domicile. L’ensemble du groupe familial, même si cela peut être de manière
plus distanciée, se trouve confronté à l’accueil du patient. Les interactions du groupe familial
ne sont donc pas sans conséquence sur le patient accueilli. Néanmoins, pour ce dernier, la
personne recrutée par l’hôpital reste sa référence au domicile car elle est notre interlocuteur.
Même si notre équipe doit prendre en compte les effets de l’interaction des membres de la
famille, elle ne s’adresse qu’à celui qu’elle a recruté afin de relayer le cadre de la prise en
charge mis en place par les équipes soignantes.
Même si les ressentis, les affects de tous les membres de la famille d’accueil sont pris en
compte par l’équipe de l’UTAFA, notamment lors des VAD, un tel groupe de parole destiné
aux familles d’accueil ne saurait se placer comme groupe de parole thérapeutique stricto sensu
ni même sur le modèle de groupes proposés par certaines associations de famille de patients.
Par ailleurs, les attentes formulées par les familles d’accueil lors de nos réunions annuelles se
concentrent autour d’un besoin d’échanges et d’écoute de leurs pratiques de travail, en
définitif très peu décrit. De la même manière, elles nous adressent souvent des questions
concernant leur statut et leur place nous interpellant du côté d’un défaut de reconnaissance de
leur travail.
L’exercice du travail situe toujours le sujet dans un rapport social et une dynamique
collective. On travaille pour et avec les autres. La rencontre avec le travail représente ainsi
une expérience irremplaçable d’apprentissage de formes spécifiques de coopération entre
travailleurs. L’appartenance à un collectif de travail n’est pas spontanée mais passe par la
confrontation, l’apprentissage et la participation à l’élaboration de règles de métier. Entre
l’ingéniosité individuelle et la coopération, une place spécifique revient à la délibération sur
les modalités du travailler. Cet espace de délibération qui contribue à l’élaboration, mais aussi
à la transmission des règles de métier, n’est pas prescrit mais négocié entre ceux qui
travaillent. La reconnaissance par autrui est indispensable pour la validation d’une trouvaille
initiée dans la confrontation avec le réel. Cette reconnaissance passe par des jugements
formulés sur le travail qui témoignent de la valeur accordée à un procédé de fabrication, à une
manière de faire, à une action. La dynamique de la reconnaissance convoque donc des
jugements qui portent non seulement sur le travail individuel mais interrogent également la
conception de la justice (action juste ou injuste) et de la solidarité. La validation du travail par
la reconnaissance accordée par les autres est un élément majeur du sens subjectif du travail
qui participe à la construction de l’identité. En l’absence de reconnaissance, le doute quant au
rapport entretenu avec le réel apparaît. Quand ce doute s’installe, l’identité tout entière peut se
trouver déstabilisée.
La reconnaissance passe par deux jugements : d’une part un jugement d’utilité (donné par les
supérieurs, les subordonnés ou les clients) et d’autre part un jugement de beauté. Un sac de
maroquinerie par exemple, ou de tout travail (réparer un moteur, confectionner un plat…) se
voit apposé ces deux jugements. Un jugement que je désignerai comme vertical : les
supérieurs ou les clients jugent de l’utilité du résultat du travail fourni. On le retrouvera sous
la locution « c’est du bon travail ». Ce jugement s’établit par rapport à une norme externe à
laquelle doit se conformer le produit du travail. Mais aussi un jugement horizontal c’est à dire
ceux qui peuvent désigner un travail comme « mieux fait » par rapport à un autre. Il ne peut
être porté que par les pairs. On le retrouvera sous la locution : « c’est du beau boulot » ou du
« sale boulot ». Il ne s’établit quant à lui que par rapport à une norme interne au corps de
métier. Il se décompose en deux temps : la conformité qui consacre l’appartenance à la
communauté de métier et l’originalité de la contribution, ce en quoi le travail effectué fait la
 6
6
 7
7
1
/
7
100%