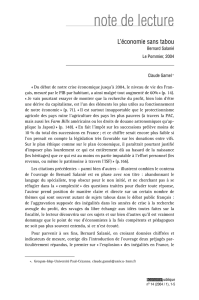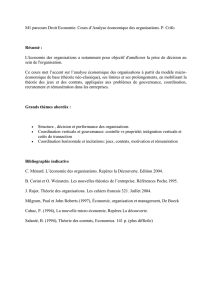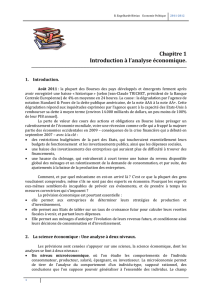conomie Economie sans tabou salanié PAM Céci - prepa-bl

L'économie sans tabou (2011)
de Bernard Salanié, édition Le Pommier
Introduction : des préjugés et des chiffres
Libéralisme économique : organisation économique qui laisse une large part à l'initiative privée et à l'ouverture
sur l'extérieur.
Le libéralisme a-t-il échoué?
- Le SMIC de 2010 a le même pouvoir d'achat que le salaire moyen de 1965.
- exemple des deux Allemagne : l'Allemagne de l'Ouest avait un niveau de vie trois fois supérieur à celui de l'Est.
- Le libéralisme sauvage (milieu XIXe) des États gendarmes où l'impôt ne dépassait pas 10% du PIB a évolué.
Les inégalités ont-elles explosé?
- Les chiffres indiquent qu'elles ont diminué fortement entre 1970 et 1984 (rapport interdécile passé de 4,8 à 3,5)
puis sont restées stables jusqu'en 2008 (rapport de 3,4 en 2008) et l'évolution récente a favorisé les plus riches.
- L'impression d'une hausse tient à la visibilité des plus riches dont on connait les revenus (PDG, grands sportifs)
et des plus pauvres qui sont souvent de jeunes urbains alors qu'il s'agissait surtout de personnes âgées rurales.
- Au niveau mondial, François Bourguignon et Christian Morrisson ont montré une forte hausse jusqu'en 1950 et
d'autres sources indiquent une certaine constance depuis 1980 grâce au développement des pays pauvres.
Première partie : Le fonctionnement d'une économie de marché
Chapitre 1 : Le jeu de l'offre et de la demande
Les prix déterminent les quantités produites et achetées de tous les biens mais aussi la distribution des
revenus. La détermination des prix est donc le problème fondamental des sciences économiques. La ʺ théorie de
l'équilibre général ʺ montre que les prix de tous les biens réalisent un équilibre simultanément sur tous les
marchés. Mais on utilise aussi la ʺ théorie de l'équilibre partiel ʺ qui néglige les interactions avec les autres
marchés. Quelques mécanismes simples : si le prix augmente, la demande diminue ; stimuler la demande
augmente les prix ; ce qui accroît l'offre réduit le prix. On observe un ajustement des prix.
En prenant l'exemple de la baisse de la TVA dans la restauration on peut comprendre le jeu de l'offre et
de la demande à court et long terme : l'addition sera moins élevée ; les clients seront plus nombreux ; les
restaurateurs gagneront plus et le secteur devenant plus attractif, de nouveaux emplois seront créés ; d'autres
seront détruits car ʺ rien n'est jamais gratuit ʺ et d'autres impôts seront augmentés symétriquement ; enfin, le
nombre de restaurants augmentant, les profits de chaque restaurateur diminueront. On observe un transfert de
l'argent des contribuables les moins favorisés vers les plus aisés car ces derniers vont plus au restaurant.
Chapitre 2 : Les vertus de l'économie de marché
ʺ Premier théorème fondamental du bien-êtreʺ illustré par la parabole de l'île de Parétie : Tous les biens
sont alloués au hasard aux habitants qui créent une économie de troc. Cette dernière n'étant pas très performante,
ils créent une monnaie et après de nombreuses interactions, les prix s'établissent pour équilibrer offre et demande
sur chaque monnaie. Si un gouvernement était mis en place, même bienveillant, il ne pourrait pas améliorer le
sort de tous les Parétiens en même temps. En revanche, le marché fait surgir l'ordre ʺ sous la forme d'un équilibre
concurrentiel qui alloue les ressources de manière efficace ʺ. Les allocations ne sont pas dites équitables ici.
Le ʺ deuxième théorème fondamental du bien-être ʺ introduit des corrections du gouvernement en
modifiant les dotations initiales. De plus, le premier théorème se place dans une ʺ situation de premier rang ʺ où
les défaillances du marché et le fonctionnement de l'économie de marché conduisent à des inefficacités. En effet,
certains biens comme les biens publics ne peuvent être alloués efficacement par le jeu du marché.
Greewald et Stiglitz (nobel 2001) s'intéressent donc aux ʺ situations de second rang ʺ : en présence d'une
défaillance, il existe des formes d'intervention du gouvernement qui peuvent améliorer le sort de tous les agents.
Dirigistes : ceux qui les estiment fréquentes, graves et font confiance aux autorités pour y remédier.
Libéraux : ceux qui refusent d'exagérer leur importance et pensent l'État mal armé pour y remédier.

Chapitre 3 : Le rôle des prix
Imaginons qu'il y ait une pénurie de café, comment la répartir entre les acheteurs? Après avoir fait un
inventaire, il faut choisir les critères (revenu? Comment savoir leur goût?..), stimuler la production de substituts
(en quelle quantité?), réduire la production des biens liés (cafetière par ex)... Tout cela semble hors de portée des
facultés humaines. Si on choisit le marché et non le plan, chacune des modifications du système de prix
entraînera une réallocation des forces productives des biens dont le prix baisse vers ceux dont le prix augmente.
Lorsque l'intervention de l'État est nécessaire, il est préférable qu'il n'interfère pas avec le fonctionnement du
système des prix mais l'oriente. Par exemple, l'introduction des 35h aurait du élever le salaire des infirmiers et
attirer plus de postulants, mais ils sont restés fixes dans la fonction publique. On observe une détérioration des
hôpitaux publics et une attraction des privés. La multiplication des actes médicaux incite à responsabiliser les
acteurs en leur faisant supporter une partie des conséquences de leurs actes. Coase (nobel 1991) observe que le
propre d'une entreprise est de contourner les prix car elles préféraient engager des soudeurs et des ingénieurs en
CDI plutôt que de faire appel à des indépendants en concurrence (meilleurs contrôle et description des tâches).
Mais on observe que le développement des TIC et de l'informatique favorise l'externalisation.
Chapitre 4 : Le profit, moteur du changement
Valeur ajoutée d'une entreprise : valeur de sa production – valeur des biens qu'elle a détruit pendant celle-ci.
Elle est partagée entre les salariés et contributions sociales (60%) et la ʺ rémunération du capital ʺ (payer les
emprunts, l'impôt sur les sociétés, l'investissement et la distribution des dividendes aux actionnaires).
Profit d'une entreprise : valeur des biens qu'elle produit – coût des facteurs de production qu'elle utilise.
La recherche de ce dernier par les chefs d'entreprise passe par des réductions de coûts qui les poussent à
employer au mieux les facteurs de production.
On doit signaler ici l'importance de la concurrence dans la baisse des prix. Le ʺ cartel des vitamines ʺ ou
celui du gros équipement ont ainsi maintenu des prix 20 à 30% plus élevés que s'ils étaient en concurrence. En
effet, Cournot a montré en 1838 qu'une entreprise ayant une part de marché très importante peut faire augmenter
les prix en adoptant un comportement ʺ malthusien ʺ (réduire sa production). Sachant qu'il existe des Autorité de
la concurrence, les entreprises comptent sur les inventions pour se démarquer (un brevet est valable 20 ans si elle
ne vend pas de licences). Chaque idée subit le test du marché, est récompensée ou sanctionnée et alimente un
flux considérable d'innovations. Le capitalisme favorise l'amélioration du niveau de vie des couches populaires
car les profits sont réalisés en vendant aux masses et non aux élites ; le héros de l'économie de marché est
l'innovateur. Schumpeter caractérise le capitalisme par la ʺ destruction créatrice ʺ car l'innovation crée plus
d'emplois qu'elle n'en détruit. Il paraît plus porteur de reclasser les travailleurs licenciés que d'interdire les
licenciements. Chapitre 5 : Les multiples formes de chômage
Signalons aussi que le taux de chômage des peu qualifiés est bien supérieur en France (11,4% contre 7%
aux États-Unis en 2007). Une autre spécificité est le chômage de longue durée qui signe trop souvent le début
d'un processus d'exclusion durable : 40,4% des chômeurs français le sont depuis plus d'un an contre 10,0% aux
États-Unis en 2007.
On distingue le chômage conjoncturel du chômage structurel (en France il atteint 7 ou 8%). Les
économistes affirment que si le taux de chômage total est inférieur à ce dernier, l'inflation augmenterait.
Chiffres de 2007
Zone
Tx d'emploi
Tx de chômage
Fr 15-24 ans
37,0%
18,7%
E.U. 15-24
59,4%
10,4%
Fr 55-64 ans
40,4%
5,1%
E.U 55-64
63,8%
3,1%
Zone
Taux d'emploi
Taux de chômage
France
65,1%
7,9%
Zone euro
67,0%
7,4%
États-Unis
73,1%
4,6%

Réciproquement, la baisse de l'inflation se paye par un chômage total supérieur. Ils estiment que pour réduire
l'inflation d'1%, il faut un taux de chômage de 2 à 3% en 1 an ou de 1% pendant 2 ou 3 ans :la valeur du ʺ taux
de sacrifice ʺ est entre deux et trois.
Chapitre 6 : Les marchés boursiers
Alors que le krach d'octobre 1987 et le baisse de moitié des marchés boursiers mondiaux entre 2000 et
2003 n'ont pas eu de graves conséquences économiques, la forte chute des cours en 2008 a été accompagnée
d'une récession mondiale. La baisse des cours aurait été plus un symptôme qu'une cause.
La Bourse : lieu de rencontre entre épargne du grand public (40% des Français ont des actions) et demande de
financement des entreprises. Action : part d'une entreprise qui donne droit aux dividendes.
A la fin du XVII, les entreprises se finançaient grâce à des partenariats ou des emprunts ; seuls les projets
à très haute rentabilité pouvaient être financés et cela constituait un frein au développement économique. Grâce à
la Bourse, une relative liquidité des placements des épargnants est garantie. Jusque vers 1900 les marchés sont
chasse gardée des spéculateurs professionnels mais comme les investisseurs perdent peu (pas poursuivis pour les
dettes de l'entreprise), on observe une ouverture. Mais les deux seuls moyens de gagner plus à la Bourse qu'à la
Caisse d'épargne sont le délit d'initié et le fait de prendre des risques importants.
La première règle d'or est la diversification. Bien qu'on incite les salariés à posséder des actions de leur
entreprise, pour aligner leurs intérêts avec elle, on constate que si elle périclite, ils perdent tout. Cela pourrait
suggérer d'avoir des actions de l'entreprise concurrente !
Robert Shiller a montré que la variabilité de l'indice boursier américain est bien plus élevés que celle des
dividendes alors qu'elle devrait la refléter. La valeur des actifs boursiers est composée de la valeur fondamentale
qui dépend des dividendes espérés et d'une composante imprévisible, appelée la ʺ bulle ʺ (cf la ʺ bulle Internet ʺ
de la fin des années 1990). Il convient que les dirigeants soient surveillés par des conseils administratifs
indépendants et des organismes publics comme l'Autorité des marchés financiers. Mais on remarque que les
agences de notations ont accordé des notes flatteuses à des placements risqués. Shiller propose d'étendre
l'émission de titres au-delà du cadre des seules entreprises : un dentiste nouvellement diplômé pourrait
abandonner 10% de ses revenus en échange d'une somme mensuelle fixée à l'avance ou un étudiant financerait
ses études par un emprunt gagé sur ses futurs revenus.
Seconde partie : La politique économique
Chapitre 7 : Plaidoyer pour le libre échange
« Le libre échange se caractérise par la volonté de réduire les obstalces au commerce international » ; concept
plébiscité par 80% des économistes, mais aspect positifs non mis en avant par les journaux et les hommes
politiques. Pourquoi les économistes sont-ils unanimes et peu écoutés ? Exposé de la théorie des avantages
comparatifs de Ricardo [p118-123] au travers de l'exemple de deux produits et deux « pays » (resp pain/vin,
France/Monde) : à l'aide de cet exemple, B.S montre que l'économie internationale est un jeu à somme positive
où l'ouverture des frontières correspond à une hausse du niveau de vie de tous (mais il peut y avoir des réticences
de groupes particuliers qui ne possèdent pas de l'avantage relatif dans leur domaine). B.S assimile le commerce
international à une innovation technologique : transformer ce que l'on produit bien en ce que l'on a du mal à
produire ; mettre des obstacles aux frontières, c'est brider cette innovation. De plus, le libre échange augmente la
taille des marchés, donc les possibilités de développement des entreprises, donc entraîne une baisse des coûts de
production par économies d'échelle.
Pourquoi tant de voix en faveur de limitations ? 1° Vieilles idée mercantilistes que les exportations sont
bonnes et les importations mauvaises ; 2° les gagnants des mesures protectionnistes dans nos sociétés sont bien
organisés pour se faire entendre, même si bien moins nombreux que les perdants (argument politique) exemple :
en Europe, limitation pendant longtemps de la part des marché des voitures japonaises à 3%, les gagnants ont été
les groupes automobiles, mais les perdants la population qui a vu se maintenir le prix des voitures
artificiellement haut : selon des études, pour sauver les emplois dans le secteur automobile, il aurait mieux valu
en faire des fonctionnaires payés à ne rien faire (moins cher pour la population), de plus, la France n'a rien gagné

puisqu'il ne s'agissait pas de droits de douane mais de quotas. Le protectionnisme entraîne un coût en ressources
mobilisées à « mauvais » escient sur le territoire alors qu'on peut se procurer un produit ailleurs ; il entraîne un
coût pour les consommateurs qui renoncent à un produit ou doivent prendre une gamme en dessous. Les emplois
détruits ailleurs que dans le secteur protégé sont diffus, donc pas de mobilisation contre la protection. 3
arguments des défenseurs des barrières douanières : 1° un pays suffisamment puissant pour influer sur les prix
mondiaux gagne toujours à mettre un haut droit de douane sur ses importations : baisse de la demande => baisse
demande mondiale => baisse des prix => importations à bon prix pour le pays qui applique cette stratégie
(théoriquement accepté, mais cela ne peut être mis en pratique) ; 2° l'Etat identifie mieux les secteurs en
développement, et crée une protection pour que se développe un avantage comparatif (mais les fonctionnaires et
les hommes politiques sont-ils assez clairvoyants ? ; 3° dans les économies du tiers monde, les marchés sont trop
peu développés pour que les capitalistes financent les industries naissantes (mieux vaudrait passer par une
subvention à 'investissement et à la recherche). Début 1980's, un groupe d'économistes (dont Paul Krugman, prix
de la Banque de Suède 2008) prônait une « politique commerciale stratégique » (soutenir un secteur pour lui
assurer un développement mondial, comme par ex soutenir Airbus face à Boeing pour qu'il ait un monopole)
appuyée sur la théorie des jeux, mais qui après dix ans de débats a connu moins d'enthousiasme de la part de ses
promoteurs.
Il y a une nouvelle vigueur des attaques contre le libre échange avec la mondialisation (hausse des flux
de capitaux et de marchandises dans le monde). Les échanges se font principalement entre blocs (2/3 des
échanges des pays de l'UE se font inter-UE). Certes, les mécanismes de spécialisation entraînent une hausse des
inégalités dans les pays riches et pauvres, et entre ceux-ci ; mais pourtant aucun chiffre de vient confirmer une
hausse spectaculaire des inégalités ni en France ni dans le monde ; de plus, les pays pauvres d'Afrique
subsaharienne ne sont pas intégré pleinement dans la mondialisation, et les inégalités ont d'autres origines que le
libre échange (politiques par ex). Des enquêtes montrent que les travailleurs pour la mondialisation des pays
sous dvpés ont une meilleure situation que ceux qui travaillent pour le marché intérieur.
De nouvelles critiques viennent de la multiplication des crises financières depuis les 1990's. Quelle
responsabilité de la mondialisation libérale ? Cas de l'Argentine en 2001 [pp137-142]. De 1980 à 1990, baisse de
2%/an du niveau de vie, inflation à 4000% en 1989 ; 1990-1999, croissance du niveau de vie de 3%/an, peso
attaché au dollar US pour vaincre l'inflation, mais au cours de cette dernière période, creusement du déficit
bugétaire à plus de 3% du PIB. L'Argentine ayant eu un épisode économique désastreux, elle subit la méfiance
des investisseurs, et des taux d'intérêt pour ses emprunts de plus de 10%. Fin 1990's, la dette représente 50% du
PIB, elle est essentiellement à court terme et détenue par des investisseurs étrangers rémunérés en dollars qu'il
est nécessaire de garder en confiance. Seulement, en 1999, le Brésil principal partenaire commercial de
l'Argentine fait flotter sa monnaie, le prix de ses produits baisse donc le déficit commercial de l'Argentine se
creuse ; au même moment, le cours du dollar s'est apprécié, donc celui du peso. Avec les ventes de peso (pour
acheter au Brésil) > achats, le cours a été attaqué, mais le gouvernement a essayé de maintenir la parité : s'en est
suivi une récession, qui a inquiété les investisseurs étrangers qui ont demandé des taux d'intérêts plus forts pour
la dette (crise de soutenabilité en vue). Tx intérêt : 15% ; tx croissance : 0% ; impossible de convertir de déficit
budgétaire en excédant en période de récession. Printemps 2001, retrait massif des économies des particuliers de
banques. Fin 2001, restriction aux retraits bancaires, gouvernement en banqueroute, fin de la parité peso/dollar,
dépréciation de 2/3 du peso, baisse de 20% du PIB
Quelle part de responsabilité pour la mondialisation libérale ? Peut-être la libéralisation trop rapide des
capitaux pour un pays « suspect ». Quelles solutions ? Indexer les taux d'intérêts des emprunts sur les taux de
croissance du pays (ce qu'a fait la Citybank pour la Bulgarie)
Chapitre 8 : La politique agricole commune
PAC = moitié du budget de l'UE, agriculture = 1 emploi sur 20. Les « vicissitudes » de la PAC illustrent
les arguments de la première partie. But de la démonstration : montrer comment chaque moyen de contourner le
marché conduit à des déséquilibres qui demandent des nouvelles mesures, et ainsi de suite. Principaux
mécanismes de la PAC : aides aux producteurs ; tarif douanier commun ; prix garanti aux producteurs. Le
progrès technique a fait apparaître d'énormes surplus qui ont été exportés, mais comme l'Europe produit à coûts
élevés, il faut ds subventions à l'exportation pour corriger les écarts avec le prix mondial, qui isolent l'Europe des

fluctuations liées à l'offre et à la demande. Depuis les réformes de 1992 et 2003, ces subventions sont
conditionnées par la mise en jachère de certaines terres, et par le respect de normes environnementales et de
santé pour limiter leur effet. Conséquence : les prix payés aux agriculteurs européens sont en moyenne
supérieurs de 10% aux prix mondiaux. Ces prix hauts se répercutent sur les consommateurs ; chaque citoyen
paye 200€/an pour la PAC, les ¾ en impôts, ¼ en perte de pouvoir d'achat. Certes, la PAC est justifiée par
l'indépendance alimentaire, mais celle-ci supposerait de produire également tout ce qui est lié à la production
agricole. Avec un excédent commercial de l'agriculture de 0,1 à 0,2% du PIB, cela ne justifie pas la PAC. Pas
plus que l'argument du soutien aux agriculteurs pauvres : ¾ des subventions vont aux 25% des agriculteurs les
plus riches. Et s'il faut aider les paysans, pourquoi par les sidérurgistes et à l'époque de la création, les mineurs ?
La moitié de la PAC va à la hausse des revenus des paysans, l'autre contribue à hausser la demande de biens
d'équipements et de terres par la hausse de la production, et donc défavorise ceux qui veulent s'installer. S'ajoute
à cela que la PAC est « payée » par les pays sous-développés fortement agricoles qui ne peuvent atteindre le
marché européen., ce coût est trois fois supérieur à l'aide au développement qui leur est accorde (aux USA, les
subventions aux 25000 « rois du coton » représentent trois fois l'aide américaine à l'Afrique, pour conserver
40% des parts de marché mondiale qui tomberaient à 10% avec le jeu de la concurrence). Il y a eu des tentatives
pour baisser l'action de la PAC, mais une fois encore les « gagnants » se font plus entendre que les « perdants »
(qui pour les pays sous-dvpés n'ont pas le droit de vote en Europe).
Chapitre 9 : la redistribution
Le libre jeu du marché n'assure par nécessairement une baisse des inégalités. D'où la nécessité d'un
système complexe de redistribution par les impôts. Ils ne pèsent que sur les ménages dès lors que l'on considère
une entreprise comme un agglomérat de ménages ; l'impôt sur le revenu ne représente que 7% des prélèvements
obigatoires, et 90% des foyers fiscaux lui consacrent moins de 10% de leur revenu, de plus seule la moitié des
ménages le paye. 60% des ménages bénéficient d'au moins un transfert (80% si on compte les retraites). La
redistribution accroît de 70% le revenu net du quintile Q1 de la population, et prélèvent 15% du revenu de Q5.
On ne naît pas égaux en capacité face à la vie économique. Faut-il pour autant adopter la solution
communiste de l'égalité parfaite ? le PIB français divisé en 65 millions de part donnerait environ un revenu de 30
000€/an/personne. Mais comme travailler et pénible, on ne le fait que contre rémunération : si personne n'est
rémunéré, personne ne travaille, donc le PIB baisse à 0. Solution de John Rawls : les inégalités économiques ne
doivent être tolérées que si elles bénéficient aux plus pauvres en incitant les plus riches à travailler pour
augmenter la richesse. Le taux optimal d'imposition selon Rawls se trouve au sommet du U de la courbe de
Laffer. Aux États-Unis, en 1980, les républicains pensaient que le sommet avait été dépassé. En France, même
idée à droite, ce que conteste une étude de Thomas Picketty, même si on est proche du sommet du U inversé.
L'impôt sur les successions rapporte 6 milliars d'euros/an, soit moins de 0,4% du PIB, mais on en parle
moins que de l'ISF qui rapporte trois fois moins. Avec un acquittement pour les enfants qui se fait à partir de
156000€ et un héritage moyen de 35000€, peu de ménages paient cet impôt. Ne serait-il pas plus éthique de
l'augmenter que d'augmenter l'ISF puisqu'il est lié au hasard de la naissance ? Peut-être, mais cela reviendrait à
taxer une deuxième fois les revenus du travail, et à défavoriser l'épargne. Les héritages ne devraient donc pas
être taxés du tout. Mais il n'est pas certain que les héritages soient le seul fait d'une solidarité intergénérationelle,
on peut donc trouver des arguments en faveur d'une plus forte taxation.
Chapitre 10 : Le chômage structurel
Ce chapitre s'intéresse à une liste de causes non exhaustives du chômage structurel. 1° le processus de
destruction créatrice (cf chap 4) : 15% des emplois du privé sont détruits et 15% créés bon an mal an (solde à
+2,5% en 2000, légèrement négatif en 1993) ; on parle de chômage frictionnel, mais celui-ci n'explique par le
chômage conjoncturel à lui seul. 2° Le non emploi volontaire : poursuite d'études et préretraites, mères au foyer
(encouragée par l'allocation parentale d'éducation substantielle, au départ à partir du 3eme enfant, ramenée au
2eme enfant en 1994), anciennement désincitation à travailler du RMI pour les cas de salaires trop proches de
l'allocation qui a conduit à la mise en place du RSA.
Le salaire minimum et les charges sociales créent également une exclusion des travailleurs les moins
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%