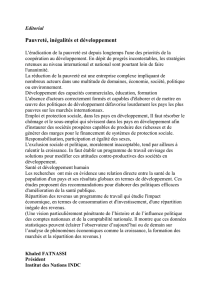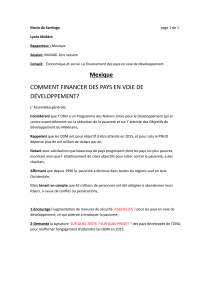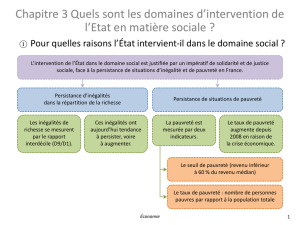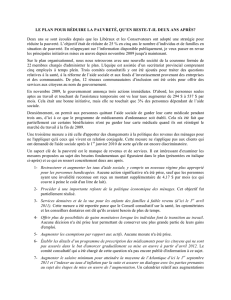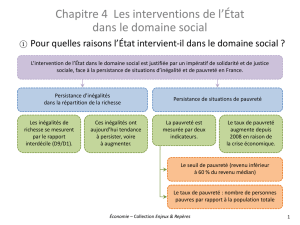Intégration et solidarité

1
Intégration et solidarités
Objectifs :
L’objectif de ce chapitre est de montrer comment les instances d’intégration que sont le travail,
l’école et la famille permettent d’intégrer l’ensemble des individus à la société ; ensuite, que ces ins-
tances connaissent sous une forme ou sous une autre, une « crise » qui remet en cause leur capacité inté-
grative. Ce chapitre permet aussi de montrer comment les sociétés recomposent sans cesse le lien social.
L’objectif de ce chapitre est aussi de montrer comment l’Etat, et notamment l’Etat providence, par
ses fonctions de protection et de redistribution, est une instance d’intégration des individus à la société.
Cependant, l’Etat providence connaît une triple crise qui le fragilise au moment même où il est confronté
aux nouveaux enjeux que sont le vieillissement de la population et l’exclusion croissante d’une partie de
la population.
Plan :
Introduction.
I. La cohésion sociale et les instances d’intégration.
A. L’intégration sociale et les formes de solidarité.
B. Les principales instances d’intégration.
C. La crise du lien social.
II. La protection sociale et les solidarités collectives.
A. Le développement de l’Etat providence.
B. La crise de l’Etat providence.
C. Deux exemples de solidarité collective : la protection contre la pauvreté et l’assurance vieillesse.
Vocabulaire :
Anomie ; déviance ; exclusion ; individualisme ; intégration ; lien social ; pauvreté ; socialisation ; solida-
rité mécanique / organique.
Assurance / assistance ; Etat providence ; redistribution ; risques sociaux ; universalisme / communauta-
risme.

2
Introduction.
Il s’agit dans ce chapitre de s’interroger sur les fondements du lien social qui assure la solidarité
entre les membres d’une société. La cohésion sociale n’est pas spontanée mais est le résultat de ce qu’on
appelle l’intégration sociale – processus par lequel un individu devient membre d’un groupe social ; être
intégré à un groupe c’est intérioriser les normes sociales et les valeurs de celui-ci et acquérir un statut
social spécifique. L’intégration signifie que chacun a vis à vis des autres des obligations mais aussi des
droits. Cette intégration se construit dans des lieux spécifiques (famille, école…) ou à l’aide de dispositifs
(protection sociale). C’est par la socialisation que les individus vont partager les mêmes valeurs.
Mais la transformation des valeurs, les changements dans la vie économique et sociale affectent
ces lieux d’intégration et ces dispositifs.
Au XXème siècle, dans les sociétés industrialisées, la cohésion sociale a été renforcée par la mise
en place de systèmes de protection sociale. Ces systèmes ont débouché sur une véritable solidarité collec-
tive face aux aléas économiques et sociaux. Cette protection sociale a aussi un impact sur le fonctionne-
ment économique et social de la société.
I. La cohésion sociale et les instances d’intégration.
Il faut tout d’abord définir ce que signifie l’intégration sociale puis étudier les instances
d’intégration et enfin s’interroger sur la crise du lien social c'est-à-dire repérer les signes et dégager les
causes d’un éventuel affaiblissement du lien social dans la société contemporaine.
A. Intégration sociale formes de solidarité.
1. L’intégration sociale :
Elle désigne, au cours du processus de socialisation, l’acquisition et l’intégration des normes et
des valeurs dominantes.
Pour Emile Durkheim, une société est d’autant plus intégrée que la densité matérielle – synonyme
de densité démographique et son accroissement entraîne la nécessité d’une division du travail accrue – et
la densité morale – relations plus ou moins intenses et diversifiées entre les individus au sein d’une socié-
té – y sont fortes. Plus il y a de relations où « la conscience collective fait sentir son action », plus il se
crée « de liens qui attachent l’individu au groupe ».
Philippe Besnard, dans son étude de l’anomie – affaiblissement voire absence de règles dans une
société et plus généralement, déficit de régulation -, présente les trois caractéristiques qui assurent
l’intégration des individus à un groupe social :
- Les individus doivent posséder une conscience commune et partager les mêmes sentiments,
croyances et pratiques.
- Ils doivent être en interaction les uns avec les autres. L’intégration passe par une coordination
des actions individuelles, par une délimitation de ce que chacun peut faire ou ne doit pas faire.
- Enfin, ils doivent partager des buts communs.
Ainsi, l’intégration sociale amène les individus à avoir une place dans la société. L’individu est
« bien » intégré lorsque, grâce au processus de socialisation, il a acquis cette culture commune et par-
tage les buts que la société s’est fixée.
2. Les formes de solidarité :
Emile Durkheim a procédé à une analyse approfondie des sociétés qu’il a classées en deux caté-
gories majeures :
- Les sociétés primitives ou sociétés inférieures.
- Les sociétés complexes ou sociétés plus élevées.

3
Les sociétés primitives :
Ce sont des sociétés où l’individu n’a que très peu d’importance, l’origine constitutive du groupe
détermine le quotidien et l’ensemble des règles nécessaires à l’ordre social. Dans ces sociétés règnent
une solidarité mécanique.
L’organisation de la vie du groupe dans ces sociétés repose essentiellement sur le culte des an-
cêtres, sur le poids d’un passé commun sur l’impact des croyances. L’engagement des membres du
groupe dans l’entretien des rites et des pratiques considérées comme la seule réalité dominent et structu-
rent ces sociétés.
Les normes ou les règles dictant l’attitude à adopter en groupe, ne laissent que très peu de place à
l’interprétation ou à l’innovation individuelle. La société se structure à partir de la reproduction de ce
qui a toujours été. Les traditions, les coutumes s’imposent de manière immuable et garantissent
l’équilibre social.
Ces sociétés ne peuvent se maintenir qu’en refusant toute possibilité de changement ou d’écart
par rapport à la norme. Les sanctions y sont donc très sévères et visent surtout à maintenir en l’état une
société qui a toujours existé ainsi. La nature du droit sera donc répressive. L’objectif étant de sauvegar-
der coûte que coûte les traditions et les valeurs perçues comme universelles. La conscience collective
assure l’intégration de chaque individu à la société qui est la sienne et en garantit la stabilité par le con-
trôle social qu’elle exerce au quotidien en veillant au bon respect des normes et des valeurs.
Cette forme de solidarité permet la stabilité sociale, l’harmonie sociale et une forme d’inertie
sociale ; les sociétés se reproduisant à l’identique.
L’individu n’existe donc pas et se fond dans le groupe pour éviter le risque d’être châtié ou
d’expier.
Selon Durkheim, ces sociétés sont amenées à disparaître progressivement au profit de
l’émergence et de la généralisation des sociétés à structure organisée, définies par la division du travail.
Les sociétés complexes :
Ces sociétés naissent de la division du travail, accordent à l’individu davantage d’autonomie et
elles sont toujours en pleine évolution. Elles succèdent aux sociétés primitives.
La division du travail implique la diversification des activités et de fait favorise l’échange des
compétences. L’individu devient autonome tout en étant lié à d’autres car seul il ne peut survivre. Ces
sociétés consacrent donc la spécialisation des statuts et des rôles et favorisent l’individualisme. Les per-
sonnalités individuelles émergent mais dans le respect des sphères d’activités qui sont le cadre structu-
rant toutes les activités sociales
La division du travail en différenciant les activités individuelles rend l’ensemble encore plus co-
hérent qu’autrefois en les rapprochant et en faisant converger les unes vers les autres chacune des activi-
tés. Elle crée donc un lien indestructible et beaucoup plus fort que celui créé par les similitudes, car in-
dispensable. La conscience collective du fait de la possibilité d’innovations individuelles perd de son im-
portance, elle décline au fur et à mesure que la division du travail progresse. L’individu plus rationnel ne
se soumet plus à un ensemble de croyances et de pratiques indiscutables. Les croyances ne disparaissent
pas pour autant mais évoluent et se transforment avec l’évolution et la transformation des rapports entre
les individus.
L’ordre social est garanti non plus par les châtiments sanctionnant les crimes mais par le souci de
réparation du désordre occasionné. Le droit devient alors restitutif c'est-à-dire qu’il vise avant tout à
remettre en l’état initial l’organisation qui a été provisoirement perturbée par un délit. Chaque individu
ayant un rôle important pour la société ne peut être violemment sanctionné lorsqu’il s’est éloigné de la
norme.
Cette solidarité reposant sur la division du travail et spécialisation des activités individuelles est
qualifiée par Durkheim d’organique. « Les sociétés les moins avancées avaient pour objectif essentiel de
créer ou de maintenir une vie commune la plus intense possible, les sociétés les plus avancées ont pour
idéal la justice et l’équité ».
Il faut aussi souligner que Durkheim prend aussi l’exemple du couple pour illustrer la solidarité
organique. La « société conjugale » est marquée par une « division sexuelle » c'est-à-dire un partage des

4
tâches et des rôles entre hommes et femmes : partage des tâches domestiques, partage des rôles dans
l’éducation des enfants, différenciation entre celui qui a un emploi et celui qui reste à la maison… Cer-
tains expliquent la fragilisation des couples (montée des divorces) par l’atténuation de la division du tra-
vail entre hommes et femmes qui réduit leur complémentarité et donc leur solidarité.
Remarque : Il est possible d’identifier des phénomènes de solidarité mécanique dans les sociétés mo-
dernes. Par exemple, on peut trouver des solidarités de type mécanique dans les « groupes de pairs », où
la pression pour une certaine unité des modes de vie (vêtements, loisirs, opinions…), voire une certaine
uniformité, peut être très forte.
A. Les principales instances d’intégration.
Dans le programme de 1 ES, nous avons vu comment les instances de socialisation, institutions ou
groupes, transmettaient la culture de la société, ses normes et ses valeurs. Ici, il ne s’agit pas de revenir
sur la manière dont ces instances construisent l’individu en le socialisant mais comment cette construc-
tion produit de la solidarité entre les individus.
1. La famille :
Elle joue un rôle essentiel dans la socialisation primaire des individus puisque elle contribue en
premier à la transmission des normes et des valeurs en vigueur dans la société. Cependant, la famille est
aussi un réseau d’entraide et de solidarité contribuant à la cohésion sociale.
La famille transmet les valeurs et les normes en vigueur dans la société. Il faut ici revoir le méca-
nisme de la socialisation familiale vu en 1 ES. La famille transmet notamment le langage, les mœurs, la
culture, les rôles sociaux…Cette transmission est essentielle pour s’intégrer dans la société. Ainsi, la
transmission de la langue est fondamentale car elle permet d’entrer en relation avec autrui.
La famille est un lieu d’activités communes. Il existe à l’intérieur de la famille un partage des
tâches et donc une organisation des rôles sociaux (préparation des repas, tâches ménagères…). Cer-
taines activités permettent de tisser des liens sociaux ; par exemple, les loisirs. Enfin, il faut souligner que
la famille est encore, dans le cas des indépendants, un lieu d’activité économique.
La famille constitue un réseau de solidarité. Il existe entre les membres de la famille un ensemble
de droits et d’obligations réciproques. Des échanges de services et des transferts financiers ont lieu entre
parents et enfants, grands-parents et petits-enfants… La famille est un « échelon intermédiaire » entre la
société et l’individu permettant à celui-ci de s’insérer dans un tissu de relations de proximité. La famille
est un lieu où la solidarité prend une dimension concrète. En cas de difficultés, la famille reste souvent le
premier recours ; c’est aussi un recours pour organiser sa vie matérielle ; par exemple, la garde des en-
fants par les grands-parents.
2. L’école :
Elle transmet une culture et des valeurs partagées et rend possible l’intégration professionnelle.
Elle joue un rôle important dans l’intégration sociale des membres de la société.
Le rôle traditionnel de l’école : la transmission d’une culture commune. En 1 ES, nous avons vu
que les lois de Jules Ferry avaient contribué à la construction de la nation française. L’école a imposé la
langue française au détriment des langues régionales – la langue est un élément essentiel de la culture
d’une société – et elle a valorisé la science et la raison, l’idée d’une culture universelle dépassant les
particularismes religieux. Elle a diffusé tout un ensemble de valeurs patriotiques (les grandes dates de
l’histoire de France, la Révolution française, les « grands hommes »…). Ainsi, les enfants ayant suivi la
scolarité ont une langue, des références culturelles et des racines historiques communes, quelle que soit
leur origine sociale, régionale, religieuse ou ethnique. L’école contribue donc bien à l’intégration des
individus.
La préparation à la vie active. L’école prépare à l’entrée dans le monde du travail en donnant des
qualifications et en les validant par des diplômes. L’école a une fonction intégratrice. En effet, le di-

5
plôme, c’est la reconnaissance de capacités et donc une sorte d’ « utilité sociale », mais c’est aussi le
début de l’appartenance à un monde professionnel.
La construction des individus. L’école doit permettre à l’enfant de développer sa personnalité, de
s’épanouir et donc de construire une identité personnelle. Cette construction ne s’oppose à l’intégration
sociale dans la mesure où, comme le souligne E. Durkheim, l’individu se construit par opposition avec
les autres et plus généralement dans l’interaction avec les autres permettant ainsi à celui-ci d’affirmer sa
personnalité propre.
3. Le travail :
Le travail est un facteur essentiel de l’intégration dans la mesuré où il donne une identité profes-
sionnelle, un revenu et des droits sociaux.
Le travail permet de se construire une identité professionnelle. La division du travail permet à
chacun d’appartenir à un niveau intermédiaire entre la société et l’individu : la profession, la catégorie
sociale… Le travail permet de partager avec d’autres exerçant une même profession une situation éco-
nomique et sociale identique ou proche mais il permet aussi de se distinguer d’autres personnes exerçant
un métier différent. Il se constitue donc des groupes différenciés avec chacun des valeurs, des références
spécifiques. L’intégration de l’individu passe donc par un double mouvement de différenciation et
d’assimilation. L’identification à autrui nous rattache à la société et fait exister le collectif alors que la
différenciation nous donne une place dans ce collectif.
Le travail assure un revenu et la participation à la société de consommation. Le travailleur joue
un rôle intégrateur dans la mesure où le travail procure un revenu qui est une reconnaissance sociale de
l’utilité sociale du travail accompli. Mais le revenu permet aussi à l’individu de consommer les biens et
services valorisés par la société, et donc de s’y faire reconnaître. La consommation ne permet pas seule-
ment de satisfaire nos besoins mais elle permet aussi de nous donner un certain statut social.
Le travail assure des droits sociaux. Les droits sociaux sont des prestations sociales constitutives
de l’Etat providence (exemple : indemnisation pour les salariés se retrouvant au chômage). Ces droits
sociaux matérialisent la solidarité entre les individus, et plus encore l’appartenance à la société.
Le travail est donc un élément important de l’intégration sociale dans la mesure où il permet à
l’individu d’acquérir un statut social, de disposer de revenus et d’accéder à des droits et des garanties
sociales.
4. La citoyenneté :
Les individus sont reconnus comme membres de la nation, disposant de droits et de devoirs iden-
tiques. La citoyenneté est d’abord politique. Elle implique une participation à la prise des décisions. Ces
décisions sont celles qui concernent la vie en société et en particulier la façon de régler les conflits se
produisant entre les membres de la société.
La citoyenneté est intégratrice dans une société démocratique dans la mesure où chaque citoyen
dispose des mêmes droits et devoirs que les autres et peut les exercer concrètement. C’est cette égalité
entre les individus et l’implication dans le gouvernement de la société qui est intégrateur. La nation in-
tègre les individus constituant la société au-delà de leurs différences religieuses, ethniques ou de genre.
C. La crise du lien social.
Différentes évolutions, au cours du XXème siècle, ont provoqué une crise du lien social :
L’organisation du travail et en conséquence les relations sociales se sont transformées. Ces trans-
formations ont modifié la fonction intégratrice du travail.
Un changement social, une évolution socioculturelle de notre société – montée de
l’individualisme, pauvreté, revendications identitaires… – a provoqué une remise en cause des instances
d’intégration.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%