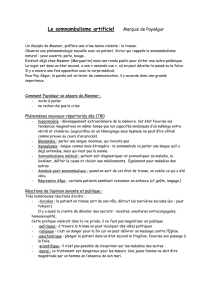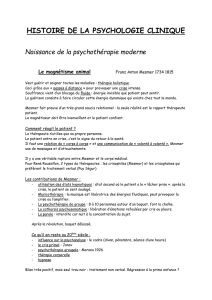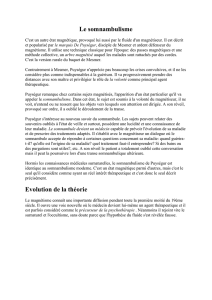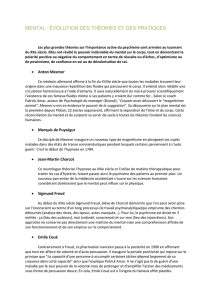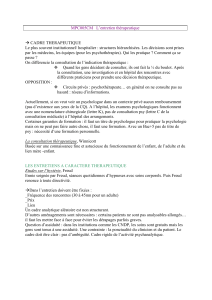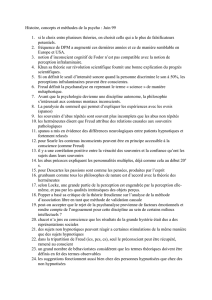95. Entretien à Caen. À propos de Anatomie de la troisième personne

Guy LE GAUFEY
LE FLUIDE DE LA TROISIEME PERSONNE
Les rapports du psychanalyste et du pouvoir d’État ont une longue histoire, et quelle que soit la
forme que cela a pu prendre au fil du temps – soit la crainte anxieuse des psychanalystes qu’on les
enrégimente dans des sécurités sociales ou autres, ou qu’on leur fasse payer la TVA etc. bien des
choses pouvaient certes, parfois, aller dans ce sens, mais au long de ces années, je ne voyais pas
comment on pouvait avancer dans cette affaire si l’on n’étudiait pas de plus près le fait que, ou bien on
oubliait la spécificité de la psychanalyse, ou bien on oubliait celle de l’État. La question centrale dans
les deux cas – j’ai essayé d’en faire titre – m’est apparue alors comme étant celle de la Troisième
personne. Je vais distinguer dans mon exposé un premier temps pour essayer d’esquisser la posture
de ce cette Troisième personne, d’abord au sens grammatical du terme dans l’affaire analytique, et
plus spécialement dans le transfert, et par ailleurs je suivrai quelques-unes des pistes qui positionnent
à cet égard l’État moderne, cette vaste entité pas tout à fait incernable tout de même qu’on appelle
l’État moderne, toujours dans ce registre de la Troisième personne. C’est aux confluents de ces deux
entités que nous rencontrerons Mesmer…
Du côté de la psychanalyse et du transfert, il y a quelques phrases-phares, par exemple dans le
texte de Freud « La question de l’analyse profane ». Dès la première page, il écrit : « La situation
analytique ne souffre pas de tiers ». Freud remarque à ce propos que si quelqu’un assistait dans cette
posture à une séance, il s’ennuierait à mourir. La question n’est donc pas exactement d’introduire un
tiers, même derrière des glaces sans teint ou dans une procédure plus ou moins scientifique, mais
d’aller pister le tiers sous des formes beaucoup plus subtiles. Par exemple, pour en rester aux citations
chez Freud qui sont capables de faire repérage à ce sujet, si vous vous portez à la fin du 1er sous-
chapitre du chapitre VII de L’interprétation des rêves, vous le voyez tout à coup se mettre à employer
un des termes qu’il est alors en train de forger, dans ces années 1900, celui de représentation-but.
C’est une façon de parler, de mettre en scène ce qu’il appelle déjà la règle fondamentale : « Dites ce
qui vous vient à l’esprit ». Une autre des façons de la décrire serait aussi bien : « Pendant le temps de
la séance, vous suspendrez toute représentation-but ». Vous parlerez sans vous diriger obstinément –
comme je le fais moi-même à l’heure actuelle – vers une représentation-but : j’essaie en effet de vous
convaincre, et je vais m’y employer d’un certain nombre de façons. Freud poursuit alors : à ce patient,
je lui demande de ne pas réfléchir et de me dire tout ce qui lui passe par la tête, et je pose en principe

Entretien, p. 2
(ceci est clairement une hypothèse) qu’il ne peut pas laisser s’en aller les représentations-but du
traitement – en d’autres termes, se dit Freud, j’espère qu’il ne va pas oublier, qu’elle ne va pas oublier
que tout çà est un traitement. Précaution subtile concernant l’avenir du transfert… Je reprends
maintenant la citation : « et je considère que je dois trouver un rapport entre les choses en apparence
les plus innocentes et les plus fortuites qu’il pourra me dire de son état. Il y a une autre représentation-
but que le patient ne soupçonne pas », poursuit Freud, et je vous l’a dit en allemand : «. ist die meiner
Person. » A cet endroit, les traducteurs s’arrachent un peu les cheveux : en français, c’est toujours
soft, : « c’est la personne de son médecin ». Freud n’a pas dit cela, il a dit très littéralement, avec un
allemand très simple : « c’est celle de ma personne », « one relating to myself » traduit plus justement
Strachey en anglais. Mais entre myself et my self, il y a de la distance. Freud n’est pas en train de
parler de lui-même, il est en train de parler de sa personne. Il est en train de dire que justement, il est
là à deux titres : Il est celui qui met en œuvre la cure, celui à qui le patient aussi s’adresse, qui va
interpréter, qui va dire des choses, et puis il y a cette meiner Person, sa personne qui va venir jouer
son rôle. En cette phrase, Freud signale qu’il ne se prend pas entièrement pour cette meiner Person,
qu’il est tout de même aussi. Vous voyez à partir de là se mettre en scène toute la difficulté vis-à-vis du
tiers dans l’affaire analytique. Le fait qu’il n’y ait pas de troisième personne au sens banal du terme, ne
veut pas dire pour autant qu’il n’y en a que deux. La « two body psychology », comme le disait Balint et
d’autres, n’est pas exactement ce qui est en jeu dans la psychanalyse. J’aime à penser plutôt que l’on
est deux… et des poussières : parce qu’on n’est ni trois, ni deux non plus.
La position du tiers semble bien être ainsi une donnée de départ dans l’affaire analytique. Elle
est assez complexe à apprécier parce qu’il n’est pas sans être là, ce tiers, et en même temps, sans
même se concerter, les analystes de toutes les Écoles, les analystes freudiens, se débrouillent pour
qu’il n’y ait pas de tiers trop incarné. C’est là une des différences importantes à mes yeux avec ce qu’il
en est de la thérapeutique. L’analyse n’est pas sans être une thérapeutique, mais elle ne peut pas s’y
réduire. C’est une des chausse-trappes habituelles des discussions à propos des rapports entre
l’analyse et le pouvoir d’État. Très régulièrement, arrive un moment, c’est déjà le cas dans le texte de
Freud de la « Laïenanalyse » où le représentant de l’État, qui est un brave bougre, qui ne cherche pas
de complication, finit par dire : à la fin des fins, est-ce que c’est une thérapeutique ou non ? Et Freud
de répondre : c’est plus compliqué, ç’en est, bien sûr, mais çà n’en est pas, ça ne peut pas s’y
réduire… Or je vous ferai remarquer que sur la question du tiers justement, une thérapeutique, qu’elle
soit couronnée de succès ou pas, est une chose où il y a un tiers même quand çà se fait à deux : il y a
au moins un objectif en commun, et ça suffit à constituer un tiers particulièrement solide. Quand nous
allons voir un médecin, on ne passe pas nécessairement un « contrat » thérapeutique, mais on
imagine qu’il a un objectif : votre santé, et vous, vous avez le même – on est bien d’accord là dessus.
Si vous êtes allé voir un analyste, de quelque bord qu’il soit, j’aime à croire qu’il vous a dit : « oui…
oui… », mais qu’il ne vous a pas dit à tel ou tel moment : « Écoutez, on va faire une analyse au terme
de laquelle tel et tel symptôme sera amené à disparaître » – et ce n’est pas simple prudence technique

Entretien, p. 3
de sa part s’il ne dit pas cela. C’est qu’instinctivement, tout naturellement, pour ménager la chance du
transfert, il va se débrouiller pour que cette place du tiers reste inoccupée. Qu’à aucun moment, le
patient ou la patiente ne puisse se retourner en disant : « alors ! ça vient cet objectif ! ». Certes, cette
réflexion viendra un jour ou l’autre, mais l’analyste ne se sentira pas pour autant coincé dans le
contrat ; il n’a pas opiné sur l’existence concertée d’un tiers en commun, serait-ce sous la forme d’un
objectif à atteindre. Il a maintenu cela en suspens, sans même y réfléchir. Voilà un point à mon avis
qu’il ne faut pas perdre de vue quand on va, par la suite, discuter des rapports de l’analyste et du
pouvoir d’État. Car en anticipant sur ce que je vais développer, le pouvoir d’État – qui est quelque
chose de très intelligent et de très futé – il y a au moins une chose qu’il a beaucoup de mal à
comprendre, c’est qu’on fasse des trucs sans savoir où on va. On peut vouloir faire des crimes, mais
mettre en œuvre des procédés et des procédures dont on soutient qu’on ne sait pas où cela conduit,
ça, ça le dépasse…
J’espère vous avoir, sinon convaincu, du moins avoir attiré votre attention sur ce qu’il en est
possiblement du tiers dans l’affaire analytique. Je pourrais, avec un peu plus de temps, vous
convaincre que chez Jacques Lacan, c’est à peu près la même chose que chez Freud de ce point de
vue-là, et que l’invention du sujet-supposé-savoir a la même fonction de pointer un tiers qui a
assurément les plus étroits rapports avec l’analyste, mais vis à vis duquel l’analyste est vraiment prié
de ne pas s’y croire. Donc, il y a du tiers qui n’arrive pas à advenir… et c’est exactement comme ça
que ça marche.
Si vous m’accordez ce point, maintenant, il faut nous tourner vers une toute autre affaire, qui est
celle du pouvoir d’État. La question est trop énorme pour que je prétendre y répondre à la légère, elle
fait suite à une affaire qui m’a toujours passionné, qui a fait l’objet d’un livre traduit depuis maintenant
une dizaine d’années en français : « Les deux corps du Roi » d’Emile Kantorowicz. Livre monument,
publié en 1957, qui développe une théorie médiévale de la royauté qui commence grosso modo au
XIVe siècle, et qui s’effondre en France en un seul jour, le jour où Henri IV est assassiné. Je vais
bientôt vous dire pourquoi elle s’est ainsi effondrée.
Qu’elle est-elle, cette théorie ? Elle est complexe, assez fuligineuse, longue à se mettre en
place, et nous croyons tous la connaître à travers cette phrase banale : « le Roi est mort, vive le Roi »
C’est hélas beaucoup plus compliqué, mais cela consiste à dire que le roi a deux corps. Un premier
corps comme tout le monde, un corps qui a trois qualités essentielles : il peut être malade, il peut être
fou et il peut mourir, trois qualités… comme vous et moi ! Et puis il en a un autre qui, lui, ne peut
pas être malade, ne peut pas être fou et ne peut pas mourir. Les rapports entre les deux, c’est bien sûr
le pot-au-noir de cette théorie à la fois juridique et théologique extrêmement complexe. Ce qui
d’emblée m’a beaucoup intéressé dans cette affaire de la théorie des deux corps du Roi, c’est que

Entretien, p. 4
j’imaginais – selon les voies d’une analogie assez fumeuse au départ – que bien qu’il ne fût Roi de
rien du tout, l’analyste avait un peu cette allure là : en même temps, il est là avec son inconscient, ses
faiblesses, personne n’en doute, il est en général pas mal à côté de la plaque ; et puis en même
temps, il est ce sujet-supposé-savoir, cet objet du transfert, ce personnage merveilleux, et plus il serait
porté à s’excuser de ne pas être cela, plus il le sera. (L’un des bons mots de Françoise Dolto fut de
déclarer : « Oh mais vous savez, moi, je ne suis pas le sujet supposé savoir ». Inutile de dire qu’elle
l’est devenue à un point qu’elle n’imaginait pas). C’est assez vicieux, on ne s’en sort pas en disant :
moi vous savez, je ne mange pas de ce pain là. Non, on est coincé dans cette affaire où est à l’œuvre
ce genre de tiers dont je pressentais obscurément que les deux corps du Roi lui apportaient à leur
façon une certaine lumière, et en même temps beaucoup d’ombres.
Que s’est-il donc passé avec l’assassinat d’Henri IV ? Lorsqu’Henri IV se fait assassiner par
Ravaillac, la situation politique est devenue calme. Les conflits religieux qui ont précédé son
installation se sont étouffés et en plus, on a prévu de couronner la Reine aussi, c’est dire qu’elle a
toute sa confiance. Ils ont eu des enfants dont le petit Louis qui a alors 8 ans. Henri IV meurt et à ce
moment là, Marie de Médicis fait quelque chose d’inouï : le lendemain du meurtre, elle convoque le
Parlement dans une séance qui s’appelle un « lit de Justice » et à ce Parlement, elle lui fait reconnaître
le petit Louis comme futur roi, moyennant quoi, elle prend la régence. Or, il y a là une erreur de
logique. Il faut savoir qu’en ce temps-là, le Parlement était la Chambre d’enregistrement des lois,
l’instance juridique du pays. Ce parlement avait été reconnu, lui par Henri IV, donc il tenait ses
pouvoirs du défunt. Une fois celui-ci disparu, le Parlement n’avait tout simplement plus de pouvoir
légitime… Il n’était donc pas du tout à même de reconnaître quiconque. Une séance de « lit de
Justice », vieille invention qu’on date plus ou moins de St Louis, avait lieu quand le Roi promulguait
une loi et que son Parlement, pour diverses raisons, se refusait à l’inscrire. A ce moment là, le Roi
avait deux possibilités : la première était de ranger sa loi et d’attendre des meilleurs jours ; la seconde,
c’était de convoquer un « lit de justice », c’est-à-dire de convoquer tous les membres de ce Parlement
en Habits en cérémonie, d’y venir lui-même en Corps (en habits de cérémonie bien spéciale) et à ce
moment-là de dire à haute et intelligible voix qu’il maintenait sa loi. Et le Parlement n’avait plus qu’à
obéir. Il y avait là un rapport d’autorité franche, une façon de régler les disputes entre l’exécutif et le
législatif. Or le petit Louis, en cette circonstance, n’était pas Roi, il était sûrement l’héritier présomptif,
mais pas le Roi, et donc le Parlement n’avait à lui seul aucun pouvoir de le « reconnaître ». C’était aux
Rois à reconnaître les Parlements, et pas l’inverse, jusque-là.
Un des signes du fait que cette théorie des deux corps du Roi avait vécu, c’est que auparavant,
lorsque le Roi mourrait, on s’empressait de faire une effigie du Roi. Voir là-dessus l’excellent ouvrage
de Ralph Gisey « le Roi ne meurt jamais », récit de l’enterrement de François 1er, l’enterrement le plus
réussi de tous les enterrements royaux de la Royauté Française parce qu’il est mort en période de
calme politique, lui aussi, et qu’ils ont eu un mois pour préparer l’enterrement… Chaque régiment,

Entretien, p. 5
chaque personne qui tenait son pouvoir de François 1er est allé rendre son bâton, à St Denis, devant le
cercueil et après, le Nouveau Roi, bien plus tard à Reims les leur a redonnés, mais chacun se
dessaisissait du pouvoir qu’il n’avait plus du fait de la mort du Roi, et qu’il n’avait tenu que de Lui. A ce
moment là, au moment du décès d’Henri IV, la chose tourne court à cause du Parlement lui-même qui
était très soucieux de la pérennité des charges puisque chacun de ses membres voulait a tout prix que
ses rejetons deviennent eux aussi membres du parlement sans avoir à racheter la charge. Il y avait
tout un trafic entre la Royauté et la Noblesse de Robe qui s’installait à ce moment-là. Ils furent donc
d’accord pour reconnaître un Roi qu’ils ne connaissaient pas comme tel, et à partir de là, les effigies,
c’est-à-dire la représentation post mortem du Roi, n’eut plus court. La dernière effigie que nous
possédions est celle d’Henri IV. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI iront comme le petit Louis XIII se faire
reconnaître par le Parlement et on ne construira plus d’effigie à leur mort.
Autant finir par une histoire drôle : Louis XIII, installé dans sa Royauté par un lit de Justice, fut
celui qui a tenu plus de lits de Justice que l’ensemble des Rois de France : il avait assurément des
comptes à régler avec cette instance qui l’avait intronisé alors qu’il ne demandait rien à personne.
Cette théorie des deux corps du Roi s’est donc effondrée à ce moment-là en France (la chose fut plus
complexe en Angleterre), et à travers la théorie dynastique des Bourbon, à travers Louis XIV, se
constitue, à l’endroit qui était auparavant ce deuxième corps du roi absolument pérenne, se constitue
petit à petit cet État français qui, en 1789, va se libérer du premier corps du Roi. Louis XVI va le
comprendre à ses dépens… lire à ce sujet le livre d’Antoine Debecq sur le Corps de l’histoire, qui
pullule d’anecdotes et de réflexions pas anecdotiques du tout sur ce que c’est que la puissance des
métaphores dans l’histoire.
J’en viens maintenant assez brutalement à Mesmer. C’est en travaillant à ce sujet-là que mon
attention a été attirée par un fait, comme bien souvent plutôt minime. J’ai appris que la Société des
Membres de l’Harmonie (les mesmériens) de Bergerac s’était transformée en club des Jacobins sans
perdre un seul de ses membres, en 1793 : les mesmériens deviennent des jacobins : ce n’est pas
extraordinaire, mais quand même… que tous tournent ainsi leur veste d’un seul mouvement… A partir
de là, je me suis réintéressé à Mesmer mais pas comme on le fait d’habitude, en remontant l’histoire à
rebrousse-poils : Freud, Liebault, Bernheim, Bread, Puisegur… Mesmer. J’ai plutôt voulu prendre
Mesmer, comme je m’en suis expliqué : « par derrière » ; soit l’étudier historiquement, le voir non pas
comme le point de départ de ce qui allait aboutir au transfert freudien, mais ce qu’il a historiquement
été : le point final de la première grande vague du magnétisme, une sorte de gigantesque étoile filante.
Ça avait commencé deux bons siècles plutôt – non pas le magnétisme animal, qui est son invention à
lui (1772-76), mais le magnétisme en général. En 1600, le Médecin de la Reine d’Angleterre, un
dénommé Gilbert, publie un livre « De magnete » qui fait un véritable tabac : dans la première moitié
du XVIIe siècle, on parle énormément du magnétisme, la terre est un gigantesque aimant, Kepler lui-
même s’en empare. Pourquoi la terre tourne autour du soleil ? Magnétisme ! Les Jésuites sont ravis,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%