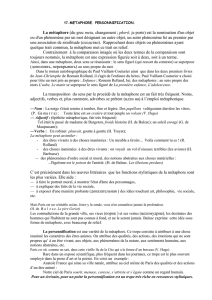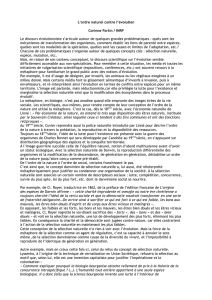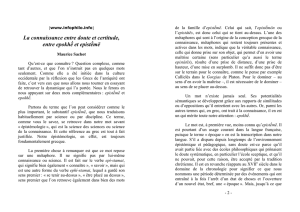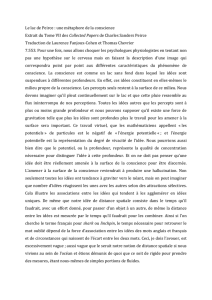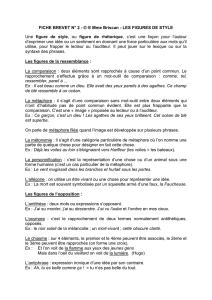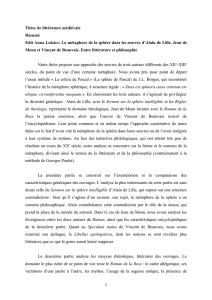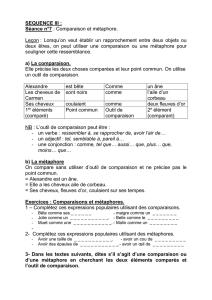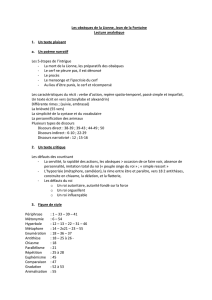info document - Espaces Marx

Gérard ASTOR – La Métaphore partagée – octobre 2010 1/65
Gérard ASTOR
La métaphore partagée
essai sur les fondements d'une autre esthétique
et d'une autre politique des arts
par l'analyse pratique du processus de production de la métaphore

Gérard ASTOR – La Métaphore partagée – octobre 2010 2/65
ESTHETIQUE ET POLITIQUE
avertissement
En 1966 l’Odéon à Paris est attaqué par des commandos d’extrême droite parce qu’on y
représente « les Paravents » de Jean Genet. 2500 ans plus tôt (en 493 avant notre ère, au
lendemain du spectacle de « La Prise de Milet » de Phrynicos) un décret des archontes de la
Cité d’Athènes interdit à la tragédie naissante de représenter des événements d’actualité.
Quelques dizaines d’années plus tard Platon écrit « La République » en en chassant les
artistes ; et d’une certaine manière Mahmoud Darwich lui répond aujourd’hui quand il écrit
dans « La Palestine comme métaphore » : « Le politique, dénué d’approche culturelle ou
d’imaginaire poétique, demeure de l’ordre du conjoncturel ». Il est temps, grand temps que
nous reprenions le débat perverti par la séquence du « réalisme socialiste » et
magnifiquement remis en selle par Peter Weiss dans « L’esthétique de la résistance » sur les
rapports entre esthétique et politique.
Cet essai est constitué d’un tressage opéré à l’automne 2010 entre une problématique
reposant cette question capitale et des textes pour partie inédits pour partie publiés qui sont
autant de « matériaux ouverts » au va et vient de la pensée et de l’expérience.
Les (sept) thèses proposées sont et ne sont qu’un outil dans la bataille qui fait rage
aujourd’hui, et qui s’attaque aux fondements mêmes des relations entre la création artistique
et le peuple qui toujours fomente la société. D’autres analyses peuvent venir en réponse aux
questions posées ; les mêmes questions peuvent être posées différemment ; d’autres
questions peuvent être posées , mais il faut agir, agir vite sur le mode de production de la
création artistique, sur les conditions de ce qui la lie au mouvement de la société, sur ce qui
se noue sur la scène elle-même et jusqu’à ce lieu de bataille qu’est le personnage (Anne
Ubersfeld dans « Lire le théâtre »), en un mot sur la dramaturgie de l’œuvre qui renvoie à ce
qu’on pourrait appeler la dramaturgie de l’Histoire…

Gérard ASTOR – La Métaphore partagée – octobre 2010 3/65
"Me rappelant que la démolition des vieux quartiers de la ville avait eu pour but de rendre
plus difficile la construction de barricades, de dégager le champ de tir, je voyais Paris captif
de ses classes supérieures, je voyais à tous les points stratégiques la richesse amoncelée
dominant les quartiers où les artisans, les petits-bourgeois et les ouvriers vivaient en vase
clos. Mais ce n'était pas ce schéma qui donnait à la ville son visage ; ici, le sentiment de la
présence de tous ces édifices prenait davantage sa source dans ce qu'on savait des
événements qui, tout autour, d'en bas, continuellement, avaient été déclanchés, des
mouvements de révolte, d'insurrection qui déployèrent leur propre violence, leur propre
pouvoir. Chaque maison conservait de ces actions une trace plus nette que celle des
contraintes décrétées par les dynasties, et si j'ajoutais à tous ceux qui, anonymes, avaient
entassé les pierres des barricades dans les ruelles ceux qui, par leurs œuvres d'art, s'étaient
intégrés à la vie de la ville, je me retrouvais dans le bouillonnement d'une cohue qui me
coupait le souffle."
Peter Weiss
L'esthétique de la résistance
Klincksieck, 1992, tome 2, p. 25
Un théâtre qui se construit dans l'élaboration d'un pouvoir monarchique absolu (celui de
Molière sous Louis XIV) ne peut être le "même" qu'un théâtre qui se construit dans l'époque
d'élaboration des premières formes de la démocratie politique au sein d'une société
esclavagiste (celui d'Aristophane dans l'Athènes du Vème s. avant notre ère), ni d'un théâtre
qui s'écrit (de l'auteur au spectateur) dans la période historique de la crise du capitalisme et
de son dépassement possible…

Gérard ASTOR – La Métaphore partagée – octobre 2010 4/65

Gérard ASTOR – La Métaphore partagée – octobre 2010 5/65
INTRODUCTION
J'ai bien conscience qu'il s'agit là d'un combat majeur. Parce qu'il ose mettre en rapport les
questions de l'esthétique et du politique, problématique depuis longtemps exclue du champ
de la théorie et de la pratique sous l'épouvantail du Jdanovisme. Parce qu'il ose mettre en
chantier une théorie de l'art et de son rapport avec la société hors des structures imposées
de la marchandisation ou du fait du Prince. Parce qu'il ose penser dans ce domaine la
possibilité d'un changement, d'une intervention qui provoque un changement, d'une
intervention des artistes eux-mêmes et du peuple dont ils font partie, qui soit de l'ordre du
partage et non de la concurrence, loin des ostracismes mutuels dans lesquels les jette la
caste qui tente de sauver d'une manière ou d'une autre son pouvoir établi, un changement
qui peut réorganiser le rapport entre l'esthétique et le politique.
Celui qui, à mes yeux, est le premier à s'être aventuré dans ce domaine, et qui a ouvert pour
moi le champ de ce possible, c'est Peter Weiss avec son "Esthétique de la résistance", où il
explore comment le peuple se trouve à la fois en amont et en aval du sens même des
œuvres d'art, à condition de dégraisser celui-ci des couches dont les puissants l'ont
recouvert (Francfort-sur-Main, 1975).
Dans le champ du théâtre, c'est Anne Ubersfeld qui a porté le fer, en indiquant dès
l'ouverture de "Lire le théâtre" : « Non seulement le « personnage » se situe à la place de
toutes les incertitudes textuelles et méthodologiques, mais il est le lieu même de la bataille.
F. Rastier a raison de montrer (par un jeu spirituel de citations) comment la critique
traditionnelle, surtout dans ses aspects scolaires et universitaires, se cramponne à la notion
de personnage, comme à une arme idéologique irremplaçable dans sa guerre de
retardement contre la critique dite « nouvelle »… La préexistence du personnage est l’un des
moyens d’assurer la préexistence du sens. Le travail de l’analyse sera dès lors celui d’une
découverte du sens, lié à l’essence massive du personnage, d’une herméneutique de la
« conscience », et non celui d’une construction du sens (déconstruction-reconstruction) » (
Editions Sociales, 1978, p. 120-1). Puis elle mit le spectateur en posture de producteur de
sens, avec "L'école du spectateur".
Enfin il y eut l'ouvrage de Jean-Michel Leterrier "La culture au travail" qui émancipa la
culture et les arts de l'emprise d'une classe dominante qui en avait fait une prise de guerre.
Il inventa les mots de "rapt du sens de la culture", et les concepts de "porosité" et de
"métissage" pour parler des rapports entre la culture des hommes au travail et l'art dit
"savant" des artistes ; il mit en avant les termes d'"échanges d'expériences, de valeurs, de
patrimoines" pour définir les passages entre la culture liée au travail humain et le travail
propre des ouvriers de l'art, les poètes. Il hissa enfin le spectateur au rang de partenaire du
sens, et décrit comment l'œuvre est précisément ce lieu de potentialités où le sens éclot
dans la multiplication des "combinaisons avec des expériences individuelles" (Messidor,
1991, réédité par les Cahiers de Convergences en 2007).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
1
/
65
100%