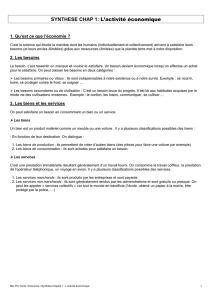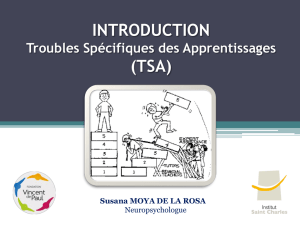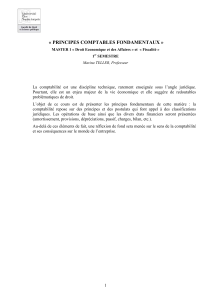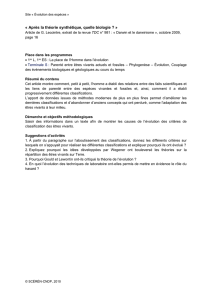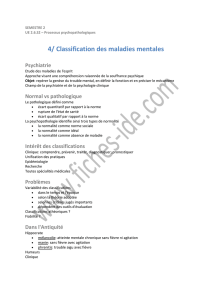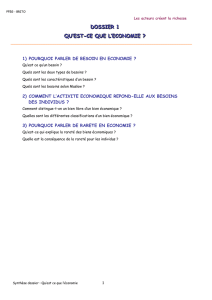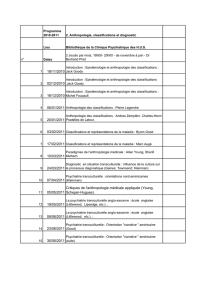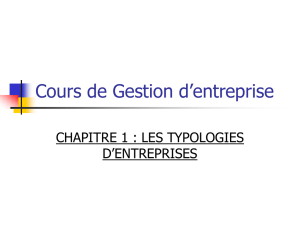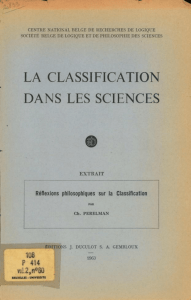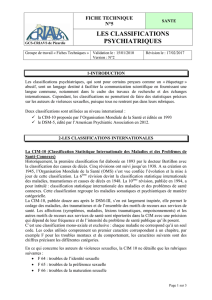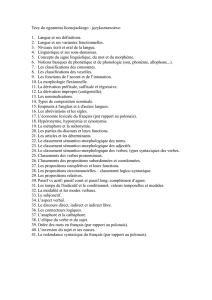Chapitre 1 : Définitions et classifications. Le chapitre est destiné à

Chapitre 1 : Définitions et classifications.
Le chapitre est destiné à présenter les définitions et les principales classifications
concernant les troubles des conduites.
Il distingue:
Le trouble de conduite : transgression des droits fondamentaux d’autrui ou des normes et
règles sociales correspondant à l’âge du sujet, notion fondamentale mais qui semblera être
oubliée par la suite.
La délinquance : ensemble des comportements conduisant à commettre des infractions
considérées dans leur dimension sociale.
Un (plus que) rapide historique du concept permet de le situer dans les polarités classiques
psychologie/morale, inné/acquis, génétique/environnement. Cet historique amène à présenter
l’arrivée et l’utilisation des grandes classifications internationales comme ce qui résoudre la
question et permettre de préciser les tableaux symptomatiques des troubles du comportement
de l’enfant, en dehors des conceptions psychopathologiques, morales et juridiques. Il ne
s’agit donc plus dès lors de psychopathologie (portant sur l’organisation de la psyché et son
fonctionnement dynamique) mais uniquement de description symptomatique (regroupement
syndromique non organisé d’observables). Cette question n’est mentionnée qu’en passant,
page 9, à propos de la classification française des troubles mentaux de l’enfant et de
l’adolescent. S’il est bien précisé que cette classification diffère des classifications
internationales en ce qu’elle ne veut pas se limiter à une description de symptômes
juxtaposés, mais qu’elle s’adresse aux psychiatres intéressées par la compréhension des
troubles et par le repérage de leur dimension processuelle, et que le diagnostic nécessite
donc une analyse psychopathologique approfondie, il n’en est tiré absolument aucune
conséquence, en particulier sur l’utilisation des outils diagnostics de repérage
épidémiologique des troubles et leur pertinence clinique. La question est évacuée en précisant
qu’en 2002 la classification française est mise en conformité avec la classification
internationale des maladies « pour une meilleure communication internationale ». La
différence pourtant fondamentale entre diagnostic fondé sur une analyse de l’organisation
psychique et diagnostic catégoriel consistant en un regroupement d’observables du
fonctionnement n’est donc jamais discutée.

Le caractère international des classifications pose le problème classique de l’universalité
postulée des troubles, qui n’est pas mentionné.
Il est précisé que les symptômes du trouble des conduites selon la CIM-10, au nombre de
23, ne sont ni hiérarchisées ni organisées, mais aucun conséquence n’en est tirée sur le fait
que cette accumulation hétéroclite de symptômes divers ne peut pas permettre un diagnostic
qui ait du sens. S’y entremêlent des éléments d’interprétation très large (les 10 premiers : « est
souvent susceptible ou contrarié par les autres », « est souvent fâché ou rancunier, « s’oppose
souvent activement aux demandes des adultes ou désobéi »….), pour lesquels le rapport à
l’âge pourtant mentionné en introduction n’est pas rappelé, et des éléments plus précis et de
conséquences plus graves (incendie, cambriolages, agressions sexuelles, agressions
physiques, cruauté physique envers des personnes ou des animaux,…).
Les symptômes décrit par le DSM 4 sont plus restrictifs et sont organisés en quatre
catégories distinctes : atteinte à l’intégrité physique d’autrui, atteintes aux biens matériels, vol
et fraude, violations graves des règles.
Les critères diagnostiques ne sont que présentés par les auteurs, sans que soit explicité ce
qui a présidé à leur définition, ce qui est le cas pour toutes ces définitions catégorielles, dont
on ne sait jamais comment elles sont construite. Il est simplement précisé en une phrase
lapidaire, page 8, que « les études sur le terrain ont montré la validité du diagnostique pour
l’enfant d’âge scolaire et pour les adolescents ainsi que sa stabilité ». On ne sait rien de ce qui
est entendu ici par « validité », si ce n’est que la prévalence des troubles est supérieure dans
un échantillon d’enfants (86) adressés en services spécialisés par rapport à celle d’un groupe
d’enfants (50) d’un service de pédiatrie laissant ainsi supposer que la validité de ce diagnostic
(chez les enfant préscolaires) reposerait sur une unique étude comparative sur deux groupes
totalisant une centaine d’enfants.
La question des comorbidités est abordée, et les auteurs se demande au regard de leur
prévalence importante si l’approche catégorielle trouble des conduites, troubles positionnels,
personnalité antisociale a vraiment un sens. Une phrase étrange les fait également se
demander si on peut considérer la personnalité antisociale comme un trouble mental alors
qu’il n’y a pas de traitement, laissant ainsi supposer qu’il n’y aurait de trouble que s’il y a
un traitement, alors que ce diagnostic peut déresponsabiliser le sujet en cas de procès,
faisant ainsi intervenir des considérations juridiques dans la définition d’un trouble
psychiatrique. Il s’agit donc bien là de l’introduction d’une posture morale (doit-on permettre
aux « délinquants » de pouvoir se revendiquer comme des « malades mentaux » et leur donner

ainsi des « armes » potentielles dans un combat juridique) dans une question de psychologie,
alors que cette introduction des catégories morales dans une définition « scientifique » des
troubles est précisément ce qui est dénié par ceux qui prétendent que ces définitions sont
exemptes de composantes morales.
Dans la conclusion, alors même que la définition des troubles du DSM IV ne comprend
sur 15 critères que deux critères concernant les violations graves des règles établies, les autres
critères comprenant en particulier les agressions physiques et la cruauté sur les personnes, les
auteurs affirment que le point commun des descriptions de symptômes de troubles des
conduits dans les classifications internationales actuelles est « la violation des règles établies
», terme dont la généralité semble mettre sur le même plan la torture et le fait de mettre ses
doigts dans son nez, ou, pour prendre un exemple plus grave et plus historique, le fait de
s’opposer aux vérités du parti.
En résumé, la définition des troubles, qui forme le socle sur lequel tout le reste de
l’expertise se construit, puisqu’elle en forme les catégories de base, est évacuée en 10 pages
sans problématisation, discussion ou analyse critique des catégories diagnostiques proposées,
et se borne finalement à prendre acte de ce qu’il faut utiliser les classifications catégorielles
syndromiques internationales … puisqu’elles sont utilisées !
L’imprécision totale du diagnostic laisse supposer qu’il sera en fait inutilisable, même pour
calculer de simples prévalences.
1
/
3
100%