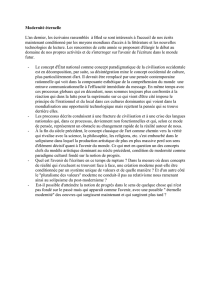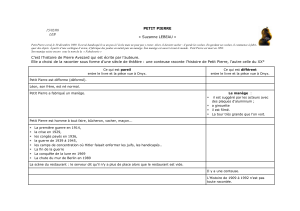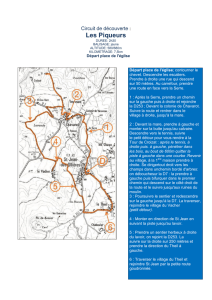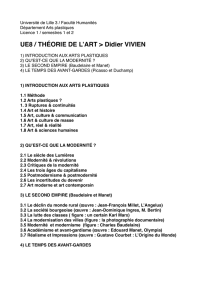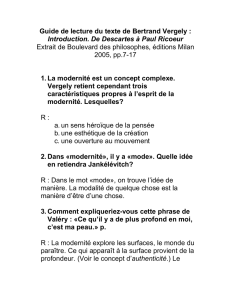« N`ajoutez pas le désordre au désordre »

Conjonctures N° 15
113
« N'ajoutez pas le désordre
au désordre »
1
par Nicole Fortin
Alors que le Tout philosophique (comme on dit le
Tout-Paris) s'énerve autour de Heidegger, fait de
Nietzsche la référence universelle, revampe le vieux
Kant et enterre Marx douze pieds sous terre de peur
qu'il n'en ressorte, alors que les intellectuels améri-
cains polémiquent à propos de la déconstruction
derridienne, que les post-modernistes mettent au
rancart les vérités universelles et mettent en doute
l'existence du réel, Vacher (Laurent-Michel) ose
écrire sans beaucoup de précautions envers l'époque:
« Je crois en effet que le naturalisme pragmatiste
développé par les grands penseurs américains est la
manifestation la plus achevée du substrat mental de
la modernité — pensée de la méthode,
métaphilosophie de la vie comme projet rationnel et
libre recherche critique, à laquelle il conviendrait
par exemple de subordonner, comme simple
hypothèse régionale, le libéralisme économique
aussi bien qu'un socialisme (ou marxisme)
démocratique. » On croirait entendre le vieux
Diogène ramenant Platon à des vérités plus
tangibles. Mais le rire de Diogène chez Vacher se
fait rictus quand, aux passages fréquents, il s'en
prend à la philosophie continentale. Il écrit entre
autres: « ...s'opposer à tout sens commun, critiquer
1
Federico Fellini, "8 1/2".

114
toute conception ordinaire des choses, dénoncer et
dépasser toute opinion courante, tel pourrait bien
être l'un des ressorts de l'activité philosophique
continentale. »
Il ne faudrait cependant pas croire que le
projet de Vacher se limite à pamphlétiser contre les
philosophies à la mode. Plus sérieusement, il me
semble, et là aussi un peu à contre-courant de la
pensée contemporaine, Vacher prend parti pour la
modernité qu'il oppose à la Tradition. Le ton, là,
n'est plus à l'ironie. Il écrit à ce sujet: « La civilisa-
tion moderne ne me paraissait plus être une option
libre qui se proposerait au monde actuel parmi
d'autres tout aussi disponibles et possibles. Elle
revêt plutôt à mes yeux la figure d'un destin
inévitable » et il ajoute: « Si je donne souvent dans
les pages qui suivent l'impression que la modernité
serait merveille, la vérité et la voie, c'est surtout en
vertu de l'acte de foi vital de qui voudrait croire que
le pire ne soit pas toujours sûr. »
À la fois pamphlet contre l'hypersophisti-
cation de la philosophie européenne, apologie de la
simplicité, acte de foi envers la modernité, L'empire
du Moderne
2
se présente en deux parties, les deux
sous forme épistolaire. Pour nous parler de
l'Occident, puisqu'essentiellement là est son propos,
Vacher choisit en effet de s'adresser à deux
intellectuels fictifs, originaires du Tiers monde.
S'adressant au premier, il tente de répondre à la
question suivante: quelle philosophie, quelle vision
du monde sous-tend la modernité? La question est-
2
Laurent-Michel Vacher, ed. Les herbes rouges, Montréal, 1990.

Conjonctures N° 15
115
elle simple prétexte permettant à Vacher de nous
parler de la philosophie pragmatiste américaine qu'il
juge, sans doute à raison, méconnue parce que mé-
prisée par les philosophes européens? Toujours est-
il qu'il affirme que cette philosophie est « une
expression exemplaire de l'éthos et de la
weltanschauung de la modernité », sa manifestation
la plus achevée.
Dans la deuxième partie de son livre, Vacher
tente de circonscrire les enjeux de la modernisation
pour le Tiers monde. Celle-ci implique-t-elle
inévitablement une perte d'identité culturelle? Cette
question constitue le dilemme du Tiers monde, elle
est non seulement l'objet de multiples débats
intellectuels mais aussi la cause d'affrontements
politiques et guerriers.
Mon intention n'est pas ici de juger de la
pertinence de la synthèse amplement documentée
3
que fait Vacher du naturalisme pragmatiste
américain. N'ayant lu que quelques essais de Dewey
sur l'éducation, j'aurais du mal à le faire. Et
d'ailleurs, Vacher ne prétend pas rendre compte de
cette pensée dans toute sa subtilité. « Ce qui compte
avant tout, écrit-il, c'est le programme philosophique
ou les conclusions avancées (ce qui fait la doctrine,
la vision du monde, la prise de position des
penseurs)... » Aussi me contenterai-je de reprendre
3
Dans cette synthèse, Vacher se réfère à un nombre impresionnant de
philosophes américains qui vont de William James à Richard Rorty.
Mais sa préférence va nettement à John Dewey qu'il considère comme
le plus représentatif de cette école dite du naturalisme pragmatiste

116
ici le résumé succinct qui apparaît à la fin de la
première partie du livre.
« Le noyau philosophique de cette pensée,
écrit Vacher, se réduit fondamentalement à ceci :
tout indique 1) que l'espèce humaine soit un produit
naturel de l'univers matériel, lequel apparaît comme
la réalité existante, et 2) qu'elle n'ait rien de mieux à
quoi se fier, pour atteindre tout le bonheur dont elle
est capable, que les ressources de son intelligence
méthodique et de son esprit critique. Car l'homme
est ainsi fait qu'au lieu d'oeuvrer instinctivement et
de vivre à l'aveuglette, il peut penser, analyser,
juger, prévoir et se comporter ensuite sur la base de
ces activités mentales. Il se trouve que c'est
essentiellement dans la mesure où son intelligence
est à même de remplir ce rôle d'instrument pratique
que l'humanité est capable d'agir le plus
efficacement, ce qui lui procure son aptitude unique
à s'adapter et à modifier si nécessaire son
environnement, matériel ou social, en vue de
satisfaire le mieux possible ses besoins individuels
et collectifs. A la limite, il ne serait donc pas faux de
prétendre que le seul message de cette philosophie
soit simplement que la méthode la plus efficace en
ce monde est celle de l'intelligence expérimentale et
du débat critique, et qu'il serait bon de s'en remettre
à elle le plus possible en tout domaine. »
Une philosophie résolument matérialiste,
une philosophie évolutionniste, qui croit au progrès,
une philosophie empiriste qui croit que le réel est
comme tel saisissable par l'intelligence et non faussé
par la subjectivité, une philosophie avant tout
tournée vers la pratique où l'éthique prend une

Conjonctures N° 15
117
place de choix. Une éthique elle aussi empiriste qui
repose sur l'expérience et qui cherche
essentiellement le bien-être et le bonheur de tous les
hommes. En ce sens, c'est aussi une philosophie
éminemment humaniste. Sa pensée politique repose
toute entière sur les principes de la démocratie :
droits égaux pour tous et liberté d'expression. Les
conflits et les problèmes trouvent leur solution dans
le débat démocratique, par voie d'essais et d'erreurs.
À propos de pensée politique, il convient, je
crois, de citer à nouveau Vacher. « Je considère
comme une absurdité du destin de la pensée, écrit-il,
un paradoxe et une ironie de l'histoire des idées, que
le pragmatisme ait été interprété comme une théorie
de l'individualisme, de l'arrivisme, du profit com-
mercial et de la réussite à tout prix alors qu'il s'agit
en réalité d'une pensée de l'existence vitale comme
entreprise collective, de résolution de problèmes
dans un monde précaire et incertain... » Vacher cite
amplement les auteurs, et particulièrement Dewey,
tentant de montrer à quel point ceux-ci ne
partageaient pas la philosophie du succès individuel,
de l'argent, « le côté sinistre de la civilisation
américaine » comme l'écrit William James. Ainsi,
Dewey admet « que nous sommes voués à une
certaine forme de socialisme, qu'on la baptise
comme on voudra ». Pour qui connait quelque peu la
vie de ce dernier, il ne fait pas de doute que Vacher
ait raison de s'indigner. Dewey fut en effet autant
un penseur qu'un militant de l'humanisme. Somme
toute, et c'est l'interprétation de Vacher, la pensée
pragmatiste américaine est plus près de la social-
démocratie que du libéralisme si l'on considère sa
signification politique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%