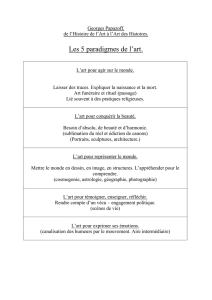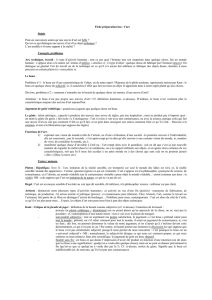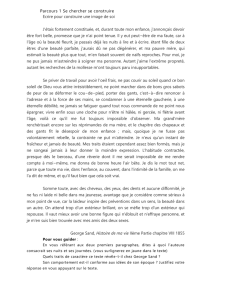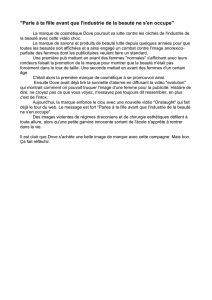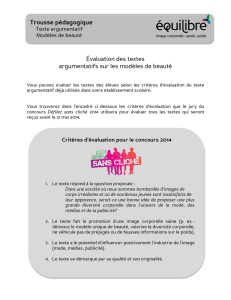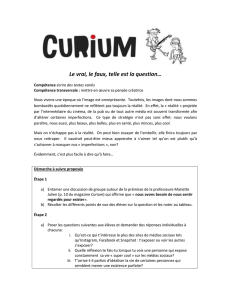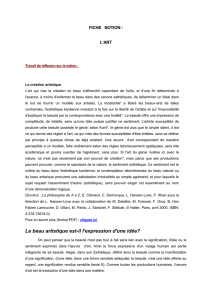ART - Le beau - Faculté d`Architecture La Cambre Horta

ART - Le beau
Qu’est-ce que le beau ? Que voulons-nous dire lorsque nous disons : c’est beau ? Question
difficile et qui, sinon lors d’exercices académiques, n’est plus souvent posée aujourd’hui. De fait,
le mot lui-même n’a plus guère cours dans le vocabulaire contemporain. Peut-être convient-il,
pour orienter notre réflexion, de poser une question préjudicielle : d’où vient que le mot et sans
doute l’idée connaissent aujourd’hui cette mauvaise fortune ? Il y a plusieurs réponses à cette
question ; nous examinerons tout de suite la première, qui est ambiguë sinon contradictoire, et
les autres en fin de parcours.
Affirmer : ceci est beau, c’est prononcer un jugement de goût, comme disait Kant ; et ce
jugement de goût est un jugement de valeur : je reconnais à l’objet une valeur propre. Cette
valeur est éprouvée dans l’usage que je fais de l’objet, et qu’il appelle, c’est-à-dire dans la
perception, car cet objet se donne avant tout comme à percevoir (et goûter est encore sentir) ;
elle peut aussi être consacrée dans l’échange, si l’objet pénètre dans un circuit commercial. Il
faudra nous interroger sur le statut de cette valeur, et sa relation au jugement qui la pose. Mais
nous pouvons observer dès maintenant que la pensée contemporaine marque beaucoup de
réticence à l’égard des valeurs – réticence qui s’explique en partie par l’influence qu’a connue le
thème de la valeur pendant les années trente, mais aussi par le choix des thèmes qu’opère cette
pensée. Des trois valeurs, le vrai, le beau, le bien, qu’associe une trilogie fameuse – et d’ailleurs
très contestable pour bien des raisons, en particulier parce qu’elle élimine l’utile et l’agréable –, la
pensée contemporaine en privilégie une : le vrai. Et sans doute est-elle, du moins chez les
philosophes, plus sensible à la vérité formelle, dont le vrai nom est validité, qu’à la vérité
matérielle, plus sensible à la cohérence du discours qu’à sa véracité. Le crédit qu’elle accorde au
vrai va moins à une valeur qu’à une recherche, et peut-être moins à la pensée en acte qu’à la
pensée comme système. Or, du beau, il n’y a point de système, il y a des choses belles, et,
fussent-elles rassemblées dans le « Musée imaginaire », elles ne constitueraient qu’un
ensemble inarticulé. Pour les intégrer dans cet ensemble, il faudrait prendre chaque fois une
décision singulière : le jugement de goût met le juge en face de sa responsabilité ; il l’invite à être
lui-même pour rendre justice à l’objet, et peut-être en retrouvant avec cet objet une intimité
perdue. Plus généralement, toute valeur en appelle à la décision ou à l’acte d’un sujet. C’est
pourquoi le néo-positivisme de notre temps s’accommode mal d’une axiologie ; il est
antihumaniste, et la valeur est suspecte à ses yeux parce qu’elle est associée à la subjectivité.
1. Le dogmatisme
Mais cet antihumanisme, s’il est en philosophie le dernier cri, n’y a pas été le premier mot. Et, de
fait, c’est d’abord pour une raison exactement inverse – et encore agissante aujourd’hui – que la
notion du beau, liée alors à une autre interprétation du jugement de goût, a connu un premier
discrédit, parce qu’elle suscitait un dogmatisme qui niait ou paralysait l’initiative du sujet. C’est
donc au nom de la subjectivité, ou de la liberté, qu’ont d’abord été dénoncés un certain concept et
un certain usage de la valeur. Les malheurs de l’idée du beau commencent en effet avec la
réaction contre un certain platonisme – avec une interprétation aristotélicienne de Platon que
nous ne saurions discuter ici –, contre la substantification du prédicat, mère de l’académisme où
se précipite l’âge classique. Cette nominalisation, autorisée par les langues indo-européennes,
est une tentation permanente pour la pensée. Dès qu’on passe de l’énoncé : ceci est beau à
l’énoncé : le beau est..., on en vient à concevoir un être du beau et à le doter d’une consistance
et d’une autorité telles qu’au lieu qu’il procède des choses belles, ce sont les choses belles qui
procèdent de lui : les choses ne sont belles que dans la mesure où elles ont part à la beauté.
Voici la valeur promue au rang d’Idée, et installée dans un ciel métaphysique... Inaccessible
désormais ? Que non ! Il faudra attendre Kant pour qu’à l’Idée soit assignée une fonction
seulement régulatrice, et non déterminante. La philosophie précritique met l’Idée au travail, et lui

fait cautionner son idée du beau. L’idéalisme engendre tout naturellement le dogmatisme ; ce
beau indéfinissable, les traités du beau ou les arts poétiques s’emploient non pas à le définir,
mais à définir ses exigences, auxquelles l’art doit se soumettre comme la nature est soumise.
L’autorité de l’Idée est dévolue aux juges, car le juge n’est pas seulement l’expert que voulait
Aristote, l’homme dont un long commerce avec les choses belles a lentement formé le goût, il est
celui qui entre dans le conseil des dieux ou le secret de l’Idée : il sait. Et sa juridiction s’étend à
toute l’histoire ; ou plutôt elle annule l’histoire, car elle interdit la contestation et l’invention qui en
sont le ressort, puisque l’Idée est intemporelle ; les Modernes n’ont pas à s’opposer aux Anciens
puisqu’ils doivent suivre les mêmes canons et obéir aux mêmes règles.
Le temps a passé depuis que la fondation de l’Académie française instaurait la dictature de
l’académisme, pourtant, la suspicion où est tenue, aujourd’hui plus que jamais, l’idée de beauté,
a sans doute là son origine. D’autant que l’académisme est une hydre à cent têtes, tout discours
sur le beau est spontanément normatif, et il n’en peut être autrement. Premièrement, parce qu’il
porte sur une valeur et que toute valeur appelle un faire : il est difficile de porter, et encore plus
d’expliciter pour le justifier, un jugement de goût, sans inviter à refaire ce qui a été fait, ou du
moins à poursuivre le même effort. Deuxièmement parce que le beau comme valeur est la norme
de l’objet beau ; les qualités ou les structures qu’on décèle en cet objet apparaissent en effet
constituantes et comme appelées par lui, de la même façon que la santé est requise, organisée
et défendue par l’organisme vivant. Troisièmement, enfin, le discours sur le beau est dogmatique
aussi parce qu’il est un discours, il promeut la norme à la généralité du verbe. À quoi il faut ajouter
que le dogmatisme trouve aisément des complices. D’une part, chez les artistes eux-mêmes, au
moins lorsqu’ils ne se recommandent pas d’une vocation particulière et ne revendiquent pas les
privilèges d’une inspiration singulière ; tant qu’ils se pensent comme artisans voués à l’anonymat
du faire, même si leur promotion exige un chef-d’œuvre, ils s’accommodent d’obéir à des règles
et de pratiquer des recettes qui leur garantissent de trouver à moindres frais une audience.
D’autre part, le public accepte volontiers les valeurs sûres qui répondent à son attente et lui
épargnent un effort de jugement ; il est prêt à dire beau ce qui lui est facile. N’est-ce pas ainsi que
toujours il a jugé de la musique ? Et si l’harmonie est une dimension souvent évoquée de la
beauté, n’est-ce point parce qu’elle désigne d’abord l’agrément que l’oreille ou l’œil trouve à ce
que l’éducation les a formés à percevoir ? Ainsi se constituent les styles, entendez les manières
que conspirent à perpétuer des créateurs dociles à un enseignement, et des consommateurs
asservis à leurs habitudes. Pas de style sans une doctrine du beau qui, si impérieuse soit-elle,
paraît à la fois économique et rassurante ; ainsi, la culture du goût autorise et justifie
l’impersonnalité.
Pourtant, de cette conception autoritaire du beau, il est trop facile aujourd’hui de dénoncer
l’étroitesse et de railler les champions. Car, en fait, elle n’a jamais vraiment régné ; Boileau n’a
pris figure de pédant d’académie que lorsqu’il a été confisqué par les pédants du collège, qui ont
oublié sa liberté de mœurs et d’esprit, sa fantaisie et son ironie. Au reste, le dogmatisme de l’âge
classique oublie le platonisme et se fonde sur une philosophie au moins implicite qui est fort
conciliante. La règle d’or, c’est que le beau doit plaire ; et, pour un esprit bien né, et surtout bien
élevé, le plaisant est aussi le convenable, et le convenable est le raisonnable. Souveraineté de la
raison ? Oui, mais sans rien de despotique :
La parfaite raison fuit toute extrémité,Et veut que l’on soit sage avec sobriété.
Raison, c’est bienséance, privilège de tout ce qui existe vraiment, qui est bien assis dans l’être,
un état de nature, en quelque sorte. Pour l’homme et pour ses œuvres, c’est la même chose
d’être naturel et d’être raisonnable, de fuir les excès qui sont contre nature. La raison commande
la mesure parce qu’elle est en toute chose sa mesure et sa vérité ; vérité qui n’est pas celle du
discours porté sur l’objet, mais de l’objet bien portant lui-même, vérité dont la manifestation est la
vraisemblance. Alors s’identifient le vrai et le beau, et se précise la fin de l’art : il produit le
vraisemblable en imitant la nature, la belle nature qui est déjà par elle-même raisonnable et

plaisante. Mais l’imitation n’est pas aisée, même si le principe en est simple ; jusqu’où imiter et
comment ? Après avoir choisi la belle nature, il convient parfois de lui ajouter de l’artifice pour
mieux la reproduire ; il lui faut du génie – « du ciel l’influence secrète » – mais aussi du métier, et
c’est ici qu’interviennent les règles, et que le didactisme se donne libre carrière. Pourtant cette
philosophie du beau n’implique pas nécessairement le dogmatisme. Philosophie conciliante,
avons-nous dit ; incertaine plutôt : elle hésite entre Platon et Aristote, entre l’idée d’une raison
législatrice incorruptible, qui saurait définir le beau et gouverner l’art, et l’idée d’une raison
présente dans les choses aussi bien que dans l’homme comme leur ratio ou leur norme propre,
dont la beauté, toujours singulière, signifie l’efficace. Si l’on incarne l’idée dans l’objet, si l’on tend
à identifier raison et nature, le dogmatisme du beau n’a plus d’autre recours que dans la volonté
de puissance du critique, la docilité de l’artiste, ou la paresse du public.
2. La subjectivité du jugement esthétique
En tout cas, ce dogmatisme a été attaqué de divers côtés, et avant tout par la philosophie de la
subjectivité. On connaît les célèbres analyses de Kant. Le beau, dit-il, est sans concept ;
impossible de définir ce qu’est le beau en soi, et donc de donner des règles qui en garantissent la
production ; le jugement de goût est toujours singulier, il ne dit pas que les roses sont belles, mais
que cette rose est belle. Et il ne justifie pas, il exprime simplement le plaisir que nous prenons à
percevoir la chose belle. Ce plaisir est à la fois le ressort et le critère du jugement. Critère
subjectif, donc ; et, en effet, le plaisir à son tour exprime l’état du sujet, l’harmonie de ses facultés
dans leur libre jeu. En disant que l’objet est beau, je ne sais et je ne dis rien de lui, je parle de moi,
et j’affirme que ma perception est heureuse. Est-ce à dire que le beau soit totalement relatif ? Un
certain historicisme le suggère, et c’est lui sans doute qui, avant et après Kant, a dû ébranler les
certitudes dogmatiques : on a pu être gothique comme on peut être persan, et, pour un œil
gothique, le gothique était beau, de même, disait Voltaire, que pour un crapaud, c’est sa
crapaude qui est belle. Thème éculé et trop facile, car si on est tenté de dire, lorsque le Musée
imaginaire commence à rassembler les arts sauvages, que tout est beau parce que n’importe
quoi a pu trouver quelqu’un pour le juger beau, cela revient à dire que rien n’est beau : le
subjectivisme finit par annuler le jugement de goût. Or, Kant s’est bien gardé d’aller jusque-là ;
pour lui, le jugement de goût, même s’il ne peut se justifier par quelque concept, revendique
l’universalité ; en prononçant ce jugement, j’affirme que tous doivent le prononcer comme moi.
Mais ce que j’arrache ainsi à la relativité de l’histoire, ce n’est pas une idée du beau, ou un art
poétique, c’est une idée de l’homme ; ce que je promeus à l’universel, c’est le sentiment que
j’éprouve devant le beau, dont je postule que tous doivent l’éprouver : j’affirme que tous les
hommes sont semblables, qu’il y a en eux une nature transcendantale universelle, je suppose
que « chez tous les hommes les conditions subjectives de la faculté de juger sont les mêmes [...]
car sinon les hommes ne pourraient pas se communiquer leurs représentations et leurs
connaissances ». Davantage, si la diversité était le dernier mot, si les différences d’esprit ou de
culture étaient impénétrables, si l’on ne pouvait écrire l’histoire, faute d’y voir à l’œuvre des motifs
et des intentions et d’y lire un avenir, une aventure de l’homme, y aurait-il une histoire ? Tout au
plus une histoire naturelle, une chronologie. Pas d’histoire humaine sans l’affirmation d’une
communauté transhistorique des hommes ; pas d’histoire de l’art sans la fraternité « des
quelques hommes qui fondèrent l’honneur d’être hommes », comme dit Malraux.
Mais il n’y a pas non plus d’histoire humaine sans la permanence d’un monde dont le sujet,
dans son présent vivant, ne cesse d’éprouver la présence en s’assurant de l’objectivité de l’objet.
Si le plaisir esthétique s’éveille en moi, c’est en réponse à un objet qui le suscite, et c’est pourquoi
je désigne le beau comme une qualité de l’objet. L’analyse kantienne, si elle met l’accent sur la
subjectivité de l’expérience esthétique, ne récuse pas l’objectivité du beau. Il faut conjuguer les
deux idées, de la subjectivité du jugement esthétique parce qu’il n’y a d’objet esthétique que pour
un sujet qui l’esthétise, et de l’objectivité du beau parce que c’est l’objet qui en appelle au sujet et
qui se juge en lui en même temps qu’il s’accomplit par lui. Si le beau apparaît seulement à qui s’y

rend sensible, n’importe quoi n’apparaît pas beau. Le Musée imaginaire nous a appris qu’il y a du
beau partout, mais il ne suggère pas, Malraux y insiste, que tout est beau. Le jugement réserve
donc ses droits, mais pour reconnaître les droits de l’objet ; ce sont les œuvres qui nous imposent
de choisir entre elles, et de ne pas brader les prix de beauté. Le jugement ne constitue pas la
beauté, il la reconnaît et la nomme quand il la rencontre.
3. Le beau dans la nature
Cette rencontre, toujours imprévisible, n’a pas nécessairement lieu dans le Musée. De fait, ce qui
intéresse au premier chef la philosophie kantienne, c’est le problème que pose la découverte du
beau dans la nature : loin que le beau soit constitué ou déterminé par le jugement, il provoque ce
jugement en suscitant le libre essor des facultés ; il autorise donc à penser que la nature, au lieu
de se réduire à la diversité opaque et indifférente du sensible, manifeste quelque complaisance à
l’égard de notre pouvoir de connaître. Elle semble imiter l’art, qui nous propose en effet des
objets complices, riches de sens et de séduction, mais déjà l’art imite la nature. La nature alors
n’est plus ce donné inerte auquel l’entendement impose ses lois, elle est, sous la réserve d’un
« comme si », le partenaire complaisant du sujet. Ce point nous semble essentiel. Kant, certes,
n’élabore pas une philosophie de la Nature. Mais il nous invite à penser que le beau naturel est
exemplaire, et cette leçon est trop souvent négligée lorsque toute l’attention se porte sur l’art. Ce
qui est étonnant pourtant, c’est bien que des choses nous proposent ingénument le visage
heureux de la beauté sans que cette beauté ait été voulue et produite par l’artifice humain. Et ce
sont les artistes eux-mêmes qui, maintes fois, nous assurent être inspirés par cette beauté
naturelle, même si, aujourd’hui, ils entendent tout autrement qu’à l’âge classique le précepte de
l’imitation de la nature. Ainsi Klee : « Le dialogue avec la nature reste pour l’artiste condition sine
qua non. L’artiste est homme ; il est lui-même nature, morceau de la nature dans l’aire de la
nature. » L’objectivité du beau ne tient donc pas seulement à ce que l’objet est reçu plutôt que
constitué, mais aussi à ce que l’objet est d’abord donné plutôt que fabriqué. Le geste fabricateur
lui-même, si appris, si laborieux, si conscient de soi qu’il puisse être, garde quelque chose de
naturel. Dans le génie, comme le suggère Kant, c’est encore la Nature qui agit ou qui parle, qui se
répond à elle-même. Avec lui – abandonnons ici le langage de Kant – la nature naturée par
l’homme accomplit peut-être le vœu de cette Nature naturante qu’évoquait Klee : apparaître, se
signifier. Et non point en filigrane, par une trace, sous les auspices de l’absence ou de la mort,
comme le suggère aujourd’hui un certain misérabilisme philosophique, mais dans une plénitude
glorieuse, toutes les voiles du sensible déployées pour se refléter dans l’eau d’un regard. Ici
commence vraiment le langage, la Nature fait signe à l’homme, l’apparaître est chargé de sens.
4. Beauté et expressivité
Par où nous sommes peut-être conduits à définir enfin le beau ; sans aucun dogmatisme,
puisqu’il est la qualité toujours singulière d’un objet singulier ; pas de concept pour le définir, pas
de recette pour le produire, pas de critère pour le juger. La beauté, c’est la vertu de l’objet
sensible et signifiant, en qui l’être s’identifie à la valeur. Cet objet porte en lui son propre concept,
mais de telle façon que ce concept se signifie dans le sensible. Si l’on préfère, l’objet satisfait à sa
propre norme, et il le montre : il montre qu’il est vraiment ce qu’il prétend être. Rien n’est beau
que le vrai ; le classicisme a raison, mais à condition de comprendre la vérité non point comme la
fidélité de l’imitation, ou aussi bien comme la véracité d’un discours sur l’objet, mais comme la
fidélité de l’objet à lui-même, lorsque tel tableau est un vrai tableau, tel monument un vrai
monument, comme on dit qu’une perle est une vraie perle ou que Socrate est un vrai philosophe.
Vérité, manifestée eans l’apparaître, d’un être et non d’un discours : cet être se signifie, il se
révèle, il se déploie dans la lumière du sensible. Le soi qui s’exprime ainsi n’est pas, comme on le
dit trop souvent, le soi d’un auteur soucieux de se dire pour s’exhiber ou se délivrer, ou indifférent
à se trahir. C’est avant tout le soi de l’objet, qui manifeste une essence singulière en se livrant à

la perception. En énonçant « le principe de nécessité intérieure » qui préside pour lui à l’ontologie
de l’art, Kandinsky semble hésiter entre deux interprétations : nécessité intérieure à l’artiste,
nécessité immanente à l’œuvre. Ce que l’œuvre belle nous donne d’abord à saisir, c’est sa
propre nécessité, sa propre perfection. Et l’on comprend que cette nécessité ait souvent été
interprétée comme un principe d’unification, et qu’elle ait inspiré des règles pour produire l’unité
immanente de l’objet ; composition, équilibre, harmonie, accord, tous ces termes désignent une
totalité dont certaine procédure pourrait consacrer l’achèvement. Mais, peut-être, l’art moderne
nous le suggérera, l’objet beau a-t-il d’autres moyens de signifier son être que de mimer la totalité
d’un organisme.
Cependant, toute la vertu du beau est-elle de se signifier lui-même ? Si le sensible est
signifiant, tout le sens réside-t-il dans son épiphanie ? Ou bien l’objet, outre qu’il nous fait signe,
est-il vraiment signe ? Porte-t-il un sens qui ne se réduise pas à son impérieuse présence ? Nous
dit-il autre chose que lui-même ? Oui : le sensible lorsqu’il est glorieux, n’est jamais insignifiant ;
ce qui se dit par lui n’est pas un concept ou une idée, c’est un monde. Un monde, c’est-à-dire un
signifié sans contours, un horizon de sens, plutôt qu’un sens déterminé, mais que pourtant le
sentiment identifie et reconnaît sans peine : le monde de Cézanne n’est pas le monde de Monet.
Le sens ici n’est pas ce vers quoi se transcende le signe, jusqu’à s’effacer comme le langage
prosaïque dans sa fonction, c’est l’être même du signe en tant qu’il s’illimite. Ce monde présent
dans le sensible, et non représenté ou imité par lui, est conjuré par la force de l’apparaître, qui est
la Nature même. Et c’est pourquoi ce monde est un possible de la Nature, d’une Nature qui n’est
plus le Grund originel puisqu’elle s’exprime, mais qui s’exprime comme Grund , par un monde
que ne maîtrisent pas encore le concept ou la main. Si l’art est déjà un discours de l’homme, c’est
un discours premier, qui n’est pas encore séparé de son objet, où le signifiant porte en lui le
signifié, un discours qui est celui de l’homme à son aurore, si bien mêlé à cette Nature qui le porte
que le réel et l’imaginaire se confondent, un discours où l’homme pythique parle malgré lui et
finalement laisse parler la Nature. Beau, l’objet qui nous ramène aux origines, qui existe assez
pleinement, assez nécessairement pour nous ouvrir un monde à même le sensible et témoigner
par là de la Nature.
Le pouvoir signifiant du beau, c’est son expressivité, et cette expressivité est le prix de la
perfection. Nous définissons donc l’objet beau par sa puissance d’être, mais qui réside toute
dans son apparaître, dans la fermeté et l’éclat de sa chair, dirait Merleau-Ponty. Étienne Souriau
a souvent insisté sur cette présence de l’œuvre d’art, sur « son existence éclatante et
autonome », cela définit pour nous la beauté. Mais s’il suffit d’exister pour être beau, où est le
privilège du beau ? Pour le saisir, qu’on évoque des contre-exemples : de laideur, mais surtout
d’insignifiance ; car si le beau n’a pas de critère, il ne peut trouver dans le laid son contraire. Le
laid s’oppose au beau comme le raté au réussi, comme le pathologique au normal ; l’objet
échoue à être ce qu’il prétend être, le non-être qui l’affecte est celui de l’illusion, de la tricherie.
Mais il y a aussi les choses sans prétention, qui sont ce qu’elles sont, mais qui semblent n’exister
qu’à demi : choses plates, ternes, mornes, qui ne trompent pas le regard mais qui le découragent
et le lassent ; non point des essences qui tendraient vainement à l’existence, mais plutôt des
existences sans essence, sans individualité et sans force, sans signification parce qu’elles ne
signifient pas. Ainsi, dans un monde industrialisé, les objets quotidiens que la production en série
interdit d’individualiser ; le concept y apparaît bien, qui en appelle à l’intelligence, mais à
l’intelligence seule ; il n’apparaît pas dans le sensible. Il y a donc du non-beau ; mais la référence
à l’expression autorise aussi à discerner du plus ou moins beau, selon la qualité du monde qu’en
s’exprimant l’objet exprime. Telle rose est belle, mais un paysage alpin exprime plus qu’une
rose ; et pareillement Watteau exprime plus que Boucher, et Mallarmé plus que Bainville, et
Ronchamp plus que la chapelle de Matisse. Que mesure ce plus ? La grandeur ou la profondeur
du monde ouvert par l’œuvre, en un mot le sublime. Qui mesure ce plus ? Encore une fois, le
sentiment, qui sait fort bien éprouver la différence entre ce qui plaît et ce qui ravit. Plus puissant
est l’être de l’objet, plus mystérieusement il nous parle, et plus loin il nous emporte... vers quel
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%