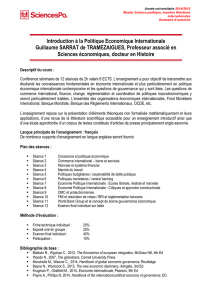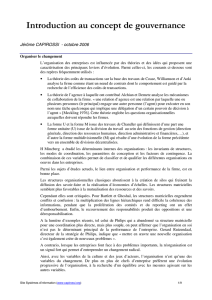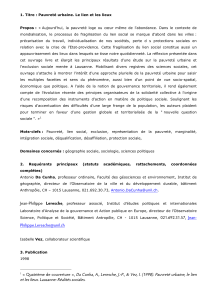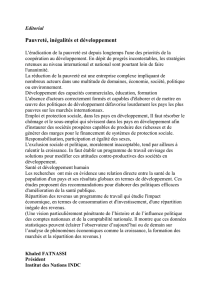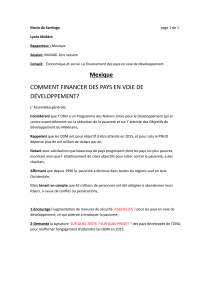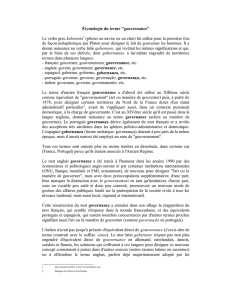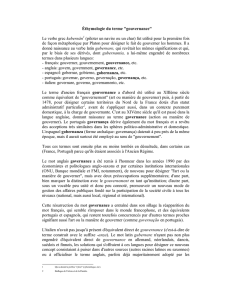the draft paper in RTF format - n

1
N-AERUS ANNUAL SEMINAR
BEYOND THE NEO-LIBERAL CONSENSUS ON URBAN DEVELOPMENT:
OTHER VOICES FROM EUROPE AND THE SOUTH
15-17 Mai 2003 ; Université Denis Diderot, Paris
GOUVERNANCE ET PAUVRETE URBAINES EN AFRIQUE
CONCEPTS POLYSEMIQUES ET DEBATS CONTRADICTOIRES
Catherine Baron
Lereps/Gres, Université de Toulouse 1
18 Avril 2003
Résumé en français
L’objectif de ce papier vise à décrypter certaines hypothèses à la base des modèles néo-
libéraux de gestion urbaine dans les pays du Sud, et notamment celles à l’origine de la
construction du concept de gouvernance. Ce concept sous-tend bon nombre de politiques,
notamment les politiques urbaines menées dans les villes du Sud et les programmes de lutte
contre la pauvreté en milieu urbain. Or, les interactions entre gouvernance et pauvreté
urbaines sont complexes. Si l’on raisonne en termes de « good governance », à l’instar
d’institutions internationales telles que la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire
International, on peut s’interroger, au-delà des discours, sur la compatibilité effective entre un
objectif de « good governance » et celui de lutte contre la pauvreté. Cependant, dans la
mesure où, selon nous, le concept de gouvernance n’est pas nécessairement assimilable à la
« good governance », quelle peut être son opérationnalité dans l’émergence de visions
alternatives de développement social urbain ? Les recherches menées sur la gouvernance par
des chercheurs travaillant sur le développement local, la gouvernance urbaine et le rôle du
pouvoir en économie, en proposant une vision de la gouvernance originale par rapport à celle
d’organismes tels que la Banque Mondiale, ne peuvent-elles être utilisées et valorisées pour
véhiculer une autre acception de la gouvernance, et penser différemment son articulation avec
la question complexe de la pauvreté et de l’exclusion en milieu urbain ?

2
Summary
The paper aims to decipher certain basic hypothesis of neo-liberal models of urban
management in developing countries, especially those concerning the concept of governance.
It is a concept underlying a good number of urban politics, notably those undertaken in cities
of developing countries and programs in the struggle against urban poverty. However, the
interactions between governance and poverty are complex. Viewing the problem in terms of
“good governance”, as International Institutions such as the World Bank and the International
Monetary Fund do, one is faced with the question of whether the objective of good
governance and that of poverty alleviation are, in fact, compatible. Nevertheless, if according
to us, the concept of governance is not necessarily equivalent to “good governance”, what role
can it possibly play in alternative visions of urban social development ? Research on
governance focusing on local development, urban governance and the role of power in the
field of Economics, propose an original vision of governance, different from that which is
presented by organizations like the World Bank. Can these visions be used to construct an
alternative meaning of the word “governance” and lead us to think differently about its link
with the complex question of poverty and urban exclusion?

3
Traduction de l’introduction
The globalization of economies has seen the emergence of new practices, new actors and
original representations in developing countries in the sphere of regulation in urban domains
(such as urban services, land ownership etc), at both the local and global levels. The term
governance, used by international organizations such as the World Bank, researchers in the
social sciences and experts working in the area of development, has aimed to take into
account these evolutions. It has become necessary to construct a term that allows us to analyse
the interactions between global dynamics, national considerations and local initiatives
simultaneously. At the same time, it should take into account the fact that the separation
between the public and private domains is becoming increasingly vague. Meanwhile, the way
international donors look at poverty in developmental politics has known a major turnaround.
For one, there is new emphasis on the participation of the population in the deliverance of
programs, as seen from the new “poverty reduction strategy papers”, initiated by actors of
development, with the support of those at the World Bank. The broad-based participation of
civil society and a certain restoration of the State reflect that the interaction between local and
international actors has become the basic conditions of a “good governance”. Nevertheless,
the various meanings of the term have rapidly generated much confusion and ambiguity about
what it really means. It is difficult to establish a unique definition of the ‘governance’. Even if
“good governance” is the dominant term, along with its underlying ideologies, methodologies
and theories, is it necessary that it is abandoned in order to establish new senses of
governance? Is it not possible for us to build up a new conception of what governance means?
The plurality of conceptions about governance is at the root of many debates, which we will
go on to examine by looking at three main issues.
First of all, the debate concerns the founding hypothesis of the different perceptions of
governance. The normative vision of governance, which has traditionally been the dominant
approach, seeks to decree the most efficient means of attaining economic growth (namely
liberalization, deregulation and privatization). Confronting this normative vision is the
positive approach, which leads us to question the different forms which consensus between
different actors can take, whilst taking into consideration not only the economic environment,
but also the social and political aspects of the society. Besides that, governance also presents
the challenge of rethinking the links between the State and the Market, involving a third actor,
the civil society. In the course of analyze of these interactions, supporters of "good
governance", who are implicitly also supporters of a predominant market, are placed in

4
confrontation with those who seek a hybridization of the three poles, namely the Market, the
State and Civil Society.
But the notion of hybridisation is itself ambiguous. Finally, there are different conceptions of
how the local and global levels interweave. One side presumes that the relationship between
local and global governance is conflictual, while the other side envisions the possibility of
having an intermediary level, which would allow us to think differently about how the local
and the global fit in together. We can approach this question by looking at the rules imposed
on the different actors at the urban level, and the degree of autonomy they are able to exercise
in spite of the rules. In one case, there is predominance of the rules drawn up at the global
level, in spite of supposed emphasis on the importance of participative democracy. In the
other, there is the possibility of negotiation of the rules between the actors. The perceptions of
urban development, which follow, are profoundly different.

5
La mondialisation des économies a eu pour corollaire l’émergence de nouvelles pratiques, de
nouveaux acteurs et de représentations originales dans les sociétés du Sud en matière de
régulation dans le domaine urbain (qu’il s’agisse des services urbains, du foncier, etc.), tant au
niveau local qu’à des échelles que l’on pourrait qualifier de globales. L’élaboration du terme
de gouvernance et sa diffusion depuis les années 1980 à la fois à travers les discours
d’institutions internationales telles que la Banque Mondiale, dans le milieu de la recherche en
sciences sociales et chez les praticiens du développement visaient à prendre en compte ces
mutations. Il convenait d’élaborer un terme qui permette d’analyser à la fois les interactions
entre les dynamiques transnationales, les logiques nationales et les initiatives locales, tout en
considérant la porosité croissante des frontières entre public et privé qui engendre de
nouveaux modes d’action publique, notamment dans le domaine des politiques urbaines.
Parallèlement, la prise en compte de la pauvreté dans les politiques de développement a connu
un revirement majeur, tout du moins au niveau des discours des bailleurs de fonds, en mettant
l’accent sur la nécessaire participation de la population dans l’élaboration des politiques de
lutte contre la pauvreté, comme il ressort des nouveaux « documents stratégiques de réduction
de la pauvreté » élaborés par les acteurs du développement, sous l’impulsion et l’approbation
de la Banque Mondiale. Cette dimension participative et une certaine forme de réhabilitation
de l’Etat dont les règles reflètent les interactions entre acteurs locaux et internationaux sont
devenues les conditions à la base d’une « good governance », traduite par « bonne
gouvernance ». Cependant, la polysémie du terme a très rapidement engendré des confusions
de sens et des ambiguïtés. Elle rend difficile une définition unique, stabilisée, de la
gouvernance. Même si le terme de « bonne gouvernance » et ses présupposés idéologiques,
méthodologiques et théoriques dominent, faut-il pour autant abandonner cette notion alors
qu’elle peut être véhiculée sous d’autres acceptions ? La pluralité des conceptions de la
gouvernance renvoie à des débats que nous aborderons à travers différents points. Tout
d’abord, le débat porte sur les hypothèses fondatrices des différentes perceptions de la
gouvernance. On constate une opposition entre une vision normative de la gouvernance qui
édicte les moyens efficaces pour accéder à la croissance économique (ces moyens étant la
libéralisation du commerce, la déréglementation et la privatisation) et une approche que l’on
pourrait qualifier de « positive » qui amène à s’interroger sur les formes de consensus
possibles entre les différentes logiques d’acteurs compte tenu de l’environnement
économique, mais aussi social et politique qui caractérise une société considérée. Par ailleurs,
la gouvernance pose, en des termes nouveaux, la problématique des liens entre l’Etat et le
Marché, tout en tenant compte de ce troisième acteur que constitue la société civile. L’analyse
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%