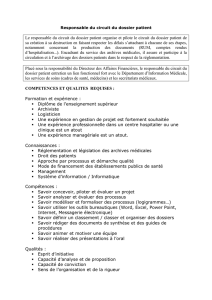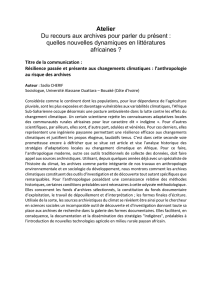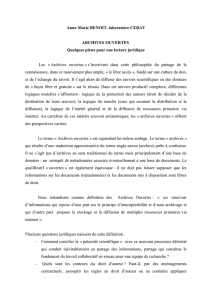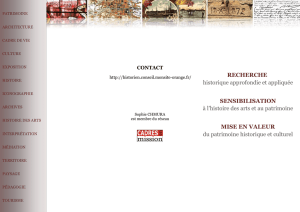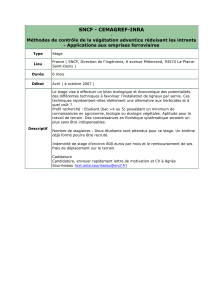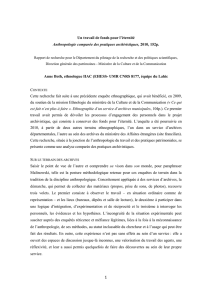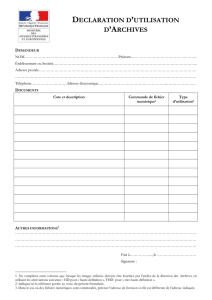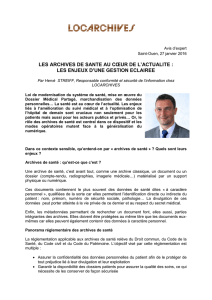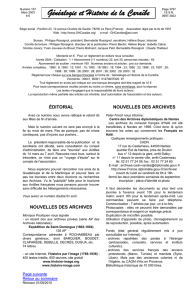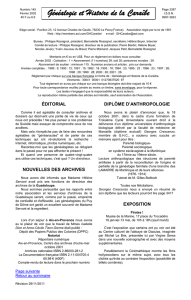Pistes de recherches dans les fonds des Archives

UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DANS LA GUERRE : LA SNCF, 1939-1945
Première partie : Quelles archives aujourd’hui pour l’histoire
© AHICF et auteurs, mai 2001
Pistes de recherches dans les fonds des Archives nationales et départementales.
L’apport du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale
au travers notamment de la collection Durand
Les pistes de recherche dans les différents fonds des Archives nationales et départementales sont présentées
ici selon trois axes :
- des éclairages sur les fonds conservés au Centre historique des Archives nationales à Paris1 ;
- un aperçu des différentes sources disponibles aux Archives départementales ;
- une présentation plus approfondie du fonds du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la
collection Durand.
_______________
1. 60, rue des Francs-Bourgeois, 75141 Paris Cedex. Tél. : 01 40 27 62 23. Site internet :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/CHAN/CHANmain.htm
Accueil du public au Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales, 11, rue des Quatre-Fils, 75003 Paris. Tél. : 01 40 27 64 19.
Christèle Noulet
Aperçu des fonds publics conservés aux Archives nationales
Cette description des documents sur l’histoire de la SNCF conservés aux Archives nationales à Paris se limite
aux fonds publics de l’administration centrale de l’État. Cela ne signifie pas que les archives privées déposées
dans ce même Centre ne peuvent pas intéresser l’histoire des chemins de fer pendant la Seconde Guerre
mondiale1.
Les autres centres des Archives nationales disposent également de fonds intéressant l’histoire ferroviaire
comme par exemple le Centre des archives du monde du travail, installé à Roubaix, qui mène une politique de
collecte d’archives d’entreprises2. Quant au Centre des archives contemporaines à Fontainebleau, il conserve
des versements administratifs complémentaires de ceux des Archives nationales à Paris. Ses fonds portent
plutôt sur les travaux effectués sur les voies et sur les relations avec les autorités d’occupation3.
Les documents conservés aux Archives nationales à Paris qui traitent de l’histoire ferroviaire pendant la
Seconde Guerre mondiale nécessitent un gros travail de dépouillement. Il est, en effet, nécessaire de consulter
les dossiers connexes à l’histoire ferroviaire comme par exemple des documents sur les attentats, les convois,
la Résistance ou encore les sabotages. Les sources disponibles sur ce sujet sont également dispersées dans
plusieurs séries des Archives nationales, d’où la nécessité de dépouiller plusieurs inventaires de fonds
d’archives. En dépit de cet éparpillement, on peut distinguer plusieurs angles de recherche : les fonds
provenant des institutions issues de l’armistice et les archives allemandes, puis le fonds du secrétariat d’État
aux Communications et, enfin, les archives de la police.
LES FONDS PROVENANT DES INSTITUTIONS ISSUES DE L’ARMISTICE ET DES ARCHIVES ALLEMANDES
La Convention d’armistice du 22 juin 1940, dans son article 13, prévoit pour le haut commandement allemand
la mise à disposition des “ moyens et des voies de communications de toute nature ”. Il est également stipulé
que les infrastructures françaises sont “ à la disposition pleine et entière du chef allemand des transports ”.
Suite à la signature de la Convention d’armistice se sont mises en place plusieurs institutions administratives
chargées de sa mise en application. Elles ont ainsi joué un rôle direct dans la politique des transports pendant
la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit de la délégation française auprès de la commission allemande d’armistice
et de la délégation française auprès de la commission italienne d’armistice. Ces deux délégations étaient
assistées de la direction des services de l’armistice, organe d’études et de liaison. Les archives de cette
direction et des délégations françaises auprès des commissions allemande et italienne d’armistice sont
classées dans la sous-série AJ41.
À ces institutions vient s’ajouter, en 1941, la délégation générale aux relations économiques franco-allemandes
qui dépend du secrétariat d’État à l’Économie nationale et aux Finances4 et dont les dossiers ont été versés
aux Archives nationales et cotés F 37/1 à 77. Elle est notamment chargée des relations avec la section
économique de l’administration militaire en France. Ses attributions recoupent donc celles de la délégation
française auprès de la commission allemande d’armistice. Les deux fonds sont, par conséquent, -
complémentaires.
Pendant la période de l’Occupation se sont, également, mis en place des services allemands dont les dossiers
sont conservés aux Archives nationales à Paris sous la cotation AJ40. Les questions de transport ont été

UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DANS LA GUERRE : LA SNCF, 1939-1945
Première partie : Quelles archives aujourd’hui pour l’histoire
© AHICF et auteurs, mai 2001
traitées, plus particulièrement, par le commandement militaire allemand en France et par la délégation
allemande près de la commission d’armistice.
Même s’ils proviennent de services différents, ces fonds ont été regroupés ici parce qu’ils traitent de
thématiques communes avec, tout d’abord, l’exploitation des voies ferrées qui est évoquée sous l’angle de la
gestion des horaires ou de la réouverture de voies. Viennent ensuite les travaux à exécuter sur les
infrastructures, notamment ceux pour le compte des Allemands, les livraisons et les réquisitions de matériel à
destination de l’Allemagne et les différends financiers avec l’Allemagne pour le paiement des transports
effectués pour le compte de l’occupant.
ARCHIVES DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUX COMMUNICATIONS
Le fonds du secrétariat d’État aux Communications coté dans la sous-série F14 au Centre historique des
Archives nationales est primordial dans l’histoire du chemin de fer pendant la Seconde Guerre mondiale, en
tant qu’archives de l’administration de tutelle de la SNCF. Depuis septembre 1940, trois secrétaires d’État s’y
sont succédé : Jean Berthelot de septembre 1940 à 1942 puis un intermède avec Robert Gibrat, d’avril à
novembre 1942, et, enfin, à partir de novembre 1942, Jean Bichelonne. Les archives du secrétariat d’État aux
Communications se scindent en deux grands groupes : les archives de cabinet et les dossiers techniques.
Le fonds du cabinet porte, en premier lieu, sur la SNCF, en particulier sur ses relations avec les autorités
d’occupation. En effet, le cabinet du secrétariat d’État aux Communications s’est intéressé aux négociations
des accords et conventions entre la SNCF et les Allemands. Toujours dans le cadre des relations entre
la SNCF et les autorités d’occupation, le cabinet essayait aussi de gérer les problèmes de règlements
financiers des transports effectués pour le compte des Allemands. Enfin, il tentait de contrôler les prélèvements
de matériels et de matières premières opérés par les Allemands sur les stocks de la SNCF.
Outre les relations entre la SNCF et les autorités allemandes, les archives de cabinet sont aussi constituées de
dossiers sur les sabotages et bombardements. Enfin, dans ce fonds du cabinet sont également conservés des
rapports d’activité de la SNCF pour les années 1940 à 1942 ainsi que des bulletins quotidiens.
Les travaux sur les voies ferrées sont abordés dans les dossiers techniques. Ainsi, ont été versés aux Archives
nationales les états des destructions opérées pendant la guerre 1939-1940, les dossiers techniques de
reconstruction des voies, des gares et ateliers sinistrés, les programmes de travaux et les accords des
autorités d’occupation pour l’exécution de ces travaux. Ces dossiers techniques de reconstruction ou de
réaménagement sont classés soit par région, soit par réseau. Ils peuvent également porter sur des voies
d’intérêt local.
Les dossiers techniques de travaux sont composés de documents d’une typologie très particulière. Aux
rapports établis par les ingénieurs sont souvent associés de très beaux plans, dressés par ces mêmes
ingénieurs.
Concernant les destructions liées à la Libération et les travaux de reconstruction, il existe des dossiers
techniques mais aussi une collection iconographique sur la Reconstruction. En effet, Raoul Dautry, ministre de
la Reconstruction et de l’Urbanisme à la Libération, a lancé une vaste campagne de photographies portant sur
l’ensemble du territoire français. Les photographes étaient chargés à la fois de prendre des clichés de l’état des
destructions mais également de l’état d’avancement des travaux de reconstruction. Ces clichés ont été
numérisés et décrits dans une base de données appelée “ Reconstruire la France ”. Dans ce corpus
photographique les travaux de reconstruction des gares occupent, notamment, une place non négligeable.
LES ARCHIVES DE LA POLICE
Les archives de la police classées dans la sous-série F7 recèlent aussi des renseignements sur la SNCF et,
plus largement, sur l’histoire ferroviaire au travers de plusieurs types de dossiers.
Dans les dossiers d’organisation et de fonctionnement du corps des gardes de communication sont rassemblés
des renseignements sur la SNCF. En effet, les gardes de communication étaient chargés de surveiller les voies
et les ateliers de l’entreprise. Afin de définir clairement leurs missions, un projet de convention avec la SNCF a
été élaboré. Des documents sur les négociations liées à la signature de cette convention sont classés dans les
fonds de la police.
Les archives de l’inspection générale des camps sont composées de dossiers non seulement sur les centres
d’internement mais aussi sur l’organisation du transfert des internés entre camps et sur l’organisation des
convois de déportation vers l’Allemagne. Dans ces dossiers apparaît la délégation technique de la SNCF à
Vichy installée à l’hôtel Métropole. Au vu des échanges de correspondances, il semble que cette direction ait
été chargée, plus particulièrement, de fixer les horaires de départ et de passage dans les gares des trains ou
d’établir la liste des éventuelles gares d’arrêts des convois.
Dans le fonds des Renseignements généraux, il est également possible de glaner des informations sur
la SNCF pendant la période de l’Occupation. Les RG avaient, par exemple, rassemblé toute une
documentation constituée de notes et d’articles de presse sur le fonctionnement et l’organisation de la SNCF.

UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DANS LA GUERRE : LA SNCF, 1939-1945
Première partie : Quelles archives aujourd’hui pour l’histoire
© AHICF et auteurs, mai 2001
En outre, dans ce même fonds, les dossiers sur les sabotages et attentats permettent de reconstituer l’histoire
de la Résistance dans l’entreprise comme celui sur l’opération montée en gare de Clermont-Ferrand par les
Francs-Tireurs.
Enfin, la lecture des inventaires de la sous-série F7 conduit parfois à certaines découvertes comme, par
exemple, les registres de main courante du commissariat de la gare du Nord de Paris. Ceux-ci représentent un
véritable témoignage sur les événements qui rythment la vie quotidienne d’une gare, à savoir les actes de
fraudes, de vols de vélos ou de sacs à main, mais aussi des événements plus particuliers dont quelques
passages suivent5 :
Le 27 août 1943 : “ À 21 h 30, à destination de Brême, sont partis travailler 112 ouvriers permissionnaires des
usines du Reich. Il y a de nombreuses défections : 600 ouvriers étaient arrivés il y a douze jours. [...] Le moral
de ces ouvriers était très bas. Ils repartent en croyant que la guerre serait bientôt terminée. ”
Le 14 septembre 1943 : “ Un acte de malveillance (rail déboulonné) a été commis sur la ligne Compiègne-
Soissons. Un train de troupes a déraillé, obstruant deux voies. ”
Le 17 septembre 1943 : “ À 11 h 45, sont arrivés en gare du Nord, 80 Juifs et Juives venant de Toulouse par
train messagerie. Deux wagons voyageurs assuraient le transport sous la surveillance des officiers allemands.
Ces Juifs ont pris place dans cinq autocars à destination du camp de Drancy. ”
Au terme de cette description, on peut constater que les pistes de recherches aux Archives nationales, sur
l’histoire de la SNCF pendant la Seconde Guerre, sont diverses : services de l’armistice, archives allemandes,
secrétariat d’État aux Communications, police. En outre, les dossiers abordent des problématiques multiples
comme les relations avec les autorités d’occupation, l’exploitation ferroviaire, les travaux, les prélèvements et
réquisitions allemandes, la surveillance policière des voies, les sabotages et même la vie quotidienne dans les
gares.
Les fonds de la période de la Seconde Guerre mondiale conservés au Centre historique des Archives
nationales sont, pour la plupart, librement communicables, soit par arrêtés de dérogation générale6, soit parce
que le délai trentenaire est expiré.
Ces fonds sont donc précieux pour toute étude sur la période de l’Occupation, cependant il convient de les
compléter par un état des sources conservées dans les Archives départementales.
_______________
1. Par exemple sont déposés, au Centre historique des Archives nationales, les papiers de Raoul Dautry.
2. CAMT, 78, bd du Général-Leclerc, BP 405, 59057 Roubaix Cedex 1. Tél. : 03 20 65 38 00. Sont notamment conservés les fonds de la
Compagnie générale de construction de locomotives (170 AQ) et de la Compagnie du chemin de fer du Nord (202 AQ). Site internet :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr
3. Centre des Archives contemporaines, 2, rue des Archives, 77300 Fontainebleau. Tél. : 01 64 31 73 00.
4. Il est important de signaler ici que le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, qui conserve ses propres archives, détient
également des fonds susceptibles d’intéresser l’histoire ferroviaire pendant la Seconde Guerre mondiale.
5. Ces passages ont été extraits du registre de main courante du commissariat de la gare du Nord de l’année 1943.
6. Il s’agit principalement de l’arrêté du 11 octobre 1999 paru au Journal officiel du 17 novembre 1999 (p. 17074-17076).
Isabelle Neuschwander
Les fonds départementaux
Cette partie de la communication porte plus spécifiquement sur les fonds d’archives conservés dans les
services d’archives départementaux. Elle ne constitue pas un recensement exhaustif des sources locales
relatives à l’histoire de la SNCF et du transport ferroviaire durant la Seconde Guerre mondiale mais a pour
objet d’offrir au chercheur quelques pistes de recherche à partir de la lecture du guide des sources de la
Seconde Guerre mondiale en France et d’exemples précis obligeamment fournis par des collègues des
Archives départementales1.
Ainsi que nous avons pu le constater précédemment, dans la mesure où les archives historiques de la SNCF
sont conservées dans des services autonomes, les documents conservés dans les services d’archives publics
sur ce sujet constituent des sources annexes et éclatées, complémentaires du fonds primordial. Toute
recherche devra, par voie de conséquence, être précédée d’un travail de dépouillement précis à travers
l’ensemble des fonds relatifs à la Seconde Guerre mondiale conservés dans les services d’Archives
départementales. Il est possible cependant d’attirer l’attention des chercheurs sur quelques fonds susceptibles
de fournir des sources certes périphériques mais prometteuses : les archives des services de l’État, les
archives privées et, en transition avec l’intervention suivante, les archives locales du Comité d’histoire de la
Deuxième Guerre mondiale.

UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DANS LA GUERRE : LA SNCF, 1939-1945
Première partie : Quelles archives aujourd’hui pour l’histoire
© AHICF et auteurs, mai 2001
LES FONDS DES SERVICES DE L’ÉTAT DANS LES DÉPARTEMENTS
Ces archives, classées dans la série W, constituent en département le noyau central de toute recherche sur la
Seconde Guerre mondiale. Il s’agit tout d’abord des archives provenant des services préfectoraux et, en
premier lieu, du cabinet du préfet, des services de police et de gendarmerie et d’administrations très diverses,
tels le commissariat à la main-d’œuvre, le commissariat à la reconstruction immobilière, le service de
reconstruction s’occupant des dommages de guerre, le service des Ponts et Chaussées... Composées dans la
plupart des cas de documents primaires ou de documents préparatoires à l’élaboration de synthèses destinées
aux ministères, ces sources locales éclairent de façon remarquable les archives centrales de l’État, tout en
étant d’une nature identique. Malgré les diversités locales, la lecture des instruments de recherche fait
apparaître quelques thématiques récurrentes : la question de la police de la circulation, la surveillance des
agents et la répression de la résistance, les destructions entraînées par les bombardements et sabotages, la
réquisition de la main-d’œuvre.
Très connus mais toujours très utiles, les rapports des préfets constituent la première source de recherche.
Établis à partir de rapports très détaillés des services administratifs et des sous-préfets, ces rapports traitent de
l’état d’esprit de la population, des actes de sabotage, de l’état du trafic, des relations avec les autorités
allemandes. Ils offrent des indications générales et des pistes de recherche vers d’autres fonds2.
Dans le domaine de la police de la circulation, les archives préfectorales sont riches de documents relatifs à la
gestion des transports : plans d’évacuation ferroviaires et routiers, plans de transports, plans de restriction du
trafic des voyageurs, cartes de circulation, brochures techniques sur l’état des réseaux, autorisation de
circulation des trains...
Au sein des archives préfectorales, les documents relatifs aux destructions causées par les actes de résistance
et par les bombardements sont certainement les sources les plus fréquemment rencontrées. Les dossiers
concernant ces faits ne sont pas ou très rarement rassemblés dans une collection unique. Ils sont mêlés à la
masse des dossiers relatifs aux actes dits de sabotage ou de terrorisme. Cependant, les sabotages de voies
ferrées et de centres ferroviaires peuvent constituer, dans certains départements, une proportion notable de
ces dossiers en fonction de l’importance du trafic ferroviaire et du niveau d’activité des mouvements ou réseaux
de résistance du département. L’intérêt de ce type de documents est majeur, par rapport aux documents
centraux de l’État, du fait de leur précision et de leur diversité. Le chercheur pourra parfois être confronté à un
dossier complet par acte de sabotage comprenant, par exemple : une note téléphonique de la gendarmerie
adressée au préfet pour signaler le sabotage ; un rapport du sous-préfet au préfet ; un rapport de gendarmerie
avec croquis du sabotage accompagné parfois de photographies ; un rapport du préfet à la direction générale
de la police à Vichy ; des rapports des Renseignements généraux3. La résistance individuelle peut également
apparaître au travers d’archives isolées, tels dans la Somme ces documents consacrés en 1941 à l’arrestation
du directeur adjoint des Chemins de fer économiques pour détention de tracts anglais4. Les bombardements
des voies ferrées par les Alliés et l’ampleur des destructions peuvent également être mesurés au travers de
multiples rapports.
Le personnel employé par la SNCF faisant l’objet d’une surveillance étroite, par crainte de la propagande
communiste, de nombreux documents se rapportent à ce sujet5 ainsi qu’au corps des gardes de
communication. La réquisition de main-d’œuvre, à l’usage de la SNCF ou de l’occupant allemand, constitue
également un sujet de préoccupation des autorités préfectorales. Le STO peut apparaître au travers de
documents administratifs relatifs au coût de la main-d’œuvre, de demandes d’exemption pour des agents de
la SNCF pour des besoins de service, de réquisitions d’ouvriers au profit de la SNCF et de nombreuses
réquisitions allemandes. On peut citer par exemple ce dossier dans le département de la Somme concernant
l’embauche par la SNCF d’un contingent de jeunes gens destinés à recevoir une formation professionnelle
accélérée afin d’être envoyés en Allemagne en 19426.
Pour ce qui concerne la question des déportations, le chercheur pourra parfois trouver, dans les départements
dans lesquels étaient situés des camps d’internement, des documents relatifs à l’organisation des convois :
correspondances entre les autorités préfectorales et la SNCF, demandes de mise à disposition de wagons ou
de places de trains pour des transferts entre camps7. Un recensement exhaustif de ce type de documents
serait très vraisemblablement susceptible de faire surgir des sources encore inédites, bien que certainement
éparses.
LES FONDS ENTRÉS PAR VOIE EXTRAORDINAIRE
Ce deuxième groupe rassemble les archives entrées dans les services par la voie extraordinaire, à la
différence des archives publiques, et émanant principalement des personnes privées. Ces archives constituent
des sources historiques précieuses et complémentaires des archives publiques conservées principalement
dans la série J des Archives départementales. On ne saurait que trop conseiller aux chercheurs la lecture des
inventaires consacrés à celle-ci. Quelques exemples illustreront ce propos :
- aux Archives départementales du Gard, des documents sur l’occupation et la libération du département

UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DANS LA GUERRE : LA SNCF, 1939-1945
Première partie : Quelles archives aujourd’hui pour l’histoire
© AHICF et auteurs, mai 2001
donnés par un inspecteur de la SNCF, membre du Comité départemental de Libération, chargé en particulier
de l’épuration8 ;
- aux Archives départementales de la Nièvre, un récit de particulier racontant la collision entre deux trains de
transport de troupes allemandes, le 22 août 19449. Un remarquable fonds photographique relatif aux
destructions provoquées par le bombardement de Nevers, lancé le 16 juillet 1944 afin de détruire le centre
ferroviaire de Saint-Caize, y est également disponible10 ;
— aux Archives départementales de la Dordogne, une chronologie succincte des faits concernant la SNCF de
janvier à août 1944, établie à partir des archives générales de la SNCF11.
Les archives orales conservées dans les services d’archives français ne sont certainement pas à négliger. Le
témoignage oral de cheminots constitue par exemple une source documentaire tout à fait remarquable, dont la
collecte et la conservation doivent être encouragées. La publication prochaine par les Archives nationales, le
Service historique de l’Armée de terre et l’Institut des archives sonores d’un Guide du patrimoine sonore et
audiovisuel français devrait offrir une première approche de l’état des collections en France12.
Enfin, il faut consacrer une place à part aux archives locales du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre
mondiale, sur lequel Patricia Gillet s’attardera plus longuement. En effet, les correspondants locaux du Comité,
qui ont parcouru des masses considérables d’archives, ont souvent déposé soit un double de leur travail, soit
leurs documents préparatoires. Ces documents peuvent servir de clés d’accès, notamment aux fonds
préfectoraux. À titre d’exemple, on peut citer le fonds du correspondant d’histoire sur la Seconde Guerre
mondiale de l’Aisne conservé aux Archives départementales de l’Aisne au sein duquel figurent les fichiers
chronologiques des bombardements et mitraillages signalant la date et l’heure des destructions ainsi que
l’ampleur des dégâts, des listes de sabotages par réseaux de résistance et par lieux13...
Il s’agissait ici de donner un bref aperçu des fonds des Archives départementales et d’encourager les
chercheurs à explorer les richesses de leurs fonds. Ils devront veiller cependant à ne pas négliger les autres
services d’archives territoriales, notamment les archives communales. Les recherches sur l’histoire de la SNCF
durant la Seconde Guerre mondiale peuvent s’y révéler fructueuses dans le cas de communes ayant été le
siège de nœuds ferroviaires ou ayant hébergé des centres et installations ferroviaires. On peut également
penser que gisent çà et là chez les particuliers des sources méconnues, rares, voire uniques : tracts,
photographies, journaux clandestins, témoignages... Il importe d’encourager leurs possesseurs à en assurer la
préservation et à mettre en œuvre les conditions de leur exploitation historique.
_______________
1. La Seconde Guerre mondiale. Guide des sources conservées en France, 1939-1945, Paris, Archives nationales, 1994, 1 220 p., pl.
Je voudrais également remercier chaleureusement pour leur aide Frédérique Pilleboue, directeur des AD de l’Aisne, Maïté Etchechoury,
directeur des AD de la Dordogne, Alain Venturini, directeur des AD du Gard, Luc Forlives, directeur des AD de l’Indre-et-Loire, Sandrine
Cunnac, conservateur aux AD de l’Indre, Martine Salmon-Dalas, directeur des AD du Lot-et-Garonne, et Pascal de Toffoli, Anne-Marie
Chagny, directeur des AD de la Nièvre, Florence Charpentier, attachée de conservation aux AD de la Somme.
2. La collection des rapports mensuels des préfets est conservée aux Archives nationales sous la cote F 1cIII 1135-1198 et a été
microfilmée. Cette source peut constituer une première approche avant de se tourner vers la collection départementale.
3. Exemple tiré à partir de dossiers conservés aux AD Somme, 26 W 625 (versement du cabinet du préfet).
4. Ibid., AD Somme 26 W 101.
5. Ibid., AD Somme 26 W 55, Surveillance du personnel employé par la SNCF ; AD Indre-et-Loire 120 W 5, Recrutement à la SNCF
(versement du cabinet du préfet).
6. Ibid., AD Somme 99 R 333528 (versement du commissariat général de la main-d’œuvre).
7. Ibid., AD Indre-et-Loire 120 W 5, Camp de La Lande (versement de la division de l’administration et de la police générale).
8. AD Gard 93 J 1-7 Fonds Pierre Mazier, 1845-1953.
9. AD Nièvre récit de F. Lechat, 1 J 148.
10. AD Nièvre, Album Bélile.
11. AD Dordogne 14 J 4.
12. On peut signaler, à titre d’information, la collection de témoignages oraux constituée par le Conseil régional de Picardie sous le titre
Mémoire vivante de Picardie, déposée aux AD Somme.
13. AD Aisne, archives de M. Berthiault, correspondant du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, J 1433-1461 et
notamment J 1459-1462, fichier chronologique des bombardements et mitraillages, et J 1461, fichier chronologique de la Résistance.
Patricia Gillet
L’apport des archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre Mondiale à l’histoire de la
SNCF
Le Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale est né en décembre 1951 de la fusion de la Commission
d’histoire de l’Occupation et de la Libération de la France et du Comité d’histoire de la Guerre, créés
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%