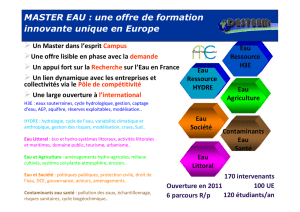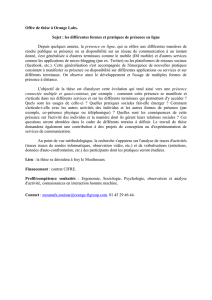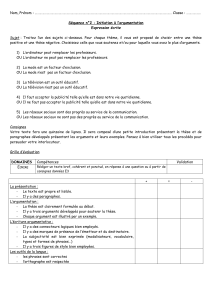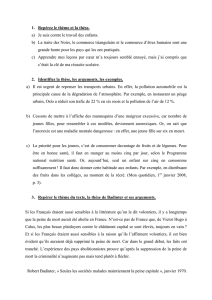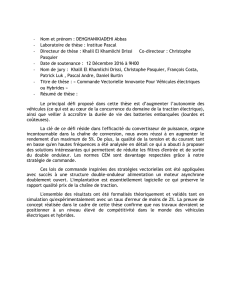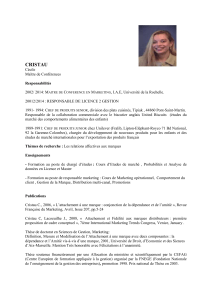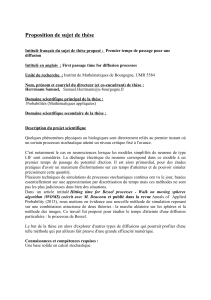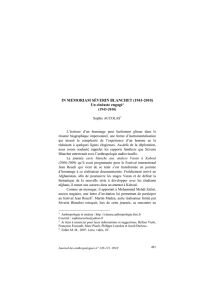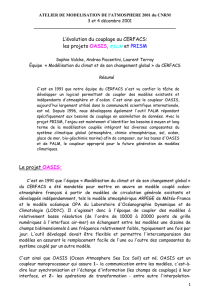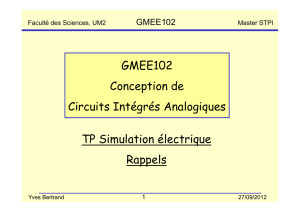cr21-03-03

COMPTE RENDU DU P’TIT DEJ-ENTREPRISE DU 21/03/03
“ Recherche privée, recherche publique : quelles différences ?? ”
Les intervenants :
- Michel LEBRUN : professeur en physiologie végétale (UM2)- expérience dans le
privé (Rhone-Poulenc).
- Séverin PISTRE : maître de conférence en hydrogéologie (UM2) - Jeune
créateur d’entreprise (Hydrophys).
- Luc YRIARTE : docteur en informatique. Embauché chez Palm depuis 3 ans, en
tant qu’ingénieur.
Début de séance: 8h45
I / Témoignage de Luc YRIARTE (Palm)
Son parcours :
Après un post-doc en entreprise de deux années pendant lesquelles il a surtout
été chargé d’améliorer les techniques existantes, Luc a été embauché chez Palm au
service Recherche & Développement (R&D).
En passant du milieu strictement académique (thèse) au privé, ce sont les
contraintes de temps et les exigences du marketing qui l’ont le plus marquées. De
plus, pour Luc, les réelles différences entre ces secteurs sont que, dans le privé,
les docteurs ont un degré de liberté restreint, voire nul, par rapport à leur voie de
recherche. Son travail, au sein de Palm, relève beaucoup plus de l’ingénierie que de
la recherche et toujours soumis à la pression des délais.
Ce que lui a apporté l’expérience de la thèse par rapport aux ingénieurs :
Bien qu’il admette que les ingénieurs sont “ mieux vus ” que les docteurs en
entreprise, il reconnaît que l’expérience de la thèse lui a été très profitable. En
plus, d’avoir acquis des compétences techniques, des connaissances pointues, le
doctorat lui a appris à gérer des difficultés que ne connaissent pas les ingénieurs.
Le plus du privé : travailler avec des collaborateurs de bon niveau
Le moins : ne pas choisir sa voie de recherche
II- Témoignage de Michel LEBRUN (UM2)
Son parcours :
Après une thèse en biologie moléculaire des plantes (mais avant la soutenance),
Michel a bénéficié pendant 3 ans d’un poste d’assistant à l’université de Limoges. Il
a ensuite rejoint les rangs du secteur privé grâce Rhône-Poulenc. Cette entreprise

était à la recherche de compétences que seuls les laboratoires publics étaient
capables de fournir.
Il y 8 ans, on lui a confié un poste de professeur et depuis peu, il est responsable
d'un département de l'INRA.
La finalité de cet institut est la finalité de ses recherches. Contrairement au
CNRS, où l’activité scientifique n’est valorisée que par des publications (ou
presque), l’INRA a un objectif matériel. Les chercheurs bénéficient de ce fait
d’une faible marge de manœuvre.
Les réelles différences :
Secteur académique
Entreprises
Le projet : en
combien de
temps ?
- Temps long
- Pas de jugement
terminal bien fixé
- temps court
quels moyens ?
- moyen limité
- moyen souvent illimité
Evolution?
- Croisement possible
- Evolution lente
- A long terme, les
chercheurs finissent
par devenir des
directeurs de projet
La recherche n’est qu’une étape : une
fois les compétences scientifiques et
techniques exploitées, le chercheur
doit pouvoir s’intégrer dans une autre
équipe (marketing, …)
Difficile de se spécialiser
Cependant, il existe une continuité entre public et privé :
Le fait que les chercheurs dirigent des projets traduit le prolongement entre ces
secteurs. En effet, l’objectif de l’entreprise est d’innover. Pour ce faire, il lui faut
capitaliser sur la recherche dite fondamentale. Celle-ci forme les chercheurs -
futurs employés. Ces derniers ont les compétences requises, sont la source des
innovations et forment un réseau exploité par l’entreprise.
Le privé valorise, dans son domaine, ce qui sort de l’académique. Il y a une
interaction permanente
III- Témoignage de Séverin PISTRE (UM2)
Son parcours :
Après une thèse soutenue en 1992, Séverin est embauché pendant en tant
qu’ingénieur chez Elf. Il revient au secteur public par le biais de postes d’ATER.
Dès 1995, il est recruté à l’UM2 comme maître de conférence en hydrogéologie.
Depuis 1999, il projette de créer une entreprise. C’est en 2003, avec un jeune
thésard, que son projet voit le jour.
La recherche publique fait appel au privé :
Il y a une dizaine d’années, le ministère de la recherche allouait environ 8000
francs par chercheur pour leur activité. Séverin nous avoue que cette somme ne
couvrait que les frais de déplacement pour les congrès et autres. Il était difficile
de développer par ces mêmes crédits l’acquisition des données. Face à ce manque

de financement publique, les chercheurs se tournent vers le privé ou vers les
appels d’offres régionales et autres.
Cependant, cette vision des financements est décalée selon les laboratoires. Ceux
qui affichent une finalité de recherche appliquée se font aspirés par les
entreprises. En revanche, les laboratoires “ purement scientifique ”, avec pour but
de faire avancer les connaissances ne bénéficient guère de ces crédits.
Etre fonctionnaire et créer son entreprise :
En tant que fonctionnaire, on peut demander à être “ détaché ” de ces fonctions
pour plusieurs mois, voire année, afin de créer son entreprise, et ce avec la
certitude d’un retour vers le public.
Il est également possible de libérer 1/5 de son temps, pour un salaire égal. Le
cumul des salaires privés et publiques est-il possible.
Pourquoi un chercheur dans le public choisit-il de créer son entreprise ?:
Les tâches administratives, la gestion et direction des projets, le sur-plus des
heures d’enseignement sont autant de contraintes qui poussent à créer son
entreprise pour pouvoir y faire de la recherche !!!
IV- Conclusion :
Le jeune docteur peut être appelé à devenir employé avec ce que cela implique.
Outre ces compétences scientifiques et techniques, l’entreprise lui demande
rapidité d’adaptation et d’évolution qui répondent aux exigences marketing.
Le privé valorise le public. Il n’y a pas d’opposition entre ces deux types de
recherche mais des échelles de temps différentes, des buts clairement distincts.
LE PETIT MOT DES ORGANISATEURS :
Le petit questionnaire que vous nous avez rendu permet de faire le point pour
avancer et mieux orienter les thèmes des futurs p’tits déj-entreprise.
- L'équipe "P'tit Déj-Entreprise" de CONTACT –
1
/
3
100%