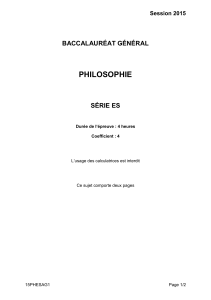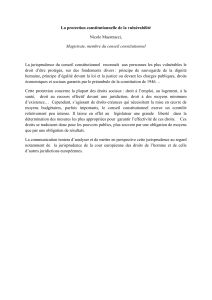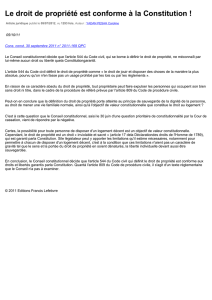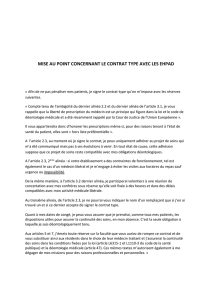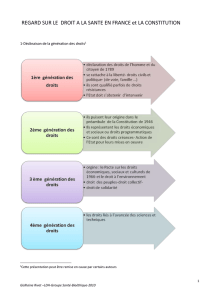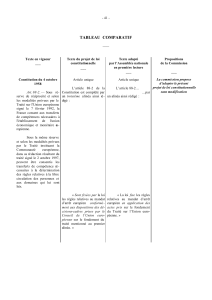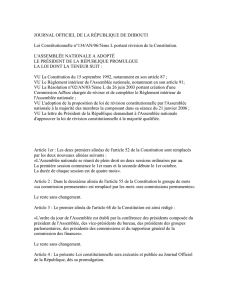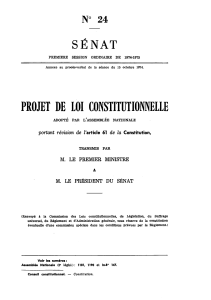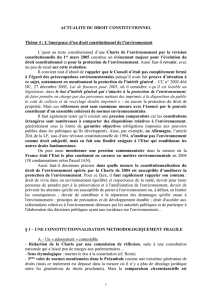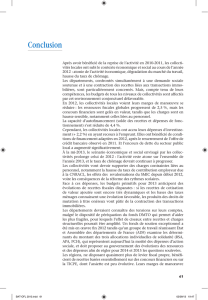obs_gvt_suite_saisin.. - Agir ensemble contre le Chômage

J.O n° 293 du 19 décembre 2003 page 21691
LOIS
Conseil constitutionnel
Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi portant décentralisation en
matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité
NOR: CSCL0307018X
Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, d’un recours dirigé contre
la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu
minimum d’activité, adoptée le 10 décembre 2003.
Les requérants articulent à l’encontre des articles 2, 4, 6, 14 et 43 de la loi différents griefs qui
appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
*
* *
I. - Sur les articles 2, 4, 6 et 14
A. - Les articles 2, 6 et 14 de la loi déférée procèdent, avec d’autres, à la décentralisation du
revenu minimum d’insertion. L’article 2, qui abroge le 3° de l’article L. 121-7 du code de
l’action sociale et des familles ainsi que l’article L. 262-4 du même code, décide l’abrogation
des dispositions qui mettent aujourd’hui le financement de l’allocation de revenu minimum
d’insertion à la charge de l’Etat. Les articles 6 et 14, qui modifient différents articles du code
de l’action sociale et des familles en substituant au représentant de l’Etat dans le département
le président du conseil général, ont pour effet de transférer au département la responsabilité de
la mise en oeuvre du dispositif du revenu minimm d’insertion et d’habiliter le président du
conseil général à prendre les décisions individuelles qui s’y rapportent. L’article 4, pour sa
part, prévoit que les charges résultant pour les départements des transfert et création de
compétences font l’objet d’une compensation selon les conditions fixées par la loi de
finances.
A l’encontre de ces dispositions, les auteurs du recours font d’abord valoir qu’elles
méconnaîtraient les termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du
27 octobre 1946 et qu’elles seraient contraires au principe d’égalité. Ils soutiennent également
que les dispositions de l’article 4 de la loi déférée seraient contraires aux articles 72 et 72-2 de
la Constitution tels qu’ils résultent de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.
B. - Ces divers griefs ne sont pas fondés.
1. En premier lieu, les dispositions critiquées de la loi déférée ne portent pas atteinte aux
exigences constitutionnelles issues des dixième et onzième alinéas du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 et ne peuvent être davantage jugées contraires au principe
constitutionnel d’égalité.

Le dixième alinéa du Préambule de 1946 expose que la nation assure à l’individu et à sa
famille les conditions nécessaires à leur développement. Le onzième alinéa du Préambule de
1946 énonce, pour sa part, que la nation garantit à tous la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs et que tout être humain qui se trouve, en raison de son âge, de
son état physique ou mental, de la situation économique, dans l’impossibilité de travailler, a le
droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. C’est au législateur
qu’il appartient toutefois, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de déterminer les
modalités de mises en oeuvre des principes ainsi proclamés par le Préambule.
Le Conseil constitutionnel a déjà reconnu que ces principes ne faisaient pas, par eux-mêmes,
obstacle à l’institution par le législateur de mécanismes de solidarité mis en oeuvre par des
collectivités territoriales, notamment les départements (décision n° 96-387 DC du 21 janvier
1997). Il faut relever, au surplus, que le pouvoir constituant, en adoptant la loi
constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, a
marqué que les collectivités territoriales avaient vocation à exercer davantage de
compétences, s’agissant de celles qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Sans doute doit-on considérer, lorsque sont en cause les principes posés par le Préambule de
1946, qu’il appartient toujours au législateur, même après l’intervention de la loi
constitutionnelle du 28 mars 2003, de prévenir par des dispositions appropriées la survenance
de ruptures caractérisées d’égalité dans la mise en oeuvre, par des collectivités territoriales,
des compétences qui leur sont confiées. On peut, en particulier, considérer qu’il doit en aller
ainsi en matière d’allocations d’aide sociale qui répondent à une exigence de solidarité
nationale, mises en oeuvre par les départements (décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997 ;
décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001).
Mais, au cas présent, il ne fait pas de doute que le législateur a pris les mesures appropriées
pour éviter que l’attribution aux départements de la mise en oeuvre du revenu minimum
d’insertion n’entraîne des ruptures caractérisées d’égalité.
A cet égard, on doit souligner que le revenu minimum d’insertion demeure un droit pour tous
ceux qui remplissent les conditions mises à son attribution et que ces conditions d’attribution,
notamment les conditions d’âge, de ressources et de composition du foyer, comme le montant
et le régime de l’allocation ou encore les règles relatives à la répétition d’allocations indues,
demeurent fixées par le législateur ou par le pouvoir réglementaire général. Ces éléments de
cadrage essentiels demeurent déterminés, pour l’ensemble du territoire national, par des
autorités de l’Etat. On peut ajouter que l’Etat assumera le contrôle de la mise en oeuvre du
dispositif par les départements, par la voie du contrôle de légalité exercé par les préfets et par
la voie de missions de contrôle exercées par l’inspection générale des affaires sociales. L’Etat
demeure, enfin, responsable du suivi des politiques conduites en matière d’allocation et
d’insertion des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ; à cet effet, la loi déférée a
prévu la transmission au préfet, par le président du conseil général, de données comptables et
d’informations relatives aux bénéficiaires et aux prestations.
On doit aussi relever que les décisions individuelles, désormais prises par le président du
conseil général, demeurent susceptibles d’être contestées devant les juridictions d’aide
sociale. Les décisions de refus ou celles qui suspendent ou mettent fin au versement de
l’allocation devront, d’ailleurs, être motivées en vertu des dispositions générales de la loi du

11 juillet 1979 relatives aux décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un
droit et celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.
2. En deuxième, la critique adressée à la loi déférée au nom du quatrième alinéa de l’article
72-2 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, ne pourra qu’être
écartée.
a) Elle est, en effet, inopérante. Il est vrai que les nouvelles dispositions constitutionnelles
prévoient désormais que tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités
territoriales doit s’accompagner de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice. Elles prévoient aussi que toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales
doit être accompagnée de ressources déterminées par la loi.
Mais la mise en oeuvre de ces dispositions doit nécessairement se faire dans le respect des
compétences respectives de la loi et de la loi de finances telles qu’elles sont définies par la
Constitution et par les dispositions organiques relatives aux lois de finances. Or l’attribution
de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice des compétences
transférées est susceptible, selon que le législateur choisit dans le cadre de son pouvoir
d’appréciation de retenir un type de ressources publiques ou un autre, de relever du champ
exclusif de la loi de finances. Il peut ainsi advenir que les dispositions procédant aux
transferts de compétences et celles décidant de l’attribution des ressources ne figurent pas
dans le même texte. Il faut alors, et il suffit, pour satisfaire à l’obligation constitutionnelle
imposant “ d’accompagner ” le transfert de compétences d’une attribution de ressources que
l’entrée en vigueur du texte législatif procédant au transfert de compétences soit subordonnée
à l’entrée en vigueur de la loi de finances décidant du transfert de ressources.
Tel est précisément l’objet des dispositions des articles 4 et 52 de la loi déférée. L’article 4
prévoit que les charges résultant pour les départements des compétences transférées ou créées
par la loi sont compensées par l’attribution d’une partie du produit d’un impôt perçu par l’Etat
dans les conditions fixées par la loi de finances et l’article 52 subordonne explicitement
l’entrée en vigueur de la loi déférée, en principe prévue au 1er janvier 2004, à l’entrée en
vigueur à cette date de dispositions votées par le législateur financier. En adoptant ces deux
dispositions, le législateur a satisfait, s’agissant de la loi déférée, aux obligations susceptibles
de résulter, à l’égard de ce texte, des dispositions du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la
Constitution. Toute autre critique adressée à la loi déférée au nom du quatrième alinéa de
l’article 72-2 de la Constitution est inopérante.
Il en va ainsi, en particulier, du grief tiré de ce que le montant des ressources transférées par la
loi de finances serait insuffisant pour couvrir les dépenses résultant du transfert ou de la
création de compétences. La détermination des ressources attribuées au titre des transfert et
création de compétences décidée par la loi déférée fait l’objet de l’article 40 du projet de loi
de finances pour 2004 qui est actuellement en discussion au Parlement. Une argumentation
contestant le montant des ressources attribuées pourrait sans doute être invoquée à l’appui
d’une contestation dirigée contre cet article de la loi de finances, une fois que cette loi aura été
définitivement adoptée. Mais une telle argumentation est dépourvue de portée à l’égard de la
loi déférée qui ne comporte par elle-même, et ne saurait valablement comporter sans
méconnaître la compétence exclusive du législateur financier, aucune disposition relative au
montant des ressources transférées.

b) Au demeurant, il faut relever que l’attribution de ressources telle qu’elle est aujourd’hui
prévue à l’article 40 du projet de loi de finances pour 2004 satisfait en tout état de cause
pleinement aux exigences constitutionnelles résultant du quatrième alinéa de l’article 72-2 de
la Constitution.
Cet alinéa distingue, en effet, le cas du transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités
territoriales et celui de la création ou de l’extension de compétences de ces collectivités.
S’agissant du transfert de compétences, la Constitution énonce explicitement que la
détermination du montant des ressources attribuées se fait au vu des ressources qui “ étaient
consacrées à leur exercice ”, c’est-à-dire celles qui étaient effectivement consacrées par l’Etat
à l’exercice de ces compétences avant le transfert. Et s’il est loisible au législateur de
déterminer, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation politique, des dispositions plus
favorables au bénéfice des collectivités territoriales ou de prévoir des règles relatives à
l’évolution dans le temps de ces ressources, la Constitution n’impose pas d’autre obligation
que celle d’attribuer des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées par l’Etat à la
date du transfert de compétences ; aucune règle constitutionnelle n’impose non plus de
prévoir l’actualisation du montant de ces ressources.
S’agissant des compétences nouvelles créées ou étendues par la loi, la Constitution n’impose
l’obligation d’attribuer des ressources que dans la mesure où ces création ou extension de
compétences ont pour effet d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales ; elle laisse
au législateur un large pouvoir d’appréciation quant au type et à l’évaluation des ressources
publiques considérées ; cette obligation n’est d’ailleurs opposable, ainsi que le Conseil
constitutionnel l’a déjà jugé (décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003 ; décision n°
2003-480 DC du 31 juillet 2003), qu’à la création de compétences obligatoires et non à des
dispositions qui se rapportent à l’exercice, par les collectivités, de compétences facultatives.
Au cas présent, l’article 40 du projet de loi de finances pour 2004 prévoit un partage d’impôt
entre l’Etat et les départements, sous la forme d’une affectation aux départements d’une
fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) appliquée à chaque
hectolitre de carburant mis à la consommation sur l’ensemble du territoire national.
Conformément à l’article 36 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
l’affectation de tout ou partie d’une ressource de l’Etat à d’autres collectivités ne peut résulter
que d’une disposition de loi de finances.
De manière provisoire, la fraction de tarif de la TIPP sera déterminée, pour l’ensemble des
départements, à partir des volumes de carburants mis à la consommation en 2003 et de la
dépense de l’Etat en 2003 au titre de l’allocation du revenu minimum d’insertion. Au stade du
projet de loi de finances pour 2004, la détermination de cette fraction provisoire est fondée sur
les prévisions de recettes et de dépenses de l’année 2003. Chaque département recevra un
pourcentage du produit affecté globalement aux départements, correspondant à la part des
dépenses exécutées par l’Etat en 2003 au titre de l’allocation du revenu minimum d’insertion
rapportée au montant total de ces dépenses dans l’ensemble des départements. Le législateur,
dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, a prévu que la régularisation définitive de la
fraction de tarifs affectée aux départements s’effectuera sur la base des dépenses de revenu
minimum d’insertion et du produit de TIPP effectifs en 2003 et devrait faire l’objet d’une
disposition en loi de finances rectificative pour 2004. S’il a, au surplus, prévu un ajustement
définitif au vu des comptes administratifs des départements pour 2004, on doit souligner que
l’adoption d’un tel mécanisme n’est nullement impliquée par une exigence constitutionnelle.

On doit, enfin, mentionner que la TIPP a été retenue en raison de sa stabilité et du caractère
peu volatile de ses bases. On estime d’ailleurs que la consommation de carburants augmentera
de 2003 à 2004, de telle sorte que le montant des recettes transférées aux départements au titre
de la TIPP devrait excéder d’environ 80 MEUR le montant de la charge du revenu minimum
d’insertion et du revenu minimum d’activité.
3. En troisième lieu, le Conseil constitutionnel ne pourra faire sienne la critique tirée du
cinquième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution.
Cette critique paraît, en tout état de cause, prématurée. S’il avait été décidé d’instituer un
mécanisme de péréquation, c’est dans la loi de finances qu’il aurait normalement trouvé sa
place, avec le dispositif de compensation.
En outre, on doit relever que la saisine se méprend sur la portée du dernier alinéa de l’article
72-2 de la Constitution lorsqu’elle soutient que le législateur serait tenu de prévoir dans
chaque cas des dispositifs de péréquation.
Il importe, en effet, de bien distinguer les quatrième et cinquième alinéas de l’article 72-2 et
de mesurer précisément quelle est leur portée respective. Le quatrième alinéa énonce une
règle constitutionnelle précise - celle de la compensation financière des transferts de
compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales - dont le respect s’impose au
législateur au cas par cas, pour chaque transfert de compétences, sous le contrôle du Conseil
constitutionnel. Le cinquième alinéa exprime, pour sa part, un objectif constitutionnel et
habilite le législateur à mettre en place des dispositifs de péréquation destinés à favoriser
l’égalité entre les collectivités territoriales. Cet objectif s’appréhende de manière
nécessairement plus globale ; ainsi que l’a déjà jugé le Conseil constitutionnel, le dernier
alinéa de l’article 72-2, qui a pour but de concilier le principe de liberté avec le principe
d’égalité, n’impose pas que chaque type de ressources fasse l’objet d’une péréquation
(décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003). La compensation et la péréquation constituent
ainsi deux opérations bien distinctes et font l’objet de dispositions constitutionnelles de portée
différente.
La loi déférée procède à un transfert de compétences de l’Etat vers les départements. Il
importe dès lors que soit organisée de manière corrélative, selon les modalités précédemment
exposées, une attribution de ressources aux départements afin de satisfaire aux exigences du
quatrième alinéa de l’article 72-2. En revanche, la loi déférée n’ayant nullement pour objet la
mise en place de dispositifs de péréquation, l’invocation du cinquième alinéa de l’article 72-2
est dépourvue de portée. Aucune exigence constitutionnelle n’imposait au législateur, au cas
présent, de mettre en place un mécanisme de péréquation.
II. - Sur l’article 43
A. - L’article 43, relatif au revenu minimu d’activité, insère au code du travail dix articles qui
déterminent le régime d’une nouvelle catégorie de contrats de travail dénommés “ contrat
insertion-revenu minimum d’activité (CIRMA), destinés à faciliter l’insertion sociale et
professionnelle de personnes bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Ces contrats s’inscrivent dans le
cadre du parcours d’insertion prévu à l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des
familles.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%