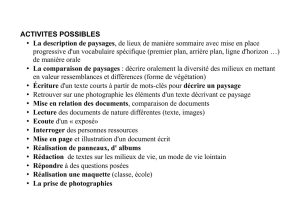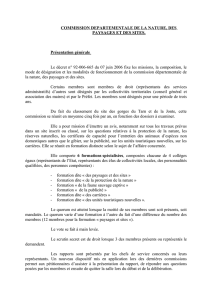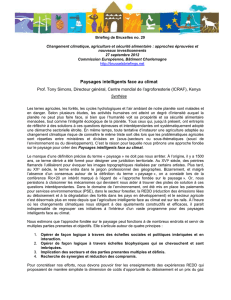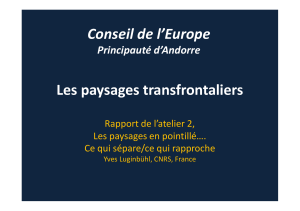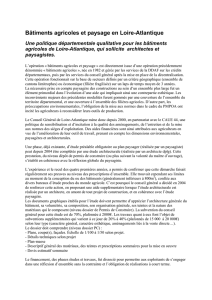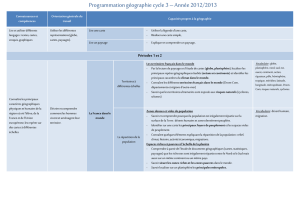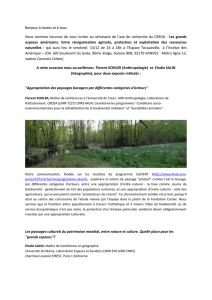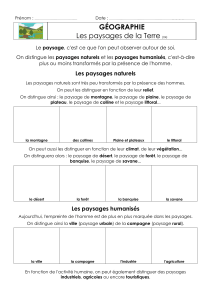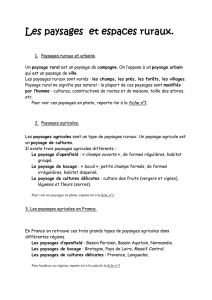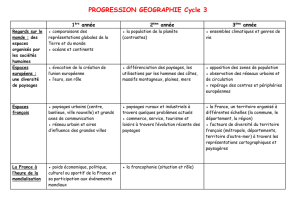Dualité du régime juridique des paysages

Université Paris II (Panthéon – Assas)
D.E.A. de Droit de l'Environnement
Année Académique 1997-1998
DUALITE DU REGIME JURIDIQUE DES PAYSAGES
par Monsieur François RIBARD
sous la direction du professeur J. de MALAFOSSE

Introduction
François RIBARD, Dualité du régime juridique des paysages, Mémoire DEA 1997-1998
Introduction
"La vue est le sens prioritaire de la perception du beau."
1
Les philosophes de l'esthétique, depuis Platon, la placent au sommet de la hiérarchie des sens.
Elle est le médiat le moins corrompu entre les choses du réel et la subjectivité de l'homme.
Dans notre monde moderne, la vue tient également un rôle prépondérant.
"Nous sommes dans la société du visuel" affirmait Jacques Seguéla
2
.
Il est par conséquent tout naturel que la notion de Paysage soit devenue depuis deux siècles
une préoccupation sociale de premier ordre.
On ne compte désormais plus un jour sans que les plus grands médias comme les plus
insignifiants ne traitent de paysages, que ce soit pour nous en vanter la qualité, pour nous les
faire découvrir ou pour dénoncer leurs atteintes permanentes.
Mais qu'est-ce que le paysage ?
L'appréhender apparaît loin d'être une tâche aisée, le mot connaissant plusieurs acceptions qui
en changent le sens. Les lexicologues ne nous simplifient pas les choses.
Les uns donnent une définition purement objective :
- Larousse : "étendue de pays qui présente une vue d'ensemble" ;
- Hachette : "étendue de pays qui s'offre à la vue" ;
- Robert : "partie d'un pays que la nature présente à un observateur".
D'autres insistent sur le caractère subjectif du paysage :
- Encyclopedia Universalis : "relation qui s'établit en un lieu et à un moment donnés entre un
observateur et l'espace qu'il parcourt du regard" ;
- R. Debray : "écoumène médiatisé par des mots, des images interprétés par des archétypes
culturels, des échosymboles comme le bocage, l'alpage ou le rivage marin" ;
- J.R. Pitte : "le paysage est essentiellement changeant et ne peut être appréhendé que dans sa
dynamique, c'est-à-dire dans le cadre de l'histoire qui lui restitue la quatrième dimension" ;
1
M SERRE, Les cinq sens, Grasset, 1985.
2
J. SEGUELA, Fils de pub,

Introduction
François RIBARD, Dualité du régime juridique des paysages, Mémoire DEA 1997-1998
3
- A. Berque : "médiation entre le monde des choses et la subjectivité humaine" ;
- Baudelaire : "le paysage ne vaut que par celui qui le regarde".
Il est sans doute possible de synthétiser ce qui vient d'être puisé dans la littérature en retenant
les caractères du paysage, qui expliquent pourquoi un groupe humain est si viscéralement
attaché à son aspect :
- caractère personnel et subjectif : on ne connaît pas de critères collectifs du beau ni même de
l'harmonieux ;
- caractère relatif : tel paysage sera admiré dans certaines conditions de lumière ou
météorologiques ;
- caractère protéiforme : l'émotion ressentie par l'observateur peut être soit purement
esthétique, soit mnémonique (si elle fait renaître en lui des souvenirs, des sensations, des
émotions), soit encore culturelle (et dans ce cas, elle prend une dimension sociale).
Il apparaît ainsi que le paysage qui peut être naturel, urbain, périurbain ou rural, constitue un
lien étroit, physique, sentimental et intellectuel entre l'homme et son environnement, ce qui
explique sans doute le poids pris progressivement par ce dernier dans les préoccupations
sociales.
Depuis l'antiquité jusqu'au début du siècle dernier, le paysage ne se manifeste qu'en tant que
"fait du prince". Les "puissants" cherchent à imprimer leur marque sur le territoire, en
modelant le paysage à leur goût ou à leur besoin. On rase une colline, on déplace une rivière...
Au XIXème comme au début du XXème siècle, les élites artistiques puis sociales prennent
conscience de la beauté des paysages.
La littérature du siècle "paysagiste"
3
laisse de nombreuses évocations de paysages, dont on ne
saurait raisonnablement donner une liste exhaustive. Il serait toutefois impensable de ne pas
citer, au moins, Chateaubriand, Balzac, Stendhal, Maupassant, Hugo, Verlaine, Rimbeaud,
Zola, et pour le début de notre siècle Pagnol et Giono.
Les Arts graphiques du XIXème siècle sont riches en oeuvres paysagères. Le mouvement
impressionniste, en particulier, en offre un superbe catalogue.
La Bourgeoisie dispose du temps et des moyens d'apprécier la prise de conscience artistique
des paysages, mais également de profiter directement de la beauté de ces derniers.
3
Le XIXème siècle.

Introduction
François RIBARD, Dualité du régime juridique des paysages, Mémoire DEA 1997-1998
4
Le XXème siècle est celui de la démocratisation des paysages.
La photographie puis le cinéma -ou son avatar télévisuel- ne restent pas étrangers à la beauté
des paysages, y puisant à l'occasion une dimension sémiologique renforçant le récit.
La population dispose désormais du temps (les congés payés permettent enfin de prendre des
vacances) et des moyens matériels (financiers comme de transport) de prendre conscience de
la beauté des paysages mais également des graves atteintes qui leurs ont été portées.
Depuis la révolution industrielle, on a recherché en effet les implantations les plus
"rationnelles" en ignorant généralement les dégradations du paysage qu'elles entraînaient.
Par son impact tantôt bénéfique et tantôt désespérant sur le cadre de vie, le paysage est ainsi
devenu un véritable fait social, et, comme tel, entre directement et immédiatement dans le
cadre des préoccupations du Droit
4
Mais comment soumettre le Paysage au Droit ? Ses caractères relatif, subjectif et protéiforme,
sa sensibilité l'opposent à la logique, au rationalisme du Droit.
L'absence totale de définition juridique du Paysage exprime clairement le malaise ressenti par
les juristes. Comment établir un régime juridique pour une notion que l'on n'appréhende pas ?
Le législateur qui lui a consacré une loi
5
, la jurisprudence comme la doctrine sont pourtant
dans l'incapacité de lui donner un sens précis
6
.
Pris entre la volonté sociale et la réticence que lui inspire une notion qu'il ne cerne pas, le
Droit se contente dans les premiers temps d'une prise en compte implicite et indirecte de la
donnée paysagère. La mise en oeuvre de régimes juridiques aux finalités voisines, telles la
protection des sites ou bien celle des monuments historiques prend en considération les
préoccupations paysagères et rapidement, cette prise en compte devient explicite : les
dispositions de soumission au respect des paysages se multiplient.
Par la suite, elle affirme son caractère direct. Des mesures de protection des paysages sont
prises et une loi "Paysage" est votée.
4
Dès 1901, une Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France parvient à obtenir le
sauvetage de la cascade du Lizon dans le Doubs qu'un industriel voulait canaliser.
5
Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur du paysage et modifiant certaines
dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, JORF 9 janvier 1993.

Introduction
François RIBARD, Dualité du régime juridique des paysages, Mémoire DEA 1997-1998
5
La prolifération de ces stipulations de protection, de sauvegarde, de mise en valeur manifeste
l'existence d'un véritable régime juridique pour les paysages. Les déclarations de principes,
ultime étape, viennent d'ailleurs consacrer l'émergence d'un Droit des paysages :
- La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature proclame en son article premier
que la protection des paysages est d'intérêt général.
-L'article premier de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture énonce que "le respect des
paysages naturels ou urbains" est d'intérêt public.
- Enfin, la loi du 2 février 1995 déclare dans un nouvel article L200-1 du code rural les
paysages "patrimoine commun de la nation".
Force est donc de constater que, confronté à une préoccupation sociale moderne, le Droit est
parvenu à développer un Droit des paysages sans avoir déterminé les contours de la notion.
Il s'agit d'un Droit public. La terminologie ne trompe pas : intérêt public, intérêt général,
patrimoine commun de la nation... Toutes les dispositions ainsi prises visent à préserver les
paysages qui en sont le plus dignes au regard de l'intérêt général.
Ceux-ci sont le patrimoine de la nation, insusceptibles d'appropriation. Le législateur adopte
ainsi la conception de Victor HUGO, qui distinguait l'usage et la beauté des paysages, l'usage
appartenant aux divers propriétaires du sol, et la beauté à tout le monde
7
.
Une telle acception modifie profondément la notion de Paysage. Le Paysage n'est pas à tout le
monde mais à chacun. Chacun peut en apprécier la beauté personnellement, en fonction de sa
propre subjectivité.
La démarche publiciste est indispensable. La sauvegarde des paysages les plus unanimement
appréciés apparaît impérative, dans un souci d'intérêt général
8
. Elle ne couvre cependant que
partiellement la notion de Paysage, ce qui nous amène à considérer qu'il s'agit non d'un Droit
du Paysage, mais d'un Droit des paysages, des paysages remarquables.
Un tel Droit ne satisfait qu'en partie l'intérêt que portent aux paysages les individus qui
composent la société.
6
Les débats parlementaires qui précédent l'adoption de la loi "paysage" présentent une définition dont les
valeurs juridique comme sémantique sont toutes relatives. Le paysage serait "un ensemble naturel ou urbain
harmonieux"... (J.O. du 9 janvier 1993)
7
V. HUGO, "Guerre aux démolisseurs", Revue des deux mondes de 1832.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
1
/
85
100%