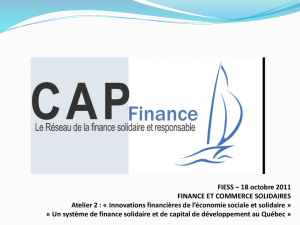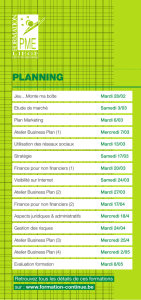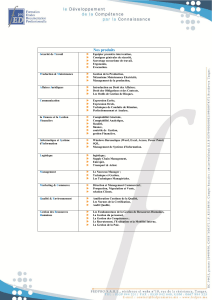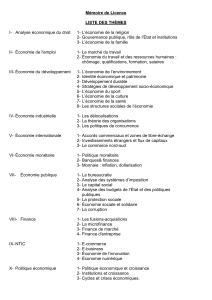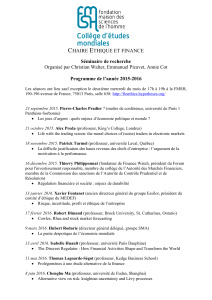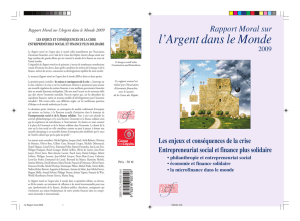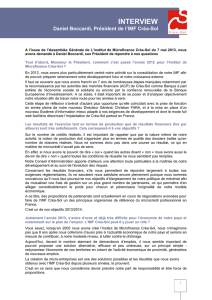La microfinance est la forme de finance qui s`adresse en priorité aux

1
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme
Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire
Pôle Socio-économie de la Solidarité
Cahier de propositions
pour le XXIe siècle
Finances Solidaires
Novembre 2001
Coordonné par Renée Chao Beroff et Antonin Prébois
Site: http://finsol.socioeco.org/

2
Synthèse
Les institutions de microfinance au Nord par leurs interventions génèrent un lien entre épargnants (ayant les
moyens financiers) et emprunteurs (n’ayant pas de moyens financiers) en donnant un caractère éthique à leur
épargne. Le lien social se crée entre les populations ayant les capacités de financement (plus aisées) et celles qui
sont exclues des circuits traditionnels (plus pauvres).
Au sud, les programmes de microfinance interviennent auprès des personnes ‘pauvres’ ou exclues du secteur
bancaire classique uniquement. Pour celles-ci, les liens sociaux constituent un enjeu majeur de leur intégration et
de leur insertion durable dans la société et dans l’économie.
A un moment où l’euphorie de la microfinance s’estompe et que le secteur se trouve devant une croisée des
chemins, il devient donc indispensable de s’interroger, au Nord comme au Sud, dans une perspective solidaire qui
prend en compte les liens sociaux et le capital social.
I) Constats :
a) Les expériences de finance solidaire populaire s’appuient sur les liens sociaux et ont un
impact social positif.
De nombreux exemples de finance solidaire populaire, celles mises en place et pratiquées par les gens, sur leurs
propres initiatives, selon leurs propres valeurs et formes d’organisation, montrent que les liens sociaux permettent
d’intégrer les plus vulnérables ou les personnes temporairement fragilisées dans l’économie. Elle leur donnent des
opportunités d’apprentissage en conduite d’affaire comme en comportement en société, leur permet de participer à
la définition de règles dans un cadre qui les concerne. En les respectant et en étant à leur tour solidaire avec les
membres du groupe, ces personnes sont ou redeviennent acteurs.
Ces liens, développés dans un cadre de confiance et d’empathie, rendent “ bancables ” financièrement et
culturellement des personnes totalement “ non bancables ” précédemment.
b) Les Institutions de microfinance (IMF) pour beaucoup copient mais ne pratiquent pas la
finance solidaire
Les Institutions de Micro Finance empruntent souvent à des organisations de finance solidaire populaires quelques
caractéristiques, telles que la formation de groupes, les réunions et cotisations régulières, la mise en place de fonds
de secours pour l’entraide et les imposent aux populations auprès desquelles elles interviennent, en leur donnant
une fonction de garantie des remboursements de crédit et en faisant un véhicule au travers duquel passent les
services financiers permettant de réaliser une économie d’échelle. Ce qui constituait la base du capital social et
renforçait les liens sociaux est instrumentalisé pour devenir une “technologie” de délivrance des crédits.
Certaines Institutions de Micro Finance ignorent les solidarités qui préexistent autour de leurs clients et ne les
prennent pas en compte dans leur conception de l’organisation du système, ni des produits et des services
financiers offerts. Celles là considèrent que le crédit seul suffit à améliorer les conditions des individus.
D’autres, à leur début, avaient le souci de bien comprendre l’environnement social dans lequel évoluaient leurs
clients, de préserver les liens sociaux positifs qui renforçaient leur capital social et de construire leur système
financier en lui assignant pour mission l’intermédiation sociale. Cependant, avec les pressions externes fortes de la
part du courant dominant, de la profession et des bailleurs de fonds, elles ont dû abandonner cette option en cours
de route, notamment au moment crucial de l’institutionnalisation.

3
c) Certaines institutions de Micro Finance peuvent avoir un impact social limité voire négatif
Les groupes de caution solidaire que mettent en place certains Institutions de Micro Finance (IMF), sont loin d’être
le lieu où se tissent des liens sociaux.
Des études d’impacts montrent que la plupart des Institutions de Micro Finance ne parviennent pas à toucher leurs
publics cibles et qu’il y a peu de changements dans la situations des clients, même après plusieurs années. Parfois,
on constate même des régressions: des conflits dans des familles liées aux crédits, des ruptures de liens sociaux au
sein d’une communauté, des décapitalisations pour rembourser les crédits des IMF, voire le recours à nouveau à
des usuriers pour rembourser les crédits des IMF, une situation plus vulnérable qu’auparavant.
d) Qu’est-ce qui empêche les IMF de prendre en compte les liens sociaux ?
Les raisons de la non prise en considération des liens sociaux par les IMF sont à la fois d’ordre politique,
institutionnel et culturel.
Les IMF sont intégrées au système libéral dominant dans lequel l’économique prédomine sur le social. Les
bailleurs, en s’inscrivant dans cette même logique, imposent le plus souvent un objectif de rentabilité à court terme
qui à pour conséquence une focalisation des IMF sur les objectifs financiers au détriment des objectifs sociaux.
L’ignorance des liens sociaux existants est certainement également due à une indifférence pour des données qui ne
semblent pas utiles de prime abord. Elle est aussi redevable à la complexité des situations sociales qui les rend
difficilement appréhensibles. Les IMF n’en tiennent donc pas compte dans leurs réflexions stratégiques et dans
leur modalité de fonctionnement.
D’autre part, l’évolution institutionnelle des IMF joue également en défaveur de la prise en compte des liens
sociaux. L’augmentation en volume de l’activité de crédit, la couverture géographique de plus en plus large, la
centralisation des systèmes de financement à grande échelle rend difficile le contact direct avec les clients qui est
indispensable à la prise en compte des liens sociaux.
e) Nécessité de distinguer deux types de micro finance
Il est nécessaire et urgent est de distinguer différentes formes de microfinance en fonction des types de pratiques
des IMF. On peut différencier deux grandes catégories d’instituions :
1) La microfinance qui considère son rôle comme celui d’un prestataire de services financiers, voire de pourvoyeur
de crédits. Ces institutions ont démarré en général sur un créneau délaissé par les banques et établissements de
crédits, celui des clients “ non bancables ”.
Les “ banquiers ” ont progressivement trusté ce marché du microcrédit, en y infiltrant leur personnel, leurs experts,
leurs standards de performance et de reporting et ont créé des barrières à l’entrée, tant psychologiques que
financières, pour repousser à la marge d’autres acteurs.
Nombre de bailleurs de fonds ont finalement adhéré à cette vision technocratique et bancaire du secteur, séduits
par le discours professionnel et rassurant. Les bailleurs sont aussi hostiles aux risques !
C’est cette forme de microfinance qui prône l’institutionnalisation en banques commerciales pour accéder au
marché monétaire, une rentabilité élevée pour attirer des investisseurs privés. On peut la qualifier de
“ microfinance pré-bancaire ”.
2) La microfinance qui considère que la finance est un outil efficace, mais au service du développement humain et
sociétal. Pour ces micro financeurs, la manière d’apporter les services peut faire toute la différence. Parce qu’elle
met les hommes et leurs liens sociaux au centre de sa mission, cette forme de finance agira toujours en fonction des
contextes et des milieux, qu’elle cherchera à connaître, pour mieux les servir et les valoriser. La consécration pour
cette finance est l’impact sur le capital social et l’autonomie de ses clients, qui à leur tour aura un impact sur la
pérennité de ce type d’institution.
On peut la qualifier de “ Finance Solidaire ”.
Tout comme la banque est un métier, la finance solidaire est un autre métier, un nouveau métier à faire reconnaître
et à promouvoir.

4
Aujourd’hui, après deux décennies d’une microfinance pionnière et triomphante, le secteur se trouve confronté
pour la première fois à une crise en profondeur, qui se traduit par des départs massifs de clients, par des groupes ou
clients inactifs, par une chute des volumes de transactions et surtout par des impayés qui commencent à devenir
alarmants.
Y a t-il un lien entre cette “marche forcée” vers la rentabilité et l’abandon des liens sociaux d’une part et ces
blocages et dysfonctionnements d’autre part? La microfinance souffre t-elle de ne pas avoir su créer et consolider
du capital social au sein de sa clientèle, de ne pas avoir su tisser des liens sociaux entre les clients et entre les clients
et l’institution?
Une réflexion sur les concepts s’impose. Que sous-tendent les termes de “capital social”, de “liens sociaux”? Y a
t-il différents types de microfinance? Comment les différentie t-on? Quelle est la définition d’une“finance
solidaire”? Quels sont les indicateurs pour évaluer la finance solidaire? Quelles sont les mesures à mettre en œuvre
pour soutenir la finance solidaire?

5
II) Visions & paradigmes
a) Définition du capital social et des liens sociaux
Le capital social peut être défini comme la capacité des personnes à coopérer et à agir ensemble en utilisant ou en
créant les liens sociaux nécessaires pouraller vers des buts solidaires et durables communs. Le capital social ne se
réfère donc pas seulement à une somme de capacités individuelles mais à un capital collectif qui appartient au
groupe et lui permet d’assurer sa cohésion, sa pérennité et son action.
Le capital social est la résultante de l’interaction entre les valeurs partagées des individus et les institutions et
structures dont ils se sont dotés pour se rapprocher de ces valeurs.
Les valeurs sont sous-jacentes aux désirs, motivations et intérêts de chacun mais communes à tous. La capacité des
personnes à agir ensemble dépend de la capacité qu’ils auront à réaliser leurs valeurs à travers les actions
collectives.
On peut lister ces valeurs et les définir.
Valeur Définition
Pouvoir Capacité d’influencer les décisions
Ouverture Accès à l’information
Bien-être Satisfaction des besoins primaires
Compétences Capacités
Respect
Affection Sentiment d’appartenance
Droiture Exigence morale
Richesse Matérielle, intellectuelle, culturelle et spirituelle
Les liens sociaux sont les relations et les interactions qui existent entre les individus et les groupes. Ils sont soit
donnés (liens horizontaux, non volontaires, innés) : la parenté, la religion, le voisinage ; ou créés (liens verticaux,
choisis) par les individus et les groupes en fonction de leurs intérêts et buts. Les liens sociaux sont un des
composants du capital social. La qualité des liens sociaux traduit l’état du capital social.
Les indicateurs permettant de mesurer l’état du capital social peuvent être: la participation des clients des IMF aux
décisions, à l’allocation des ressources, leurs capacités à analyser leurs situations et à formuler un projet, l’état de
leur santé, sécurité, éducation, logement, leurs capacités à s’organiser, à gérer, à établir des relations avec
l’environnement administratif et politique, à négocier avec l’encadrement technique, à s’approprier le système
financier mis en place, à discerner les bonnes mesures et décisions des mauvaises, à s’ouvrir sur des horizons
temporels plus lointains, à intégrer les outils dans une dynamique territoriale ...
b) Définition de la finance solidaire
La finance solidaire se définit à un certain nombre de niveaux comme la mission, la vision, l’identité, les
compétences, le comportement et l’environnement.
La finance solidaire a pour mission d’utiliser l’outil financier pour un développement équitable et durable.
Elle a pour vision à long terme d’augmenter le capital social.
Ses acteurs sont multiples, ayant chacun des techniques et des comportements différents, agissent selon
desmodes différents, mais ensemble font émerger une identitéspécifique de la finance solidaire.
Ses compétences consistent à penser globalement, à pouvoir fédérer des individus et des acteurs autour de
l’activité financière, à connaître les besoins des entrepreneurs individuels et des communautés quelques soient
leurs conditions économiques et sociales.
Le métier du financier solidaire consiste à financer des activités et des personnes, dans un cadre d’intérêt
général, en veillant au respect du capital social.
La finance solidaire œuvre dans un environnementde pauvreté, d’exclusion ou de difficulté d’accès aux
services financiers.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%