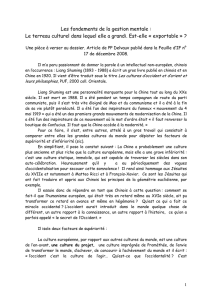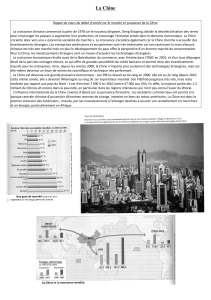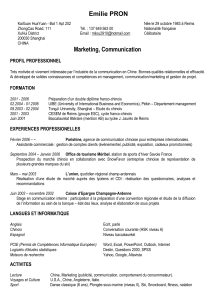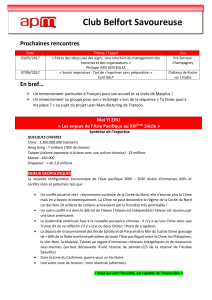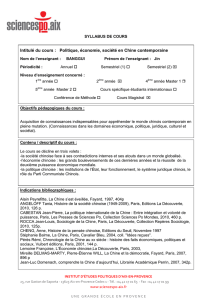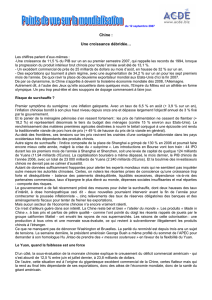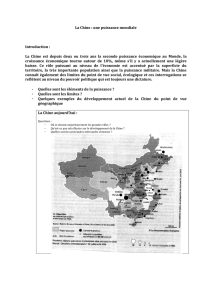Pour charger la conférence entière en fichier rtf, cliquez ici

1
Benoît Vermander
Le dialogue Chine-Occident à l’heure de la globalisation
-“ Entreprise et Sinologie ”, Pékin, 28 février 2001-
L’interaction culturelle entre la Chine et l’Occident est une réalité multiséculaire. Et, depuis 1600 environ, elle a
été à peu près ininterrompue et a grandement influencé le cours de chacune des deux civilisations dont il est
question. Il s’agit pour nous de réfléchir sur les nouveaux enjeux de cette rencontre culturelle, sur les figures
qu’elle prend dans le monde d’aujourd’hui. L’époque actuelle est souvent définie comme “ l’ère de la
globalisation. ” Il est clair qu’un tel qualificatif a quelque chose d’un slogan, qu’il conjugue indûment des
phénomènes de natures très diverses et qu’il en occulte certains autres. En même temps, il pointe certainement
vers une réalité spécifique, qui mérite d’être analysée comme telle. Et, puisque les “ mots ” font les “ choses ”, il
nous faut tout bonnement reconnaître que nous sommes dans l’ère de la globalisation par le simple fait que nous
disons et croyons y être... Alors, peut-on isoler et analyser comme telle une dimension spécifique des contacts
entre civilisations (le dialogue Chine-Occident) dans un monde où de telles relations sont déjà “ globalisées ” ?
Le présent essai se divise en quatre parties : il propose une réflexion sur le concept même de “globalisation ”
dans le contexte de la question qui est la nôtre ; il revient sur les origines de l’interaction Chine-Occident à la
lumière de cette réflexion préliminaire ; il reprend les diverses figures de l’Occident qui ont marqué l’histoire
chinoise ; enfin – et cette partie est la plus développée -, il décrit les défis du dialogue Chine-Occident propres à
l’époque présente.
- I - Retour sur la globalisation
Le terme de globalisation renvoie à un processus au travers duquel les contraintes géographiques qui pèsent sur
les structures sociales et culturelles diminuent fortement et la conscience collective de ce desserrement des
contraintes s’affirme de plus en plus. Les relations ainsi créées à l’échelle mondiale sont alors toujours
davantage intégrées. C’est l’aspect systémique du processus qui me fait préférer le terme de globalisation à celui
de mondialisation.
On peut prétendre à juste titre que l’humanité a entamé dès les origines un processus de globalisation. Toute
migration, tout contact de territoire à territoire, tout ce qui a contribué à faire du monde habité un système
unique et fini est de l’ordre de la globalisation. Processus qui est passé par le dialogue comme par le conflit –
que deux guerres du vingtième siècle aient pour la première fois été qualifiées de “ guerres mondiales ”
témoigne aussi d’une étape dans la globalisation... On peut néanmoins mettre en valeur des échelles temporelles
très diverses selon la perception qu’on a du phénomène. On peut d’abord, comme je viens de le faire, insister sur
le caractère multi-séculaire de la globalisation. On peut insister sur son lien organique avec la modernisation et
le surgissement du capitalisme. Enfin, on peut en faire une manifestation directe des évolutions des dernières
décennies, lesquelles pourraient être qualifiées de “ l’ère des post -” : post-capitalisme, post-modernité,
post-industrialisme... Les trois dimensions ne sont pas contradictoires, elles développent plutôt des accents et
des intérêts différents.
1
Qu’y aurait-il de différent, qu’aurait-on remarqué et nommé vers la fin des années 80, le début des années 90,
lorsque l’expression se popularise ? Il s’est sans doute produit vers cette époque un processus dans lequel, pour
suivre l’expression de Marx, la quantité s’est transformée en qualité. Qu’entendre par là ? Pour prendre un
exemple, un accroissement quantitatif de capital permet, à un certain niveau, de basculer qualitativement dans
un mode nouveau de production. Ou encore : une acumulation de conclusions et d’observations permet de
basculer d’un paradigme scientifique à un autre. On peut aussi utiliser une parabole qui a à voir directement
avec notre sujet : supposons qu’on ait résolu tous les problèmes permettant d’envoyer une navette dans une
1
Pour une présentation générale du phénomène par un sociologue, cf. Malcolm Waters Globalization,
New-York, Routledge, 1995.

2
planète habitée d’une autre galaxie à l’exception de la question de l’approvisionnement en énergie. Tant qu’une
quantité, même très faible, d’énergie manquera, qui permettrait de réaliser un voyage aller-retour dans cette
planète habitée, le saut effectif n’aura pas été accompli. L’accroissement quantitatif qui se produit quand on peut
enfin fournir l’énergie nécessaire produit d’un seul coup un immense basculement qualitatif.
Dans cette logique, on peut de fait suggérer que l’accumulation des échanges au cours des dernières décennies a
franchi un “ seuil qualitatif ” qui fait du terme “ globalisation ” un peu plus qu’un slogan. Encore faudrait-il ici
distinguer selon la circulation des biens (dont les progrès durant les dernières décennies n’ont pas été
foudroyants, le transport de marchandises et les techniques qi’il emprunte progressent nettement moins que
d’autres types de communication), la circulation des personnes (en forte augmentation) et la circulation de
l’information (y compris des flux financiers), dont l’explosion a constitué le vrai moteur de la globalisation. On
peut aussi procéder au travers d’autres dimensions : les échanges matériels sont fortement marqués par les
contraintes géographiques. Leur tendance naturelle est de localiser une commuanuté. Les échanges politiques
sont au départ des rapports entre des entités souveraines ; à ce titre, ils internationalisent le monde davantage
qu’ils le constituent en système. Enfin, les échanges symboliques sont les plus libres des référents spatiaux et
par là globalisent la communauté humaine.
2
C’est ainsi qu’il est possible de donner sens à certains indices et de parler de la mise en place d’un véritable
système global :
- L’information est désormais traitée au travers d’un système intégré de gestion, dont les satellites, l’internet, etc
constituent les canaux visibles.
- Une “ conscience planétaire ” a vu le jour, qui permet d’identifier certains problèmes (environnement, droits
de l’homme) comme problèmes “ mondiaux ” à proprement parler.
- Les échanges politiques ne se traitent plus seulement sur le mode des relations internationales mais aussi sur
celui des relations transnationales, ce dont témoignent la diminution du rôle de l’Etat, l’apparition de
communautés régionales, le poids croissant des organisations non-gouvernementales et supra-nationales.
- L’intégration des flux financiers et les nouvelles conjonctions d’intérêts qu’il produit constituent un indice
supplémentaire.
- La rétroaction des sytèmes de pensée en est un autre. Le dialogue entre les religions, avec la façon dont il
amène chacune des croyances à réexprimer ses fondements, en est un exemple.
- Enfin, il est possible que le processus même de découverte scientifique (cf la façon dont a été conduite la
cartographie du génome humain) indique déjà comment la globalisation influe sur les vecteurs au travers
desquels l’esprit humain détermine le cours de son développement.
La globalisation est donc un phénomène de long terme qui a connu une accélération soudaine. Il est assimilable
à la contraction des contraintes liées à l’espace et au temps, contraction qui favorisent l’émergence de réseaux
de relations de plus en plus intégrés. Le caractère réflexif de la globalisation oriente les acteurs économiques,
politiques et sociaux à agir de plus en plus selon la logique de ce nouveau contexte, en redoublant ainsi l’impact.
Le processus de globalisation exaspère alors la tension entre universalisme et particularisme (je reviendrai sur ce
point en seconde partie). Notons encore que la globalisation n’est en soi ni bonne ni mauvaise. Elle est
indifférente, dans le sens où elle peut accompagner tant des phénomènes catastrophiques que bénéfiques. Mais
elle a sans nul doute un effet d’amplification, voire de multiplication des phénomènes, bons ou mauvais, qu’elle
accompagne.
- II - Aux origines du dialogue Chine-Occident
Dans cette perspective, revenons au dialogue Chine-Occident pour étudier la façon dont il se définit aujourd’hui.
Notons dès l’abord que ce dialogue n’est en rien un phénomène périphérique, mais qu’il a constitué l’un des
axes qui a déterminé l’évolution de l’Occident et de la Chine dès le moment où ils se sont rencontrés. Je ne
parlerai ici que de la rencontre qui s’est développée à partir de la seconde moitié du seizième siècle, sans
m’étendre sur les contacts antérieurs. Ces premiers contacts, dont l’étude est en soi très intéressante, n’ont pas
été continus, ils ont dû passer par des recommencements.
Du côté de la Chine
En mai 1601, Matteo Ricci obtient de l’Empereur la pemission de s’installer à Pékin et reçoit une pièce de
terrain sur laquelle se trouve encore aujourd’hui l’Eglise du Sud, Nantang. Avec d’autres jésuites, il était en
2
Ibi., p.9/

3
quête de cette légimitation depuis son arrivée en Chine, en 1583. Les neuf dernières années de sa vie, à Pékin, se
passeront à multiplier les contacts avec les intellectuels et les nouveaux chrétiens chinois, et à amplifier le
travail de traduction et commentaire qu’il avait entrepris dès le début. Trois des “ innovations ” que Matteo
Ricci va apporter en Chine méritent qu’on les commente ici, car elles montrent comment le dialogue
Chine-Occident qui prend forme à ce moment là possède un sens universel, désigne les lieux et les enjeux du
processus de globalisation tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Matteo Ricci va tout d’abord dessiner une carte du monde, la première de ce type a être connue en Chine. Elle y
rencontrera bien sûr un vaste succès. On peut légitimement voir là la “ révolution copernicienne ” propre à la
Chine, dans la mesure où elle introduit à un décentrement. L’Empire du Milieu se découvre ni si central ni si
“ unique ” qu’il croyait être jusqu’alors. Il découvre ce que signifie vraiment être part du monde habité, être “un
parmi d’autres ”. Les répercussions de la carte de Ricci seront nombreuses et profondes.
En second lieu, Ricci traduira en chinois les Elements de Géométrie d’Euclide. Ce n’est point là un choix
indifférent. On peut même y voir le principe et le symbole de la raiosn scientifique et calculatrice formalisée en
Occident, le fondement du langage propre à la rationalité scientifique et technqiue. Or, ce langage a bien pris
valeur universelle. Du reste, dans l’apologétique du temps, l’universalité de l’enseignement chrétien est aussi
inféré du caractère universel des sciences et techniques que les jésuites apportent avec eux. A cet égard, la
question de fond reste encore vive : le problème du rapport entre l’universalité du langage techno-scientifique et
ses racines greco-chrétiennes demeure ouvert pour toute philosophie de l’histoire. Se pose là de façon plus aiguë
encore qu’ailleurs la question du rapport entre universalité et particularisme.
En troisième lieu, dans “ Le vrai sens de la doctrine du Seigneur du Ciel ” (Tianzhu shiyi), Ricci développe
l’idée d’un Dieu unique, personnel et créateur. Cet enseignement, nouveau en Chine quant à la formulation, y
rencontre moins d’obstacles qu’on ne l’a dit parfois. On n’a pas assisté, à la lutte entre deux cosmologies
incompatibles. Comme en d’autres contextes culturels, c’est plutôt la doctrine de l’incarnation (non celle d’un
Dieu personnel ou le créationnisme) qui a fait scandale. Quoi qu’il en soit, Ricci apportait là le germe d’un
dialogue philosophique et religieux qui continue encore aujourd’hui.s.
Bien entendu, cet apport de Ricci n’était pas formulé ni reçu in abstracto, mais en fonction des schèmes
mentaux et des stratégies intellectuelles propres à l’époque. Il nous faut sortir d’une approche essentialiste du
contact entre cultures (entre Chine et christianisme en l’occurence), et porter notre attention sur le processus de
fabrique par quoi dogmes et innovations sont adoptés et réinterprétés. Si l’on voit l’invention d’un
“ christianisme chinois ” comme la production d’une pièce de tissu obtenu par croisement de fibres, dit ainsi
Nicolas Standaert, toute une série d’interactions différenciées se produira : une fibre existante (le concubinage)
est enlevée sans autre forme de procès tandis qu’une autre (monogamie) se voit renforcée ; la fibre confucéenne
est également renforcée, tandis que les fibres taoistes et bouddhistes sont rejetées ; des sélections s’opèrent,
telles l’acceptation par certains chrétiens chinois des enseignements chrétiens moraux mais non des croyances
eschatologiques ; certaines innovations jouent le même rôle fonctionnel que d’autres fibres qu’elles remplacent
(jeûnes et sociétés pieuses prennent la place des pratiques bouddhistes correspondantes) ; certaines fibres
reçoivent un nouveau coloris (christianisation des rites funéraires), et ainsi de suite... Nicolas Standaert insiste
aussi sur le pouvoir d’initiative, trop souvent sous-évalué par les historiens, des convertis eux-mêmes, lesquels
en Chine seront les premiers à s’intéresser aux techniques militaires occidentales et qui orienteront les
missionnaires vers la traduction de traités de mathématiques plutôt que vers une traduction intégrale de la Bible.
Un intellectuel chinois tel Li Tianyang, reprenant l’idée exprimée dès 1920 par Liang Qichao, voit une
“ Renaissance chinoise ” dans la période qui s’étend entre l’ère Wanli des Ming et l’ère Jiajing des Qing. Cette
Renaissance a été un produit quasi-direct de l’introduction des “ sciences occidentales ” (xixue) en Chine par les
Jésuites, une introduction fonctionnellement similaire à la redécouverte de l’Antiquité qui préluda à la
Renaissance européenne. C’est à un paradigme renouvelé de l’histoire intellectuelle chinoise, plus ouvert sur le
rôle joué par les interactions avec l’extérieur, que Li Tianyang, avec d’autres chercheurs de sa génération,
appelle ici.
Bien entendu, la suite de la rencontre Chine-Occident passera par nombre de traumatismes. Ce n’est pas ici mon
propos de les analyser, même si nombre d’Occidentaux ont tendance à oublier trop vite les drames et les
scandales que l’histoire de cette interaction porte avec elle. Dans la perspective ici esquissée, l’essentiel est de
voir que, dès le début du dix-septième siècle, un mécanisme de “ globalisation ” du dialogue et des enjeux s’est
mis en place, qui ne s’arrêtera plus , un processus dont la signification est de portée universelle.
Du côté de l’Occident

4
En Europe, la découverte de la Chine, telle qu’elle sera d’abord relayée par les récits des missionnaires jésuites
(les fameuses “ Lettres édifiantes et curieuses ” et d’autres écrits) va jouer un rôle au fond aussez similaire à ce
qui se passe en Chine dans le changement progressif des paradigmes culturels. Contrairement à ce qui s’est
passé avec la découverte des Amériques, la découverte de l’altérité implique celle de l’égalité. Pour un
dix-huitième siècle très sinophile, la Chine s ‘est édifiée sur un modèle et des prémisses essentiellement
différents de ceux qui ont donné naissance à l’Occident chrétien, mais sa civilisation ne semble pas pour autant
pouvoir être déclarée “ inférieure ”. La sinophilie du dix-huitième siècle va de pair avec une relativisation par
l’Europe de son prorpe héritage. La découverte de la Chine est un élément qui déclenche la révolution
intellectuelle des Lumières : diversité, sens du relatif, notion d’une évolution “ génétique ” des cultures, germes
de dialogue interreligieux... toutes les figures de l’Europe moderne sont activées, souvent même suscitées par la
découverte du monde chinois.
Là encore, se produira une réaction en retour. En témoigne la sinophobie croissante qui marquera surtout la
seconde moitié du dix-neuvième siècle. Néanmoins, dès le début du dix-septième siècle, la Chine s’impose
comme “ l’Autre ” de l’Europe, un partenaire égal envers lequel on peut mesurer les ressources et les limites de
sa tradition propre.
Il est donc légitime de dire que l’interaction entre la Chine et l’Occident des dix-septième et dix-huitième siècles
est l’un des axes majeurs à partir desquels la figure contemporaine de la globalisation s’est mise en place.
III- Les figures de l’Occident
Lorsque, le 4 mai 1919, les étudiants chinois manifestèrent, ouvrant alors une ère nouvelle de l’histoire politique
de leur pays, il s’agissait certes pour eux de promouvoir un idéal de “ science et démocratie ” directement
emprunté à l’Occident et opposé à la tradition confucéenne, mais l’occasion directe du mouvement protestataire
résidait dans l’humiliation que les pays réunis à Versailles infligeaient à la Chine en plaçant les concessions
allemandes en Chine sous la tutelle japonaise. Tout au long des deux derniers siècles, l’enjeu pour les
intellectuels chinois a été de trouver une relation à l’Occident qui satisfasse des exigences quelque peu
contradictoires – imiter sans démarquer, apprendre sans se désapprendre soi-même, séparer les “ usages ” des
sciences et des valeurs étrangères de leur “ essence ” présumée, affirmer l’exception chinoise comme la portée
universelle de sa tradition. Conflit entre universalisme et particularité qui, en soi, traverse et travaille toute
culture, mais que les circonstances historiques ont rendu particulièrement aigu et douloureux.
Précisons la perspective historique dans laquelle pareil débat se situe. Par trois fois, “ l’Occident ” a pris un
visage précis pour la culture chinoise, le visage d’un système d’ensemble qui questionnait les fondements
mêmes de sa tradition. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le premier visage de l’Occident n’est autre que
celui du Bouddhisme… Venu de l’Inde, l’enseignement du Bouddha historique se présentait bien comme celui
du “ Sage de l’Ouest ”. De plus, le système spéculatif qu’il apportait avec lui, exprimé dans des langues aussi
différentes que possible du chinois (mais proches en revanche des autres langues indo-européennes) ouvrait à
une appréhension nouvelle du questionnement cosmologique et métaphysique. Entre les quatrième et huitième
siècles essentiellement, se déroula la plus vaste entreprise de traduction réalisée dans toute l’histoire de
l’humanité. La Chine en gardera le goût de la traduction, et les Occidentaux ne se rendent habituellement pas
compte que cela fait d’elle un pays bien plus ouvert aux influences extérieures qu’on ne le pense habituellement.
J’étonne toujurs mes amis français en leur disant que, par exemple, “ Le Rouge et le Noir ” a connu treize
traductions chinoises différentes. En même temps, ce qui frappe un Occidental c’est la façon dont, au cours des
siècles les intellectuels chinois surent faire usage de la métaphysique bouddhiste pour reconstruire et
réinterpréter leur propre système gnoséologique, prétendant revenir par ce biais aux sources originelles de leur
culture dissimulées sous les couches des commentaire successifs. Stratégie du retour au Même par le biais de
l’altérité.
Le second choc venu de l’Occident est celui que nous venons d’esquisser à grands traits : l’irruption conjointe
du christianisme et des sciences et techniques occidentales. Longtemps, les deux n’ont guère été séparés. Par
ailleurs, il s’est produit une conjonction entre les aspirations des réformistes de l’époque, qui prônaient un retour
au confucianisme prétendûment “ originel ” et les enseignements des missionnaires. Ce moment historique fut
l’occasion d’une synthèse intellectuelle et morale spécifique, interrompue par la chute de la dynastie Ming. La
synthèse ainsi réalisée se présentait clairement comme une alternative à la vision du monde que l’accomodation
entre bouddhisme et pensée chinoise avait lentement élaborée. Mais cette alternative se voulait aussi retour aux
origines. Pour les missionnaires, partie prenante de tel débat, ce retour aux origines s’entendait comme une
redécouverte et une appropriation de la “ religion naturelle ” chinoise, elle-même aussi proche que possible de la

5
“ révélation naturelle ” adressée par Dieu à l’humanité.
Le troisième visage que l’Occident revêtit pour la Chine fut celui du marxisme. Il existait pour sûr une
continuité entre l’apport des “ sciences occidentales ” et celui sur lequel le Parti Communiste Chinois allait
prendre appui. Mais le marxisme, même s’il provenait de l’Ouest, se présentait comme un outil de lutte,
d’affranchissement, il fournissait de quoi retourner l’Occident contre l’Occident même, et Mao Zedong sut
utiliser à merveille sa rhétorique pour construire un discours qui fasse droit aux récits, mythes et métaphores de
la Chine. Ainsi, chacun des trois visages de “ l’Occident ” s’est présenté tour à tour comme une alternative au
système précédent, comme une façon pour la Chine d’utiliser autrui pour retourner à ses origines. Qu’en est-il
alors aujourd’hui ?
- IV - Les défis du temps présent
Il s’agit maintenant de croiser notre approche des figures contemporaines de la globalisation avec celle de ses
origines et de ses développements dans l’histoire chinoise, ce afin de discerner plus clairement quelles formes
prendra dans le proche futur le dialogue culturel Chine-Occident. C’est d’une interaction entre contrainte et
liberté qu’il est ici question, de la marge qui est laissée à notre initiative et à notre discernement lorsque nous
naviguons au travers de phénomènes aussi massifs que l’est la globalisation des échanges telle qu’analysée en
première partie.
Du trop peu au trop plein.
Les conditions de la rencontre entre Chine et Occident à l’époque de la Renaissance et du début des Temps
Modernes étaient pour le moins rudes... longueur et risques des voyages (à certains moments, du fait des
naufrages, des pirates et des conflits nationaux, une chance sur deux de périr en mer...), méconnaissance des
textes fondateurs de chacune des cultures... Aujourd’hui, la facilité du contact présente peut-être un risque
inverse. Voyages aisés, traductions multiples, outils de communication de toute nature. Mais cette facilité même
induit une sorte de “commodification ” de la rencontre, la rend superficielle ou entraîne même des malentendus.
On croit avoir compris et on n’a rien compris. Car la différence demeure, et la facilité apparente de la rencontre
cache parfois la profondeur de cette différence.
Le long cheminement de Matteo Ricci nous le rappelle : il n’y a pas de raccourci à la rencontre. L’apprentissage
d’une langue comme celui d’une culture exigent toujours patience, humilité, souplesse. L’entrée dans la densité
humaine des cultures, le pasage d’un inconscient collectif à un autre sont des données indépendantes des
avancées technologiques, et les avancées technologiques elles-mêmes peuvent parasiter la rencontre si nous
croyons qu’elles rendent superflues la patience qu’elle exige.
Globalisation et sentiment identitaire.
On l’observe souvent : la globalisation renforce le sentiment identitaire : les échanges sont vécus comme une
menace lorsqu’ils mettent en cause un style de vie, des produits à haute valeur symbolique (tels des nourritures
du terroir.) A côté du phénomène de globalisation se produit donc un phénomène parallèle de “ localisation. ” Ce
qu’il nous faut noter c’est que cette localisation elle-même est un “construit ” et même plus exactement une
reconstruction, avec des composantes imaginaires. Ainsi, les intellectuels chinois auront tendance à définir leur
identité par une série d’oppositions : contrairement à la culture occidentale, la culture chinoise serait
globalisante, fonctionnerait sur le principe du tiers non exclus, refuserait une démarche de type analytique... Ou
encore, on écrira que l’Occident se fonde sur une vision mercantiliste des échanges qui promeut liberté et égalité
mais détruit toute solidarité organique, tandis que la Chine et son système de lignage ancestral promeut
l’harmonie et la coopération au détriment de la liberté et de l’égalité. Pareilles “ grandes visions ” ne sont pas
entièrement fausses, mais n’ont guère de valeur explicative et mènent souvent à des synthèses par trop abstraites
et artificielles.Ce n’est pas de cette façon que, spontanément, les Chinois d’autrefois se définissaient
eux-mêmes, et certains traits culturels peuvent être durcis ou systématisés du fait même de la rencontre avec
l’autre. L’un des effets de la globalisation c’est donc une quête fiévreuse de l’identité propre. Cette quête peut
être dangereuse quand elle devient “ essentialiste ”, ce qui est souvent le cas en Chine. On cherche à définir une
“ essence ” chinoise, plutôt que de mettre l’accent sur la pluralité des appartenances culturelles, les diversités
régionales, le simple cosntat qu’une identité n’est pas une essence immuable mais le résultat d’une synthèse
historique en perpétuel changement.
L’antidote post-moderniste
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%