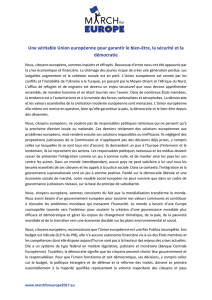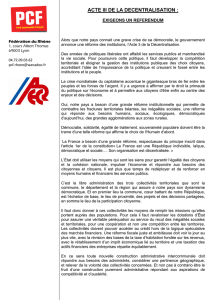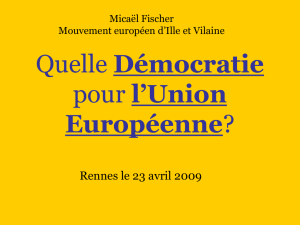gouvernance démocratique - Rationalités Contemporaines

1
Journée d’études doctorales en philosophie politique
organisée par Ludivine Thiaw-Po-Une et Geoffroy Lauvau
( allocataires moniteurs à Paris-IV )
( Salle des Actes, 2 décembre 2003 )
LES DEMOCRATIES CONTEMPORAINES FACE À LA QUESTION DE
LA REPARTITION DES POUVOIRS
La gouvernabilité : entre gouvernement et gouvernance
ACTES DE LA JOURNEE

2
Ludivine Thiaw-Po-Une
Présentation : Sens et enjeux de la problématique de la gouvernance
Gouvernement, gouvernance et gouvernabilité
Si nous nous posons la question de savoir dans quelle mesure nous
pouvons aujourd’hui apprécier, critiquer, voire transformer la cité, cette question
ne nous invite plus à interroger de manière seulement classique le champ du
politique. Les « questions classiques » étaient celle du meilleur régime, qui
apparaît dès Aristote, ou bien encore celle de la séparation des pouvoirs dans
l’Etat telle qu’elle s’est notamment posée à un auteur comme Montesquieu. Ces
interrogations ont été en partie relayées par celle qui nous préoccupe
aujourd’hui, à savoir : « qui doit exercer le pouvoir ? ». C’est alors le problème
de la transformation de l’appareil étatique lui-même qui se pose et plus
précisément, à l’intérieur même de l’Etat, celle du volume des décisions du
pouvoir politique. Ce sont ces problèmes qui nous conduisent directement à
réfléchir à la notion de gouvernabilité.
La question de la gouvernabilité
Cette notion de « gouvernabilité » doit être entendue en un premier sens,
général, à partir de l’interrogation sur la manière de gouverner ainsi que sur
l’aptitude des contextes considérés à se trouver gouvernés de telle manière
plutôt que de telle autre.
Entre gouvernement et gouvernance, la gouvernabilité, tout en dérivant de
ce sens général, est également susceptible de se doter d’un sens plus technique,
apparu dans les sciences politiques des années 1950, chez l’un des plus éminents
représentants de l’école interactionniste, David Easton. Il s’agit alors d’une
mesure de l’efficacité du mécanisme de gestion publique et par là même de la
capacité à créer des trames de gouvernance qui répondent aux besoins en
présence. En ce sens, la gouvernance dépend à la fois du contexte et de
l’agencement entre elles des formes d’organisation retenues par le politique. Si
l’on préfère : elle dépend de l’agencement systémique des « rôles », au sens
sociologique du terme, et non de la diversité des actions sociales menées par des

3
individus qui, conçus comme un ensemble, en viendraient à fournir son sens à la
vie ainsi qu’au système politique
1
.
La gouvernabilité .des démocraties contemporaines semble donc devoir
être repensée en fonction des exigences de sociétés non seulement très
diversifiées, mais encore en perpétuelle mutation. Dans la sphère ainsi définie de
la gouvernabilité, nous connaissons en effet très bien ce que nous appelons
« gouvernement » : il correspond à une autorité officielle dotée des organes
nécessaires à l’exécution de la politique adoptée. Le gouvernenement désigne
alors l’exercice du pouvoir sur une communauté d’individus, et, par extension,
le pouvoir qui dirige un Etat. Aussi, dans le contexte extrêmement mouvant et
diversifié de nos sociétés contemporaines, et si l’on voulait schématiser la
gouvernabilité, s’apercevrait-on sans peine de ce que gouverner s’apparente de
manière frappante à une activité verticale ancrée dans une forte base de
pouvoir : anrée dans une base personnelle pour ce qui est de la propriété ; ancrée
dans une base institutionnelle pour ce qui est de la bureaucratie. Ainsi compris,
le gouvernement désigne donc une activité plutôt centralisée, où le pouvoir est
comme la propriété du gouvernant à laquelle il est nécessaire d’en référer afin de
prendre une quelconque décision, et ce, quel que soit le contexte ( rarement
uniforme pourtant ) où se trouve engendré ce besoin de décision.
La thématique de la gouvernance
Si nous connaissons bien ce modèle politique du « gouvernement », nous
connaissons mal en France la notion de « gouvernance », ou du moins nous
faisons seulement connaissance avec elle. Nous connaissons aussi très mal quels
sont les objectifs de la gouvernance et quelles en seraient les procédures.
Pourtant, cette notion de gouvernance émerge dès le début des années 1990 dans
le monde anglophone où divers ouvrages installent l’idée dans le champ des
débats intellectuels et universitaires, puis dans celui des représentants des
organisations internationales. L’un des plus récents d’entre eux, pour n’en citer
qu’un, est un collectif paru en 2001 aux Presses Universitaires d’Ottawa sous la
direction de deux universitaires nord-américaines ( Linda Cardinal et Caroline
Andrew ), intitulé La Démocratie à l’épreuve de la gouvernance
2
, examine, avec
la collaboration d’universitaires français auto-déclarés comme non spécialistes
de la question, les perspectives ouvertes ainsi que les conséquences impliquées
par ce concept de gouvernance, aussi bien dans le champ social que politique.
Désignant à l’origine le partage du pouvoir entre les différents corps
constitutifs de la société médiévale anglaise, issue des travaux des historiens du
Moyen-Age, la notion de gouvernance n’a en effet cessé durant cette dernière
1
D. Easton, L’agencement du système politique, Paris, A. Colin, 1974.
2
Sous la direction de Linda Cardinal et Caroline Andreww, La Démocratie à l’épreuve de la
gouvernance, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, collection « Gouvernance »,
2001.

4
décennie de pénétrer la sphère de la rhétorique politique. Entré dans le lexique
officiel, le terme de « gouvernance » ouvre en 1992, à Londres, sur un Centre
pour l’étude de la gouvernance globale. En 1995, la Commission sur la
gouvernance globale, mise en place par les Nations Unies, est elle-même
composée de 28 personnalités représentatives de la planète. La problématique
traverse en profondeur les débats européens, notamment depuis l’établissement
d’un « Livre Blanc » par la Commission Européenne sur la gouvernance, portant
entre autres sur la manière dont l’Union utilise les pouvoirs qui lui sont conférés
par ses citoyens. Ce Livre Blanc stipule expressément que depuis le début de
l’année 2000 « l’évolution politique a mis en évidence le double défi auquel
l’union est confrontée : il faut, d’une part, adapter sans délai la gouvernance
dans le cadre des traités en vigueur et, d’autre part, lancer un débat plus large sur
l’avenir de l’Europe ».
Problématique méta-nationale, en l’occurrence européenne, la
gouvernance est aussi devenue, notamment en France, une problématique
nationale : nous rencontrons effectivement le terme sous la forme de ce que nous
commençons à éprouver comme une nécessité d’allègement ou de
déconcentration des procédures dans un Etat. De la sorte, l’Etat lui-même se
trouve concerné au moins de trois manières : sur le plan intra-national ( celui des
rapports entretenus par l’Etat et ses institutions), sur le plan méta-national ( celui
de l’Europe) et sur le plan international (celui de la gouvernance globale ).
Ainsi, sous la forme intranationale, en France comme ailleurs parfois, cette
question de la gouvernance surgit-elle notamment à l’endroit de la
déconcentration de la gestion des territoires, des hôpitaux et des universités. Les
procédures de gestion de ces institutions posent en effet de nombreux
problèmes, non seulement à l’Etat engagé dans cette gestion, mais aussi à la
société concernée par les institutions en question. Par exemple, comment mettre
en œuvre la réfection partielle d’un pont en Lot-et-Garonne sans devoir recourir
à une dizaine de signatures de bas en haut et dont le dossier doit parcourir la
longue chaîne des procédures de décisions, de la région en question jusqu’aux
bureaux ministériels, pour ne revenir que quelques mois plus tard rejoindre le
cabinet des principaux intéressés ? A l’intérieur même d’une institution comme
celle de l’hôpital, qui, lorsqu’il est de taille moyenne, comprend une trentaine de
services de soins, vient à se poser un problème de nature similaire : comment un
directeur peut-il gérer trente chefs de services sans que ses décisions soient
perçues comme bureaucratiques ? Enfin, les universités dans lesquelles nous
évoluons ont elles aussi tendance à souffrir de ce même problème – en sorte
qu’il n’est pas rare que la thématique générale de la gouvernance ait trouvé sur
ce terrain un champ d’application particulièrement significatif.
Question d’application : la gouvernance des universités

5
On peut à cet égard s’inspirer d’un constat suffisamment détaillé dressé
par Georges Verhaegen ( ancien recteur, recteur honoraire de l’Université Libre
de Bruxelles) dans un collectif intitulé L’université en questions, paru en 2001 :
« La première question que l’on peut se poser est : Pourquoi se soucier en
ce moment-ci, de l’efficacité de gestion d’institutions qui existent depuis près de
mille ans et qui ont su surmonter toutes les vicissitudes de l’Histoire, tout en se
transformant pour en arriver aux universités modernes de type humboldtien,
c’est-à-dire des universités dans lesquelles enseignement et recherche sont
intimement associés ? Et jusqu’aux années soixante, et même aujourd’hui pour
certaines universités, c’est le modèle que l’on retrouve partout en Europe, voire
dans le monde. Mais depuis une trentaine d’années, la situation des universités a
évolué rapidement. C’est ainsi qu’en plus de s’occuper de la formation des élites
et d’accumuler le savoir, les universités ont été amenées à développer une série
d’activités connexes, branchés plus directement sur les besoins immédiats de la
société (…) Or ce déploiement s’est passé, et se passe, dans des conditions qui
ne sont guère optimales. En effet, dans toute l’Europe, on a assisté à un
accroissement important de la population universitaire au cours des vingt
dernières années (…) Or pendant cette même période, outre leurs nouvelles
missions, les universitaires ont été également amenés à mettre sur pied une
politique d’internationalisation en réponse aux nombreux programmes lancés
par la Commission européenne ( …) Par ailleurs, malgré des enveloppes
budgétaires étroites, les besoins d’équipement se sont accrus (…) Dès lors,
assurer la gestion efficace d’une université n’est certainement pas une
sinécure ».
Dans un tel contexte se trouvent donc non seulement posées la question
nationale de l’autonomie financière des universités par rapport à l’Etat, ou
encore celle de leur fonctionnement interne, c’est-à-dire à un niveau qui est
comparable à celui d’une institution comme l’hôpital, mais aussi celle, non
moins cruciale, comme l’indique ce texte, de leur intégration à la communauté
européenne. Dans le contexte européen, le problème de l’allègement des
procédures de décision se pose en effet en termes d’autonomie des universités.
Autonomie dont nous ignorons bien souvent qu’elle est posée par la Magna
Charta Universitatum, signée dès 1988 par plus d’une centaine de recteurs,
comme une condition de l’européanisation des universités. Autonomie des
universités par rapport à l’Etat et devenir de cette institution dans les sociétés
démocratiques, autonomie des universités par rapport à la société, mais aussi
intégration des universités et de leurs diplômes dans l’espace européen : tels sont
les problèmes soulevés par ce que nous pourrions appeler « la gouvernance des
universités ». Dans ce cas comme dans d’autres ( celui de l’hôpital par exemple
), c’est la manière même de gouverner qui semble devoir passer par la
discussion et la redéfinition des règles du jeu, si ce n’est démocratique, du moins
politique, dans des espaces et avec des données socio-économiques en mutation.
Dans des sociétés où l’information et la connaissance sont très largement
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
1
/
53
100%