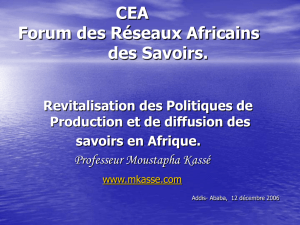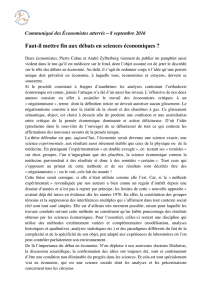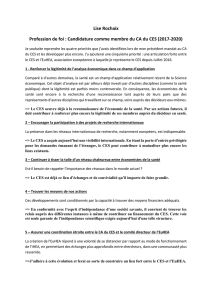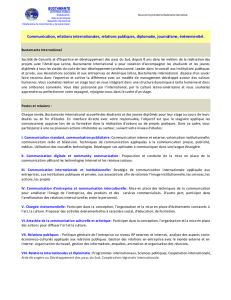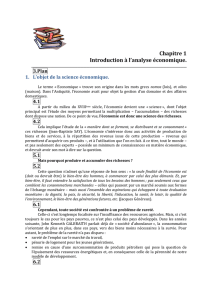La nature, l`écologie et l`économie. Une approche antiutilitariste

Theomai
ISSN: 1666-2830
Red Internacional de Estudios sobre Sociedad,
Naturaleza y Desarrollo
Argentina
Latouche, Serge
La nature, l'écologie et l'économie. Une approche antiutilitariste
Theomai, núm. 4, 2001
Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo
Buenos Aires, Argentina
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12400405
Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org
Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL
THEOMAI, (EDICIÓN ELECTRÓNICA), RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SOCIEDAD,
NATURALEZA Y DESARROLLO/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443
La nature, l'écologie et l'économie. Une approche antiutilitariste
Serge Latouche*
* Universitè de Paris Sud, France. E-mail: serge.latouche@jm.u_psud.fr
L'anti-utilitarisme, en s'attaquant aux racines de l'économie moderne et de l'économisme, ne peut que
rencontrer le souci écologiste du respect de l'environnement. L'élimination de la démesure instituée par un
réenchâssement de l'économique dans le social, voire le retour à un certain réenchantement du monde, ne
peuvent qu'entrer en résonance avec une certaine écologie. Toutefois, notre redécouverte du politique
comme base du commerce social nous préserve de sombrer tant dans la gestion rationnelle de la nature et
de l'environnement que dans le respect béat de la sauvagerie mythique.
Dans la production et la satisfaction de nos besoins matériels, selon la vulgate économique (et utilitariste), le
plus grand bonheur pour le plus grand nombre serait engendré par la concurrence et l'émulation entre les
individus cherchant à maximiser leurs intérêts. Il y aurait une harmonie naturelle de ces intérêts comme si
une main invisible avait créé un ordre providentiel. Cette main invisible permettrait d'éliminer les conflits et
les antagonismes d'intérêts entre les patrons et les ouvriers, comme entre le Nord et le Sud. Même s'il en
était ainsi, cette main invisible permettrait-elle d'éliminer aussi les conflits d'intérêts entre les hommes et la
nature ?
On sent qu'à vouloir pousser le bouchon trop loin, les libéraux sapent les bases même de leur propre dogme.
L'intégrisme de la religion du marché se heurte là à un obstacle d'autant plus difficile à nier que les faits sont
têtus et nous reviennent dans le vécu sous la forme de vaches folles, de changements climatiques et autres
pollutions quotidiennes. L'imposture économique doit donc être dénoncée tant dans ses conséquences
pratiques sur l'environnement que dans ses impasses théoriques.
I L'élimination pratique de l'environnement
L'environnement, pour l'essentiel, se situe hors de la sphère des échanges marchands. Aucun mécanisme ne
s'oppose donc naturellement à sa destruction. La concurrence et le marché qui nous fourniraient notre dîner
aux meilleures conditions ont des effets désastreux sur la biosphère. Jean-Baptiste Lamarck notait déjà :
"L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout
ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble
travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce"
(1).
Rien ne vient limiter le pillage des richesses naturelles dont la gratuité permet d'abaisser les coûts. L'ordre
naturel n'a pas plus sauvé le dodo de l'île Maurice ou les baleines bleues que les Fuegiens (habitants de la
terre de feu). Seule l'incroyable fécondité naturelle des morues risque de les préserver du sort des baleines !
Et encore si les marées noires ne s'en mèlent pas... Le pillage des fonds marins et des ressources
halieutiques semble irréversible. Le gaspillage des minéraux se poursuit de façon irresponsable.
Les chercheurs d'or individuels, comme les garimpeiros d'Amazonie ou les grosses sociétés australiennes en
Nouvelle Guinée, ne reculent devant rien pour se procurer l'objet de leur convoitise. Or, dans notre système,
tout capitaliste, et même tout homo œconomicus, est une espèce de chercheur d'or. Cette exploitation de la
nature n'est pas moins violente ni dangereuse quand il s'agit de fourguer nos ordures et nos déchets dans
cette même nature-poubelle. Incidemment, notons qu'en France un tiers des transports routiers, qui sont
déjà un cauchemar en soi et une source de pollutions multiples, est consacré au déplacement des déchets.
La crise écologique a bel et bien été engendrée par la croissance économique et la poursuite du
développement constitue une menace pour la nature et pour les naturels. On connaît les drames de
l'Amazonie : incendies sauvages, déforestation sauvage, prospection minière sauvage, mise en valeur
sauvage, avec pour conséquences l'extermination des indiens, la disparition des espèces animales et
végétales, des dommages immenses causés aux écosystèmes. Des centaines d'espèces végétales et
animales disparaissent chaque année sous nos yeux (2) tandis que six millions d'hectares de la forêt
amazonienne partent en fumée pour permettre aux grands fazendeiros de faire plus de boeufs et aux petits
de survivre (3). Au niveau planétaire ce sont entre 12 et 17 millions d'hectares du poumon de la terre, soit
l'équivalent de 1% de la planète ou d'un tiers de la France, qui disparaissent chaque année.

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL
THEOMAI, (EDICIÓN ELECTRÓNICA), RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SOCIEDAD,
NATURALEZA Y DESARROLLO/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443
A coté des désastres réalisés et irréparables, il y a les dangers qui nous guettent directement, les pollutions
globales comme l'effet de serre, la mort des océans, la radioactivité, le couple infernal innondation-
sécheresse, sans parler des biotechnologies et du génie génétique. Si on observe quelque ralentissement
dans certaines évolutions, comme celle des trous dans la couche d'ozone, sous l'effet des accords
internationaux (Le protocole de Montréal de 1987 sur les clhorofluorocarbones), eux-mêmes fruits de la
sensibilisation croissante de l'opinion, le nécessaire changement de cap n'est pas encore à l'ordre du jour,
loin de là. Les échecs à répétition de ma mise en oeuvre de la convention sur le changement climatique le
montrent bien.
La foi dans le progrès et la technologie a supporté le culte du développement dans les années 60. Les
économistes ont été les grands prêtres de cette nouvelle religion qui a accompagné l'expansion économique
sans précédent de l'Occident. En dépit de l'apparition de quelques hérésies, le dogme reste toujours
triomphant, sinon triomphaliste. Le pouvoir d'autoregénération de la nature a été occulté, méprisé, détruit au
bénéfice de celui du capital et de la technique. La nature a été réduite à un réservoir de matière inerte et à
une poubelle. Aussi, ce ne sont pas les économistes mais les physiciens qui ont attiré l'attention de l'opinion
sur les pollutions globales comme l'effet de serre ou les trous dans la couche d'ozone. La science économique
et ses prophètes restent dans l'ensemble les chantres de la mondialisation des marchés, laquelle aggrave
encore les effets délétères de l'économie sur l'environnement.
Cette mondialisation actuelle est en train de parachever l'oeuvre de destruction de l'oikos planétaire. Ne
serait-ce que parce que la concurrence exacerbée pousse les pays du Nord à manipuler la nature de façon
incontrôlée et les pays du Sud à en épuiser les ressources non renouvelables. Avec le démantèlement des
régulations nationales, il n'y a plus de limite inférieure à la baisse des coûts et au cercle vicieux suicidaire.
C'est un véritable jeu de massacre entre les hommes, entre les peuples et au détriment de la nature... Il se
trouve même des prix Nobel pour s'en réjouir. Ainsi, l'impayable Gary Becker déclare : "Le droit au travail et
la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-
échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel" (4). On comprend dès
lors toutes les réticences des gouvernements européens à controler les pirates des mers responsables des
marées noires récurrentes.
Dans l'agriculture, l'usage intensif d'engrais chimiques, de pesticides, l'irrigation systématique, le recours aux
organismes génétiquement modifiés ont pour conséquence la destruction des sols, l'assèchement et
l'empoisonnement des nappes phréatiques, la désertification, la dissémination de parasites indésirables, le
risque de ravages microbiens. Sans parler du fait que la sélection des espèces les plus rentables engendre
une inquiétante réduction des sources de l'alimentation humaine. En France, trois races bovines constituent
98 % du cheptel, une seule variété de pomme, la golden, représente 75 % de l'offre. "Une certitude donc,
conclut René Passet : la maladie de l'homme fou se transmet bien à la vache" (5).
Les pays du Sud, pris dans l'étau de la dette, n'ont guère d'autre choix que d'accroître encore plus
l'exploitation des ressources naturelles et des sols au détriment de l'environnement. Il s'agit de comprimer
d'autant plus les coûts, au mépris de la reconstitution ou de la préservation des équilibres naturels les plus
élémentaires, que l'accroissement des exportations déprime les prix et réduisent les recettes. Tous les pays
sans doute sont pris dans cette spirale infernale et suicidaire, mais dans le cas du Sud, la survie biologique
immédiate étant en jeu, la reproduction des écosystèmes est totalement sacrifiée. Pour exporter des grumes,
la forêt tropicale disparaît à grande allure (Cameroun, Indonésie, Papouasie-Nouvelle Guinée) avec comme
conséquences annexes une érosion accélérée des sols (comme au Népal) et l'aggravation des inondations
(comme celles du Mékong).
Les exemples du cacao, de la pêche ou de la banane mériteraient d'être médités pour éclairer les effets de la
mondialisation sur le Sud. Alors que le cours mondial du cacao était au plus bas dans les années quatre
vingt, et que les économies du Ghana et de la Côte d'ivoire subissaient de ce fait une crise dramatique, les
experts de la Banque Mondiale ne trouvaient rien de mieux que d'encourager et de financer la plantation de
milliers d'hectares de cacaoyers en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines. En sacrifiant toujours un peu
plus la nature et les hommes, on pouvait encore espérer quelques profits sur la misère plus productive des
travailleurs de ces pays-là. Pour couronner le tout, les Européens, à Bruxelles, s'alignant sur la seule
Angleterre, ont honteusement capitulé devant le lobby des grands chocolatiers. Définissant le chocolat
comme un produit pouvant contenir jusqu'à 15% de graisse végétale bon marché (Sans vérification vraiment
fiable) autre que du beurre de cacao, ils ont fait perdre à la Côte d'ivoire et au Ghana quelques milliards de
plus. Faut-il se scandaliser si dans ces conditions certains planteurs ont arraché leurs plants pour faire du
haschich ?

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL
THEOMAI, (EDICIÓN ELECTRÓNICA), RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SOCIEDAD,
NATURALEZA Y DESARROLLO/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443
Le long des côtes de l’Afrique, les bateaux-usines et les chalutiers ex-soviétiques, espagnols, bretons,
japonais ruinent les systèmes locaux de pêche à la pirogue et contribuent ainsi à affamer l’Afrique à court
terme et à détruire son écosystème à long terme. On ne sait pas assez qu'en supprimant le pillage des fonds
marins sur les côtes de l'Afrique, on ferait plus pour aider celle-ci, en assurant la survie des pêcheurs
traditionnels et l'approvisionnement en poisson, que par toute l'aide alimentaire.
Le cas de la banane est lié au stabex, ce mécanisme de garantie de recettes d'exportation octroyé par les
pays du marché commun aux pays A. C. P. (Afrique, Caraïbe, Pacifique). Ce système instauré par les
conventions de Lomé (de l à 5) avait été salué un peu hâtivement comme la mise en oeuvre d'un nouvel
ordre économique international. Le prix de la banane acheté en Guadeloupe, en Martinique, aux Canaries ou
en Afrique Noire permet aux producteurs locaux de survivre (avec bien sûr de grandes inégalités de
situation...). Sans être nuls, les résultats ont été médiocres avec certains effets pervers. De toute façon,
c'était encore trop pour les intégristes du libre-échange. Poussés par les multinationales nord américaines,
comme Chiquita Brands (exUnited Fruit) et Castel & Cooke, qui contrôlent l'essentiel de la production et de la
distribution des républiques bananières et des plantations de Colombie, les pays d'Amérique centrale ont
traîné l'Europe devant les panels du GATT puis de l'ORD (Organisation de règlement des conflits) l'instance
d'arbitrage de l'O.M.C. Ils dénoncent les barrières et entraves au libre jeu du marché. Ils veulent à tout prix
accroître leur part de marché grâce aux salaires de misère des ouvriers agricoles, dont des centaines ont
succombé à l'emploi inconsidéré de pesticides (contre les nématodes).
L'OMC leur a donné raison. "Vous menez la pire des guerres économiques contre un peuple sans défense.
Vous emportez nos bananes et vous nous laissez dans la misère, les conflits et la souffrance" a déclaré le
président des planteurs de bananes de la petite île de Sainte-Lucie, en commentant le verdict, fustigeant au
passage la campagne "diabolique" de l'administration Clinton (6). Évidemment, les Allemands, gros
consommateurs, qui rechignaient à payer leurs bananes un peu plus cher que celles de Colombie n'ont pas
été des alliés à toute épreuve dans cette affaire.
A Jacques Chirac reprochant cette trahison à son ami Kohl, et dénonçant les conditions "pire encore que
l'esclavage" de la production sur les plantations américaines, le chancelier allemand a répliqué : "La morale
est une chose, les affaires en sont une autre" (7). Tout est là, en effet ; les affaires ne se soucient pas de
l'environnement, sauf à exploiter les niches rentables créées par les législations protectrices que la pression
de l'opinion publique réussit parfois à imposer. Les industriels de l'écologie, dont Bouyghes avec la SAUR ou
Vivendi sont de bons représentants, ne manquent jamais une occasion de souligner la compatibilité
fondamentale des intérêts biens compris de l'environnement et des affaires...
Légitimée par la théorie économique, la mondialisation réalise de fait la plus superbe ignorance de la nature
sinon pour l'exploiter sans limite.
II L'impossible prise en compte théorique.
La science économique a très largement cautionné les dégâts provoqués par la vie économique. Inconsciente
hier, elle a éliminé progressivement mais radicalement la nature, en accord avec la foi de la modernité dans
le destin de l'homme d'en devenir "maître et dominateur", et convaincue qu'elle était inépuisable. Forcée
d'en voir aujourd'hui les limites, elle s'avère impuissante à l'intégrer pleinement dans son mode de
raisonnement.
Les rapports entre l'économie et l'écologie se nouent ainsi sous le signe du paradoxe. Dans leur sens
étymologique, les deux mots sont, en effet, quasiment synonymes. Tous deux sont issus de l'oikos (la
maison, le patrimoine, la niche), ce qui est de bon augure. On sait pourtant que les écologistes conséquents
sont devenus les plus farouches critiques de l'économie comme théorie (Marx lui-même ne trouve pas grâce
à leurs yeux) et les plus violents adversaires de l'économie comme pratique. C'est que, en intitulant en l6l5 ,
"Traité d'économie politique" ce qu'Aristote eût dénommé avec horreur "La science de l'accumulation
nationale" ou Chrématistique, Antoine de Montchrétien a embrouillé durablement l'affaire. Cette désignation
d'une chose par son contraire n'était peut-être pas innocente et explique le succès et la persistance du
malentendu...

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL
THEOMAI, (EDICIÓN ELECTRÓNICA), RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SOCIEDAD,
NATURALEZA Y DESARROLLO/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443
L'économie politique des Mercantilistes et des Physiocrates accorde cependant à la nature une place centrale.
"Le travail est le père et la nature est la mère de la valeur" dit William Petty. Le docteur François Quesnay et
ses disciples mettent la terre et les forces naturelles au centre de leur analyse. La fécondité naturelle est la
source du produit net et le point de départ du circuit de la richesse. Malheureusement, confondant fécondité
naturelle et productivité de l'activité humaine, les Physiocrates échouent à rendre compte de la part qui
revient à la nature à côté de celle qui revient au travail. Au lieu d'inscrire l'économique dans la biosphère et
d'étudier les contraintes que cette dernière fait peser sur celui-là, ils poseront définitivement l'autonomie de
la sphère économique en la pensant abusivement comme un organisme naturel.
La science économique des classiques sera certes encore naturaliste. La nature qu'ils se sont donnée est
même plus contraignante que celle des écologistes contemporains. Toutefois, elle est construite par
l'économie capitaliste comme une mère avare. La rareté occupe, en effet, une place centrale dans le
dispositif économique. Seulement, cette nature hostile est dénuée de valeur. L'avarice de la nature ne porte
pas tant sur les limites des matières premières que sur la nécessité de leur transformation par un travail
pénible. La rareté des "utilités" marchandes se combine ainsi à l'abondance des ressources brutes. La nature
est hors de l'économie. En adoptant le modèle de la mécanique classique newtonienne, l'économie exclut
l'irréversibilité du temps. Les modèles économiques se passent dans un temps mécanique et réversible. Ils
ignorent l'entropie, c'est-à-dire la non réversibilité des transformations de l'énergie et de la matière. Toute
référence à un quelconque substrat biophysique ayant disparu, la production économique telle qu'elle est
conçue par la plupart des théoriciens néoclassiques, ne semble confrontée à aucune limite écologique (8). La
conséquence en est un gaspillage inconscient des ressources rares disponibles et une sous-utilisation du flux
d'énergie solaire abondant. Comme le note Nicholas Georgescu Roegen, les déchets et la pollution, pourtant
produits par l'activité économique n'entrent pas dans les fonctions de production standard. Ainsi, rien ne
s'oppose plus à la réalisation par la technique et l'économie du programme de la modernité de maîtrise et
d'exploitation totale de l'univers.
Certes, la poussée écologique a obligé les économistes à un aggiornamento de leur discipline et à inclure
l'impact de l'environnement dans leurs modèles. L'économie écologique prétend ainsi prendre en compte la
nature. Seulement, l'économie écologique est loin de remettre en question la logique marchande qui est la
source véritable de la négation de la nature. La dette à l'égard de la nature et la troublante et mystérieuse
solidarité des espèces, en particulier, sont réduits à des dispositifs techniques permettant la transformation
de l'environnement en quasi-marchandises Il en résulte que cette économie écologique est très largement
mystificatrice, et le développement durable qui en découle est une imposture (9).
La tendance dominante dans l'économie standard à considérer le capital naturel comme totalement ou au
moins largement substituable aboutit à évacuer de facto le problème. L'enquête menée par Carla Ravaioli
auprès des trente cinq plus grands économistes de la planète, est révélatrice de l'extraordinaire cécité de la
profession (10). L'expert ignore l'environnement et ne s'en sent pas responsable ! Pour Wilfrid Beckerman,
économiste adversaire résolu de l'écologie, "le problème de la pollution de l'environnement n'est qu'une
simple question de correction d'un léger défaut d'allocation de ressources au moyen de redevances de
pollution" (11). "Le système des prix et le progrès technique assurent les économistes, doivent ainsi
permettre des prises de relais entre les ressources et la poursuite de la croissance économique dans un
univers physique pourtant limité" (12). Seulement, la croyance en l'inépuisabilité des ressources naturelles
sur laquelle reposait le modèle industriel de développement soutenu par les économistes s'est effondrée,
tandis que les sous-produits délétères de l'activité économique menacent la survie même de notre espèce.
Quel que soit l'arbitraire des évaluations faites dans les comptabilités écologiques, on ne peut plus ignorer
que le massacre de la nature limite sérieusement les bienfaits du développement. En l'absence d'évaluation,
on aboutit à des absurdités. Comme le note Robert Repetto, "un pays pourrait épuiser ses ressources
minérales, couper ses forêts, éroder ses sols, polluer ses nappes phréatiques, conduire sa faune sauvage à
l'extinction, la disparition de ce capital n'affecterait pas son revenu mesuré" (13). C'est en gros le cas de
l'Indonésie dont la croissance annuelle du PIB entre 1971 et 1984 devrait être ramenée de 7 à 4 % si l'on
tenait compte de la perte la plus visible du capital naturel (14).
Il a donc fallu tenter d'inclure la nature et l'environnement dans la "rationalité économique", et en particulier
dans le modèle d'équilibre général de Walras et celui de l'optimum de Pareto. Cette prise en compte se pose
principalement à deux niveaux : celui de l'épuisement des ressources et celui des pollutions. Les deux
supposent des traitements raffinés : modèles à soutenabilité forte ou faible pour le premier, internalisation
des effets externes pour le second. L'intégration du problème des ressources non renouvelables, a été
inaugurée par Hotelling en 1931 et a trouvé plus récemment son aboutissement avec la règle de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%