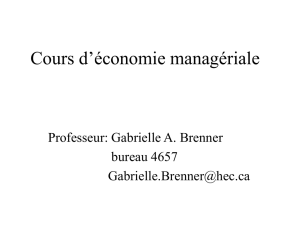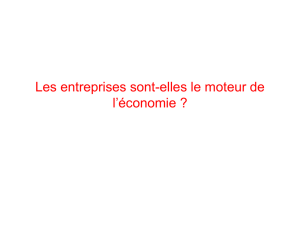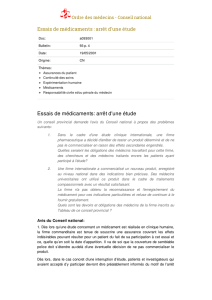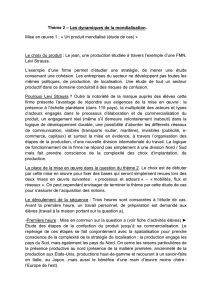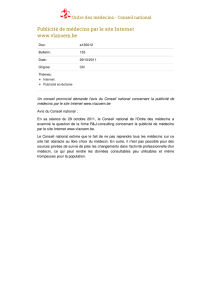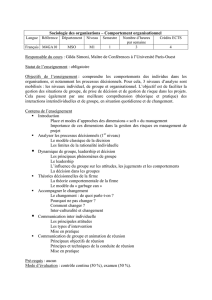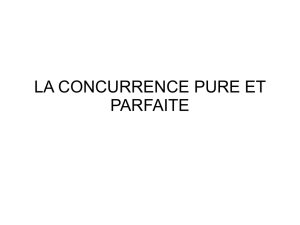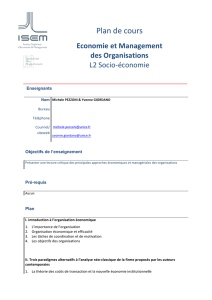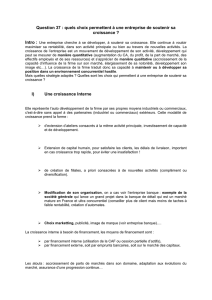PARTIE 2. À l`intérieur de la boite noire : le comportement

1
ÉCONOMIE DES ORGANISATIONS
Les théories des organisations – la découverte (Ménasd, 2004)
L’économie des organisations, Olivier Weinstein et Coriat.
Séance 1 – vendredi 5 octobre 2012 (3h)
Examen : de deux heures. Examen écrit. Sujet : dissertation / questions de cours et de réflexion. Mais même si
Q il faudra rédiger longuement. Possible qu’il y ait un extrait d’article de journal.
Introduction Définitions.
Point de départ des théories des organisations : la notion de firme.
La « firme point » (= ø contenu, creuse): on considère que la firme = un pion dans le marché. Il faut aller au sein
de la firme pour voir comment se créé la richesse.
La firme point de la théorie standard.
Deux parties :
I. De la grande entreprise : on verra (aspect historique) que les entreprises ont commencé à grossir dès
l’apparition des révolutions industrielles. Elles ne sont pas que des pions : elles influent sur le marché. De façon
empirique se développent des stratégies de grandes entreprises et un volet juridique de la part de l’État pour
enrager les manipulations que les firmes peuvent faire sur le marché -> naissance du droit de la concurrence.
1° La méfiance vis-à-vis de la grande entreprise (notamment des pouvoirs politiques)
2° Les structures de marché -> Stackelberg + théorie des jeux. On veut montrer l’aspect
empirique des ≠ structures de marché. Par ailleurs la théorie standard a essayé de valider ces hypothèses,
montrer qu’en monopole ou oligopole on revient à l’équilibre de marché de manière naturelle.
3° Les structures de l’entreprise
4° La théorisation du contrôle et de la propriété
ces deux derniers points sont liés à la notion de la grande entreprise qui cherche à s’organiser et qui va définir
qui fait quoi. Ensuite les théoriciens, dès les années 30 ont cherché à voir comment se passent les relations
entre agents dans les grandes sociétés.
-> dichotomie entre ppté du capital et direction de l’entreprise.
II. A l’intérieur de la boite noire (= firme point) : le comportement organisationnel dans la firme
1° Intégration verticale et l’économie des coûts de transaction : les firmes cherchent-elles à faire
elles-mêmes leur production ou à les faire faire à d’autres ?
2° Incitations et contrats
3° L’information, décisions, contrat
-> on parle de contrat qui permet de faire de la révélation d’information qui est cachée. Importance de
l’information : ex. la capacité à travailler de l’agent. Il existe des mécanismes contractuels qui permettent
d’inciter le salarié à révéler l’information qu’il détient (sur sa capacité de travail) de façon à faire une
coïncidence entre les objectifs du salarié et du manager.
L’information = nécessité pour prendre des décisions. Il faut mettre en place uns système informationnel. Voir
comment les ≠ canaux de transmissions de l’information sont importants pour que la prise de décision soit faite
de la manière la plus pertinente possible.
I. LES DÉFINITIONS
A) Les organisations

2
Mode de coordination des activités économiques. On en trouve trois types qui ont été recensés jusqu’à
présent.
* Le marché pertinent. C’est un lieu de rencontre entre une offre et une demande. Ex. le
marché des ordinateurs / marché des tomates. Il y a ≠ types de marché et sur chacun d’entre eux on va offrir et
vendre des biens et services.
- Marché des services, p. ex. restauration.
- Autre exemple : marché des capitaux (titres financiers, monnaie, devises).
- Ou encore : le marché du travail (offre de travail : salariés potentiels, demande de travail : par les entreprises).
- ≠ entre le marché des tomates et le marché du diamant.
- Marché des enchères / la criée: on aboutit à un prix d’équilibre.
Le 1er mode de coordination c’est le prix. Il sert à l’allocation des ressources. Je suis un consommateur -> acte
de consommation. Il exprime sa demande pour un prix avec une quantité Q. L’offreur quand on lui donne de
l’argent : on fait un transfert de ressources. Le vendeur a transmis le bien, il a fait un transfert de sa ressource.
On a fait une répartition de ressource de façon différente.
Par ailleurs le marché voit différentes structures le façonner.
Monopsone : il n’y a qu’un seul acheteur possible.
* Firme : unité économique autonome qui combine et rémunère les facteurs de production
(capital (K), travail (L), la terre) afin de produire des biens et/ou des services en les vendant sur le marché. On
peut substituer du capital au travail, mais pas toujours. Ex : dans l’industrie pharmaceutique : la recherche. On
met du capital pour avoir les moyens techniques de faire de la recherche. Mais on a surtout besoin d’équipes
de recherche.
Le terme d’allocation de ressources existe à l’intérieur de la firme.
On rémunère le capital : si la société est cotée en bourse. Le capital est divisé entre plusieurs actionnaires qui
sont rémunérés par des dividendes. Mais s’il s’agit de titres de créance (prêt), ils sont rémunérés par les
intérêts. On fait donc de l’allocation de ressource : on donne des ressources aux différents agents économiques
de manière ≠ qu’avant qu’on les rémunère.
Hiérarchie / Organisation intégrée = firme
Pourquoi existe-t-il des firmes dans l’économie, car les marchés s’occupent d’eux même de faire de l’allocation
des ressources ? Pourquoi l’entreprise fait-elle de l’intégration pour certaines choses et pas pour d’autres ? Ex :
pourquoi l’industrie automobile c’est essentiellement une activité de design et d’ingeenerie technique, et de
l’assemblage, et le reste c’est de la sous-traitance. -> réponse au fil de ce cours. Élément de réponse : grâce aux
entreprises, on peut réaliser des économies d’échelle.
Économies d’échelle : économie que l’on fait qu’on amortit les coûts fixes. Elles sont permises par l’échelle de
production : plus on peut produire plus on peut amortir les coûts fixes. Problème : si on augmente beaucoup la
production, il y aura des coûts fixes supplémentaires.
La firme : comme elle produit plusieurs biens (plus que si c’était chaque individu qui produisait tout seul), donc
elle peut réaliser des économies d’échelle donc être plus productif. Générer plus de création de valeur.
On peut également réaliser des économies d’envergure / économies de gamme.
Économie d’envergure / de gamme : si une firme choisit d’intégrer de manière horizontale, de faire un
conglomérat. Ex : l’entreprise VHM qui se concentre sur l’industrie du luxe mais qui fait d’autres choses comme
le cognac, des supermarchés, de la haute couture (Dior). Ces activités ont un point commun : de concentrer des
biens supérieurs ou luxueux dans chacun des secteurs d’activité.
Mais le but peut être de réaliser des économies d’envergure. Un groupe publicitaire peut réfléchir à l’ensemble
de l’image du groupe (une seule équipe plutôt que 25). On peut aussi avoir des économies d’envergure sur le

3
système d’information comptable : un seul service de comptabilité avec un seul logiciel qui vont pouvoir être
utilisés par toutes les unités de production.
Donc faire des économies de gamme c’est réussir à utiliser des ressources, un savoir-faire pour différents types
d’activité à l’intérieur d’une même firme.
Droit de décision
Droit de propriété
Droit d’usage
L’appareil productif appartient au propriétaire du capital : il décide quand est-ce qu’on peut l’utiliser et qui. ->
droit de décision. Mais il peut autoriser d’autres personnes à avoir le pouvoir de décision.
Ex : Kerviel, la société générale lui a transféré le droit de décision.
Il y a une dissociation des intérêts de chacun. Le salarié : ça va être de gagner des primes. Le manager : le
prestige de manager une grande entreprise. Le propriétaire : avoir des gains.
* Forme hybride : elle se situe à l’intersection entre firme et marché.
Ce sont des arrangements institutionnels reposant sur des accords de longs termes
entre des partenaires qui maintiennent leur autonomie de décision et des droits de
propriété distincts tout en acceptant une coordination partielle sur un segment de
leur activité et/ou de leur domaine de décision (Menasd, économie des
organisations, la découverte (2004)).
Si on décompose la définition : ce sont des partenaires qui vont interagir ensemble, p. ex. Toyota et son sous-
traitant. Ils ont le contrôle de l’utilisation des ressources qui leur sont propres, sauf qu’ils acceptent sur une
branche de leur activité d’œuvrer ensemble de façon coordonnée, et donc de mettre entre parenthèses leur
distinction de droit de propriété.
On va considérer que ce sont des relations de long terme, on peut parier que le sous-traitant de Toyota aura
plus d’incitations de produire un produit dédié à Toyota.
Joint-venture : deux entreprises mettent en commun des moyens pour un projet commun. C’est une
entreprise à plusieurs. entreprise commune. contrats de Joint Venture
Franchise : On peut trouver des franchises automobiles.
Réseau de producteurs indépendants ou non qui vont utiliser une marque, un moyen de production,
technique de production ou de vente commune.
La franchise : une présentation commune à tous les acteurs : un aménagement du local reconnaissable par le
client, une technique de vente, des produits référencés qui seront communs à toutes les succursales. Ex :
Subways, McDonald.
Une franchise peut être en nom propre : les succursales appartiennent à la marque. Cependant des franchisés
indépendants peuvent acheter le droit d’utiliser la marque. Ils ne sont pas salariés, ils sont indépendants.
La marque collective : pour avoir le droit d’utiliser une marque collective, il faut répondre à des conditions. P.
ex. pour le pain, on doit s’approvisionner dans des producteurs de blé particuliers, on accepte de suivre un
processus de production particulière.

4
≈ Label de production : appellation d’origine contrôlée, p. ex. « jambon de Bayonne », « Roquefort ». Il faut
avoir suivi un certain processus de production pour éviter les opportunistes qui voudraient donner leur nom à
des produits qui n’en sont pas.
Alliance de recherche
Réseau : méthode de production qui appartient à la forme hybride. Quand on est franchisé on est dans un
réseau. Mais tous les réseaux ne sont pas des franchises. On peut décider de faire une recherche p. ex. suivant
un réseau de recherche mondial où on accepte de temps en temps de travailler ensemble.
Les réseaux peuvent avoir des formes multiples. Ex : comment des médecins font ensemble de la production
médicale partout en France.
Firme + Marché : il y a une forme de marché intérieur dans l’
entreprise. Il y a une forme de compétition au sein même de la firme,
sollicitée par le manager.
Hybrides + Marché :
Hybride + Firme : Une joint venture va avoir des traits communs avec
l’organisation de la firme (apports de capitaux, fonctionnement
hiérarchique). `
Ex. réseau avec le médecin. Si jamais il y a un coordinateur du réseau
il va disposer d’une forme d’autorité. Hors les médecins ne doivent pas ingérer dans la médecine d’un confrère.
Même si le système est hiérarchique, ex. le chef de service de cardiologie = sommet hiérarchique, cpdt il n’a
pas le droit d’intervenir directement. Il peut fait des recommandations (budgétaire), donner des conseils et de
l’expertise.
S’il y a une coordination pour une activité de recherche et de consultation dans le cadre d’un réseau, on peut
demander p. ex. aux médecins de faire une réunion tous les lundis matin. Le coordinateur peut proposer la
manière dont vont s’organiser les réunions. Il peut y avoir un rapprochement avec le fonctionnement de la
firme.
Des auteurs ont commencé à s’intéresser à la firme, assez tôt dans le 20ème siècle, en 1926 par Scraffa.
En 1933, Mme Robinson.
En 1937, Ronald Coase qui a écrit un article fondateur « pourquoi les firmes existent ? »
-> la théorie éco = incomplète -> il faut étudier la firme. Naissance de la micro-éco.
Alfred Chandler, 1962. Il a produit des articles qui relatent l’histoire de la firme. A permis de comprendre ce
que sont les grandes entreprises. Il les a formalisés. Il a aussi écrit un livre qui répond en quelque sorte à Adam
Smith.
Ménard 1997. Williamson, 1985, 1991.
B) Un arrangement institutionnel.
Ce sont les dispositifs légaux mis à la disposition des agents pour organiser une production, ils peuvent être
- le recours au marché
- la constitution d’une firme
- la constitution d’un arrangement hybride entre plusieurs entreprises
Et qui définissent des droits : la propriété et l’usage ou la décision.
Firmes
Marché
Hybrides

5
Mais également des fonctions : les tâches, les postes.
Quand on décide de recourir au marché, on a recours à de la division du travail. Si on fait produire à un sous-
traitant, on fait de la division du travail, même en dehors de la firme.
On dit qui fait quoi, qui occupe quel poste. Ça provient des droits qui viennent des arrangements
institutionnels. Ex : un salarié a le droit d’utiliser une machine (= droit d’usage provenant du contrat de travail)
et son poste est défini par un certain nombre de tâches.
Elle a le droit à un droit de décision dans le cadre de son travail.
C) Environnement institutionnel
= Ensemble des règles stables, abstraites et impersonnelles qui proviennent de lois ou de coutumes et qui
guident les actions et comportement des agents.
Stable : continue dans le temps jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une nouvelle règle.
Elles guident le comportement des agents. P. ex. quand on a mis en place les 35h, les managers et entreprises
ont été contraints de modifier les contrats de travail, ainsi que l’organisation du travail. L’environnement
institutionnel va influencer les arrangements institutionnels. Si on a mis en place à un moment des SARL, c’est
parce qu’il y a eu un besoin ressenti par les agents économiques auquel ont répondu les institutions.
Des coutumes peuvent devenir des règles de droit grâce à des stratégies de la part des entreprises, comme les
lobbys. On peut faire un contrat d’entreprise car l’environnement institutionnel nous donne le cadre pour le
faire. Les firmes vont mener des actions pour faire en sorte que l’environnement institutionnel agisse en leur
faveur.
Enfin les individus qui agissent à partir de l’environnement institutionnel (sur le marché, dans la firme, dans les
formes hybrides) vont adopter des comportements et des incitations qui vont émaner directement de
l’arrangement institutionnel.
Séance 2 – vendredi 12 octobre 2012
D) La propriété
= droit conféré par la loi sur un bien (meuble/immeuble/corporel/incorporel) qui donne la possibilité de
recueillir les fruits du bien (le fructus) / d’utiliser ce bien : l’usus / d’en disposer (l’abusus) : le céder, le modifier,
le détruire.
On va pouvoir faire des contrats sur ces différentes types de droit. Ils peuvent être négociés. Au delà, mutuel
accord entre les deux personnes, p. ex. vendre le bien. Au delà de la négociation on peut voir ces droits être
bafoués, p. ex. si un tiers s’approprie le bien ou la rente du bien.
Ils peuvent faire l’objet de contrats (arrangements institutionnels). Ces droits confèrent une source d’autorité
dans la firme.
Le fait d’être propriétaire p. ex. de l’abusus confère au propriétaire de cet abusus le droit de disposer
du matériel de la firme, une certaine autorité vis à vis des salariés quant à l’utilisation de l’outil de production.
Des agents économiques peuvent chercher p. ex. à abuser d’une position dominante par
l’intermédiaire du contrat.
E) La décision
Le droit de propriété confère une autorité sur les biens possédés. La décision qui va être prise
nécessite une information. Elle va permettre d’obtenir la possibilité de prendre une décision optimale.
(Plusieurs théories -> les agents économiques = rationnels / ≠ rationalité limitée).
Le pb d’internet : l’information est-elle fiable ? Comment la trier (abondance d’informations) ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%