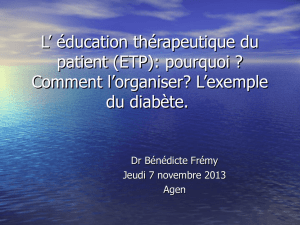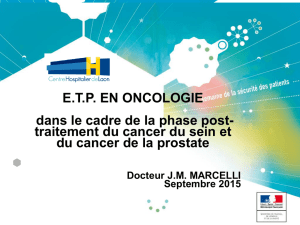L`ETP constitue une prise en charge d`un patient dont la maladie

18/04/17
– 1 – / 5
EN S E I G N E M E N T D I R I G E : L ’ E T P
INTRODUCTION
L’ETP signifie l’éducation thérapeutique du patient.
Il s’agit dans le cadre de l’ETP d’intervenir en tant que praticien (venant de praxis = pratique) pour parler d’un enjeu de santé. On va parler de
l’ETP comme d’un sous-ensemble de l’éducation à la santé.
L’éducation à la santé est divisée en groupe notamment celui de l’éducation à la santé du patient lui même comportant un sous-groupe qui est
l’éducation thérapeutique du patient.
Cependant, l’ETP est présentée en règle générale par des non-thérapeutes ; on en vient à se poser la question de la légitimité pour parler de
l’ETP ainsi que des enjeux institutionnels.
Dans les textes, l’ETP est passée dans la loi HPST : hôpital santé territoire.
On va s’appuyer sur un cadre référentiel c’est-à-dire sur les textes de loi dans une première partie puis on va prendre connaissance de la propre
expérience du professeur Lalau.
I. Définitions, finalités, recommandations
Texte servant de support : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_-_definition_finalites_-_recommandations_juin_2007.pdf
Le texte sur lequel nous nous appuyons est destiné à l’ensemble des professionnels de santé, aux patients et aux associations ; en résumé à
l’ensemble du champ concerné par l’éducation.
A. Qu’est-ce que l’éducation thérapeutique du patient ?
Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour
gérer leur vie avec une maladie chronique.
Selon le professeur Lalau, il y a dans cette définition plusieurs termes posant problème.
Tout d’abord, il entend d’une société qu’elle mette en place des structures visant à aider les patients. Ici le mot « compétence » gêne ainsi que
le terme « gérer » : la compétence renvoie seulement à une technique et gérer à la gestion. Le professeur Lalau ressent cette définition de la
manière suivante : il s’agit de gérer leur vie avec une maladie chronique. Les patients doivent accepter la maladie, ils doivent accepter la
difficulté pour vivre avec et pour mieux vivre avec. C’est une sorte d’adjonction : la maladie est un appendice à la vie.
Exemple : un patient dira plus souvent « je suis diabétique » → état du sujet lui même que « j’ai attrapé le diabète » → modèle exogène. La
maladie n’est pas une option ajoutée.
Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient.
Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de
l’organisation et des procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs familles) à
comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à
maintenir et améliorer leur qualité de vie.
Ici encore, la définition pose problème ; en effet, on a l’impression que l’on est au service de la maladie, d’être mis sous tutelle. Nous sommes
sous l’égide de la maladie.
Il faut réagir face à la maladie. Le psychique est d’un côté, et le social de l’autre, ces dimensions peuvent être associées mais ce plum-pudding
psycho-social n’est pas acceptable. C’est un verbiage, il ne voit pas s’instaurer les choses sous l’égide de l’humain. Comme la maladie est
externe, nous combattons la maladie. Les médicaments sont des « anti- quelque-chose ».

– 2 – / 5
B. Quelles sont les finalités de l’ETP ?
L’éducation thérapeutique du patient participe à l’amélioration de la santé du patient (biologique, clinique) et à l’amélioration de sa qualité de vie et à celle de ses
proches. Les finalités spécifiques de l’éducation thérapeutique sont :
→ l’acquisition et le maintien par le patient de compétences d’auto-soins. Parmi elles, l’acquisition de compétences dites de sécurité vise à sauvegarder la vie du
patient. Leur caractère prioritaire et leurs modalités d’acquisition doivent être considérés avec souplesse, et tenir compte des besoins spécifiques de chaque patient
→ la mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation3. Elles s’appuient sur le vécu et l’expérience antérieure du patient et font partie d’un ensemble
plus large de compétences psychosociales.
Tout programme d‘éducation thérapeutique personnalisé doit prendre en compte ces deux dimensions tant dans l’analyse des besoins, de la motivation du patient
et de sa réceptivité à la proposition d’une ETP, que dans la négociation des compétences à acquérir et à soutenir dans le temps, le choix des contenus, des
méthodes pédagogiques et d’évaluation des effets.
L’analyse des besoins réfère à de la physiologie.
L’auto-soin correspond à ce qu’un patient fait pour lui même. L’autonomie est visée. On s’accorde pour que le mieux-être du sujet malade avec
une maladie chronique s’autonomise et donc peut poursuivre ses soins. Mais ce n’est pas le cas → exemple avec le diabétique ; il est nécessaire
d’avoir un médiateur pour lui apprendre à doser son insuline. Un apprentissage est requis.
Les maladies chroniques représentent 80% des problèmes de santé.
L’ETP est née de la diabétologie ce qui lui donne une légitimité de plus.
Il existe une difficulté entre l’accompagnement, l’apprentissage, l’information… L’ETP doit donner une information de qualité puis un suivi.
Exemple du diabète
Vous allez rencontrer un sujet diabétique en consultation, vous allez lui demander qu’est-ce que c’est le diabète ? Il n’est pas exclu qu’il va vous
redonner une définition issue du web. Vous changez de posture et vous demandez à la personne comment elle comprend son diabète ? La
réponse sera différente.
Ce qui est intéressant c’est de savoir si c’est la patient qui s’est attribué sa maladie ou si c’est sa famille qui l’a poussé à consulter.
Un patient arrive en consultation avec des feuilles de résultats de laboratoire évoquant une glycosurie et une glycémie. Vous évoquez avec
prudence s’il vient pour un diabète → il blanchit.
Le diabète réfère à la grand-mère qui a fini avec une cécité, une jambe en moins… Mécanisme de défense et il n’a pas pu se faire à l’idée qu’il
avait un diabète en voyant la biologie. Le patient n’est pas observant.
Deux dimensions à faire vivre à la fois : mieux-être du patient et réduire le handicap pour la société.
Les compétences d’auto-soins
→ Soulager les symptômes.
→ Prendre en compte les résultats d’une autosurveillance, d’une automesure.
→ Adapter des doses de médicaments, initier un autotraitement.
→ Réaliser des gestes techniques et des soins.
→ Mettre en œuvre des modifications à son mode de vie (équilibre diététique, activité physique, etc.).
→ Prévenir des complications évitables.
→ Faire face aux problèmes occasionnés par la maladie.
→ Impliquer son entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et des répercussions qui en découlent.

– 3 – / 5
C. Comment s’intègre l’ETP à la stratégie thérapeutique ?
L’ETP constitue une prise en charge d’un patient dont la maladie chronique a été détectée, on le propose avec le traitement (ordonnance pour
insuline par exemple).
Pour mettre en œuvre l’ETD, nous disposons d’une sorte de figure imposée :
- 1° on commence par élaborer un diagnostic éducatif : connaître le patient, ses besoins, ses attentes, sa réceptivité à la proposition de
l’ETP, appréhender les différents aspects de la vie et de sa personnalité, évaluer ses potentialités, prendre en compte ses demandes
et son projet, appréhender la manière de réagir du patient et ses ressources personnelles, sociales, environnementales
« réceptivité » : comme si on était au service du patient revient à faire le tour du malade avant de commencer l’action
très intrusif.
Il faut attendre que la demande soit un peu plus personnalisée
Faire le tour de la personnalité : acte intrusif
- 2° définit un programme personnalisé
- 3° planifie les choses et mettre en œuvre ETP
- 4° évalue les choses mises en place

– 4 – / 5
Les personnes venant nous voir, attendent des choses. La demande cache des motifs bien plus réels. Il faut déjà avoir accompagné la personne
en allant pour faire apparaître la personnalité. Le savoir de la personne est inclus dans le domaine de la biopoïétique (Foucault).
II. De l’évaluation de l’action des pôles de prévention et d’éducation du patient à risque
cardiovasculaire à l’autoévaluation des patients
- 1994 : Les prémices du programme. À l’époque, on avait intégré un programme régional de santé concernant les maladies cardio-
vasculaires. Pour faire de la prévention quant à ces maladies, sont venus le premier jour de l’invitation par la DRASS de l’époque : les
cardiologues ainsi qu’un peu d’endocrinologues et sont restés les endocrinologues qui ont du légitimer leur présence. En effet,
l’endocrinologie est en amont des maladies cardio-vasculaires (nutrition … ).
- 1996-1997 : Les endocrinologues ont du se légitimer d’être là en prévention. Les facteurs de risque sont nutritionnels avant tout. Dans
le cadre de ce programme, on a eu l’idée de construire une structure référente en prévention cardiovasculaire pour les personnes qui
ont eu un accident ou pour les personnes ayant des facteurs de risque. Mais, il faut que cela s’appelle « éducation et prévention du
patient » pour débloquer les fonds. L’édification des structures se fait par région sanitaire et par zone régionale.
L’éducation du patient passe par les représentations du patient. Tant qu’on n’a pas pris appui sur ce que pensent les patients, on ne peut pas
faire d’éducation.
Si on demande au patient comment il sont arrivés au problème cardiovasculaire : ils ne savent pas. Il n’y a pas de prévention à l’hôpital, mais
seulement de l’extérieur.
« À votre avis, qu’est-ce qui a pu donner chez vous cet événement ? »
→ Les personnes ne comprennent pas ce qui est arrivé. Les mots angor et coronaire posent déjà un problème. Ces personnes ne seront pas
armées contre des récidives. Il faut sensibiliser à l’hôpital, mais appuyer la prévention en dehors. La plupart des médecins n’ont pas la culture
de la prévention. C’est une tâche aveugle de leur métier. Ils pensent que s’ils adressent les patients à des préventologues, ils ne font pas mieux
qu’eux. Il faut réduire le risque de nouveaux événements : cela ne passe pas par la médication.
Un pôle, des missions
- éducation thérapeutique
- formation initiale et continue
- information du public
- accompagnement de projets
- communication
- collaboration entre les pôles
- recherche en éducation
- mise en réseau/partenariat
L’idée ce n’est pas d’avoir un pseudo-pôle de l’hôpital en matière de prévention. L’idée est de former dans le même temps divers
professionnels.
ARS : agence régionale de santé. Elle reconnaît des parcours spécialisés en éducation mais par pathologie. C’est toujours par rondelle, jamais
pour une personne.
→ Hannah Arentd (disciple de Heidegger) « on n’éduque pas un adulte, sinon pour le dominer ». La maladie fragilise, elle n’infantilise pas. On ne
change pas d’état. Il y a le moment pour éduquer (ex ducare = sortir de) après, on forme.
À Amiens, ateliers de groupes : patients reçus par adressage médical exclusif (pour que les médecins s’approprient) :
- équilibre alimentaire
- graisses : quantités
- graisses qualités
- facteur de risque
- lecture des étiquettes
- vivre sans tabac
- activité physique
- HTA
- Les sauces
- Connaissance du diabète
- Diabète et pieds
- Diabète et alimentation
- Repas équilibré
- Habillement (obésité)
L’enjeu c’est le rapport à l’assiette, au miroir, à l’échange. On dépasse le plan de la psychologie de nutrition, le but c’est le mal-être de la
personne.

– 5 – / 5
Avant de commencer l’éducation, il faut savoir quels sont les différents composants de la personnalité : dimension socio-professionnelle, la
dimension cognitive (ce qu’on sait), psycho-affective, le projet de vie.
Ateliers de groupe (force des ~) : lieu d’émergence des représentations. Aide par les pairs = dynamique de groupes. Tout le monde n’est pas
à traiter par les groupes. Il ne fait pas contraindre mais convaincre.
L’évaluation : une évidence ?
La grosse difficulté pour ce genre d’exercice est l’évaluation.
On a invité des médecins à venir avec leurs propres patients. Parce que si on travaille bien et que les médecins prennent part à l’expérience, ça
fonctionne.
Aide à l’acquisition des événements. Il faut toujours expliquer au patient.
ETP : aider les personnes à prendre appui sur leurs propres ressources pour une évolution des pratiques dans un sens favorable.
C’est un paradoxe : la prévention ça ne coute rien, et personne n’en fait. Le curatif coute la peau des fesses. Mais on doit montrer avant de faire
des plans de prévention que l’on va être efficace.
L’évaluation, une nécessité :
- efficience
- coûts
- Activité : nombre de patients
- processus
- contenu : ce qu’on y fait
- effets attendus
- effets inattendus
- objectifs
- résultats
- efficacité
- impact : tous les mots de la prévention sont des mots issus de la prévention militaire américaine. Quasi-infectiologique.
- Implantation
À côté de ce que l’on a montré, subjectivité du patient : avant on a fait de l’objectif. Comment objectiver une subjectivité ?
→ trois dimensions :
- institution : activité, processus
- les effets du point de vue du patient = plan biomédical, cela concerne l’institution et le patient (critère externe et interne exemple :
poids, cholestérol)
- auto-évaluation du patient
Il faut les articuler ensemble.
CONCLUSION
La prévention doit être éthique, légale et bonne à faire. Elle doit montrer ce qui est objectivable, avec un infini respect et prendre appui sur ces
dimensions.
Comment montrer que l’on a créé une alliance thérapeutique ? Comment elle s’instaure ? Comment elle se restaure ?
L’ETP ce n’est pas un mal nécessaire, ce devrait être la tension assumée entre une norme sociale pour la prise en charge des affections
chroniques dans le même temps qu’elle s’inscrit dans les normes de vie. C’est penser en articulation.
1
/
5
100%