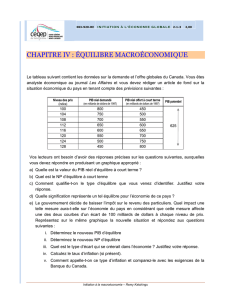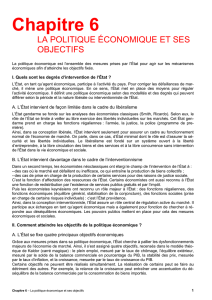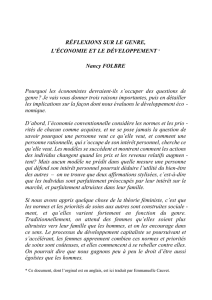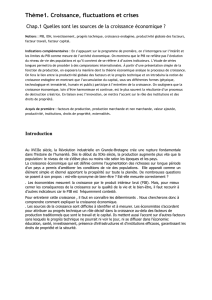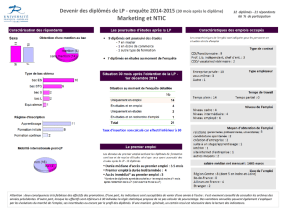Texte 2 - Extranet Paris School of Business

Economie pour Managers
Année : B1
Semestre : 2
Responsables du cours : Clémence AUBERT-TARBY, Raphaël BOROUMAND, Šárka HORAKOVA,
Marjorie LECERF, Alexandra LE CHAFFOTEC, Nessrine OMRANI, Thomas PORCHER, Pierre-Alain
TAILLARD
Introduction générale
I. TEXTES
Texte 1
Sur les modalités du développement de la science économique
Pascal Petit, Revue économique, 2007
La science économique a toujours fait l’objet de fortes contestations tant internes qu’externes. Son objet,
l’analyse des activités (règles et comportements) de production et d’échange dans des univers où les intérêts
sont conflictuels, l’explique aisément. Mais la capacité de la discipline à traiter des questions les plus diverses,
à devenir un cadre rhétorique obligé dans un nombre grandissant de débats sur tout ce qui touche à
l’organisation de nos sociétés, invite à voir cette remise en question permanente comme une source de son
dynamisme.
Dans des sociétés toujours plus portées à développer des procédures d’évaluation, qu’elles concernent
diverses transactions ou les politiques menées, une telle appréciation critique de la discipline paraît d’autant
plus opportune que cette évolution de nos sociétés engage plus fortement les économistes dans des
stratégies de professionnalisation qui influencent les développements de la discipline. […] L’omniprésence du
discours économique dans le débat politique va de pair, en effet, avec une contestation parfois radicale de la
discipline tant de la part des membres de la profession, divisés sur les orientations à suivre, que de la part des
étudiants qui la critiquent ou s’en détournent, dénonçant son incapacité réelle ou supposée à répondre à
certaines questions fondamentales.
Ce qui est en jeu et qui fait l’actualité et l’importance du diagnostic recherché, c’est le devenir même de
l’économie, non pas en tant que milieu académique, fonctionnant sur lui-même et se reconnaissant dans une
maîtrise commune de méthodes de recherche bien établies, mais comme un champ disciplinaire bien identifié
par son objet et son corpus théorique. En d’autres termes, que penser de l’hypothèse souvent émise selon
laquelle l’économie se scinderait en champs spécialisés tendant à s’autonomiser tant par leur objet que par
leur méthode ? La question est pourtant d’autant plus pertinente que la rhétorique économique prend une
place grandissante comme outil de gestion dans l’ensemble des activités économiques dont la complexité
s’est généralement accrue, avec une internationalisation plus poussée, un contrôle plus intense des
partenaires financiers et des rapports plus directs entre développements scientifiques et industriels.

[…] La définition classiquement citée de l’économie que donne Robbins dans les années 1930 est, à cet
égard, quelque peu trompeuse : « La science qui étudie les comportements humains comme satisfaction de
besoins par utilisation de ressources rares répondant à plusieurs usages possibles. » Cette formulation
semble paraphraser un programme d’optimisation individuel face à un ensemble de choix prédéfinis. Cette
perspective semble à mille lieux des interrogations sur les dynamiques interdépendantes de la production, de
la répartition, de l’investissement et de la consommation qui occupaient les classiques. Certes, cette
perspective macroéconomique n’est pas exclue, mais la formulation de l’objet de la science économique
n’apparaît pas complète.
Or, […] la définition de l’objet retenu par la discipline en question doit être prioritaire et déterminante. Walliser
[2006] fait une présentation structurée du cadre ontologique de la discipline, distinguant un niveau psychique
(pour les croyances et préférences), un niveau comportemental (lieu des hypothèses de rationalité et
d’information) et un niveau social (lieu des interactions régulées ou équilibres).[…]
Un renouveau de l’empirisme ?
[…] Cette percée des travaux empiriques dans les publications les plus citées a eu un effet cumulatif, en
favorisant la mise au point et l’exploitation de bases de données microéconomiques et sectorielles allant bien
au-delà des bases de données de la comptabilité nationale usuelle. […] L’attraction du chiffre, la fascination
pour les traitements statistiques et économétriques qu’il autorise font courir des risques au sérieux de certains
travaux. Cela peut conduire à privilégier des questions « mineures » pouvant donner lieu à des réponses
précises, le clean identification movement dont Levitt, rendu très célèbre par son ouvrage Freakonomics
(2005, co-écrit avec Dubner), est un zélateur. Cette focalisation sur des questions marginales ou isolées n’est
pas le seul risque encouru par l’attrait du quantifiable. Des comparaisons internationales analysant les
conditions de la croissance peuvent mêler des nombres peu comparables, concernant des économies très
diversement monétarisées par exemple. La connaissance des limites de ces travaux empiriques passe par
une appréciation de ce qu’en disent les autres disciplines. L’exercice est délicat car il implique, de toute façon,
un certain réductionnisme qui doit rester raisonnable. Mais cette « culture » de la donnée avec ce qu’elle
implique d’interactions avec les autres disciplines reste un impératif de pertinence dans le développement des
travaux empiriques en économie, que ne doivent pas réduire à la portion congrue les savoir-faire dans le
traitement des données.
[…] L’ouvrage récent très médiatisé de Levitt et Dubner [2005] pousse assez loin (jusqu’à sortir du champ de
l’économie ?) cet activisme en appliquant sa méthode pour répondre à des questions sur les aspects les plus
variés de la vie en société (le plus souvent, les actes criminels et la vie en famille). En s’attaquant à des
questions habituellement réservées aux sociologues ou aux psychologues, les économistes multiplient les
contacts avec les autres disciplines en favorisant les collaborations et les dialogues mais avec les
scientifiques de ces autres disciplines qui suivent des méthodes semblables. Il est difficile de parler
d’impérialisme dans la mesure où l’économie cherche moins à participer aux débats des autres disciplines et à
les dominer qu’à élargir le champ de l’application de sa méthode à l’intention de la communauté des
économistes. Se croisent ainsi sur un même domaine des discours séparés. […]
Questions
1/ Quelle définition de l’économie l’auteur de cet article reprend de Robbins ?
2/ Qu’est-ce que le clean identification movement ?
3/ L’économie a-t-elle pour vocation de s’imposer devant toutes les autres disciplines ?

Texte 2
« Requiem pour l’«Homo economicus », Libération, par Ioana Marinescu, Professeure
d’économie à la Harris School of Public Policy, Université de Chicago — 12 janvier 2016
à 17:11
Avec la crise financière de 2007-2008, de plus en plus de chercheurs doutent de la rationalité de «l’homme
économique». Une remise en cause de la théorie néoclassique ?
En ce début d’année, la tradition est de prendre de bonnes résolutions. Faire plus de sport, manger plus
sainement, mettre plus d’argent de côté… mais souvent en vain. La recherche montre que près de 90 % des
gens sont incapables de tenir ces résolutions. Si tous ces projets sont vraiment bons, pourquoi un individu
rationnel ne s’y tiendrait-il pas ? Apparemment, tout le monde n’est pas Homo economicus…
Je reviens tout juste de la plus grande conférence annuelle d’économistes académiques qui, cette année, se
tenait à San Francisco. J’y ai découvert la «bonne résolution» des économistes pour 2016 : mettre fin à
l’impérialisme de l’Homo economicus. L’American Economic Association (AEA) est présidée par Richard
Thaler, un économiste comportemental réputé, et aussi mon collègue à l’université de Chicago. Richard
Thaler a donné son discours présidentiel sur la remise en cause du modèle de l’Homo economicus. Un autre
grand discours à la conférence a été donné par John Y. Campbell, un économiste de la finance à Harvard.
John Y. Campbell a souligné la nécessité de l’intervention publique pour restaurer le choix rationnel parmi les
consommateurs, rien que cela !
Quand le sommet de la profession remet sérieusement en cause la théorie néoclassique, cela marque un vrai
changement d’époque. J’étais déjà frappée d’entendre de la bouche de ces économistes établis le
terme «théorie néoclassique», normalement utilisé par les critiques hétérodoxes comme Bernard Guerrien. En
effet, les économistes préfèrent se référer à la théorie «standard», pour souligner que c’est la seule théorie
acceptée. On peut spéculer sur les raisons pour lesquelles la critique de l’Homo economicus est devenue à la
mode. Mais deux causes me semblent potentiellement importantes. La crise économique de 2007-2008 a
montré les limites de la finance, et le succès international des travaux de Thomas Piketty, en 2014, a remis
l’accent sur le rôle des institutions contre les lois universelles du marché.
La montée en puissance de la critique de l’Homo economicus s’explique aussi par l’accumulation des résultats
empiriques au cours des vingt dernières années. Il est facile de montrer que les gens ne sont pas toujours
rationnels. Mais il est moins facile de démontrer que ces exceptions à la rationalité sont fréquentes, et qu’elles
sont importantes pour comprendre le fonctionnement de l’économie. Or, au cours du temps, les économistes
ont accumulé les études pour montrer que les décisions financières des consommateurs sont souvent
irrationnelles, et finissent par nuire considérablement à leur bien-être.
En particulier, l’épargne retraite complémentaire a été passée au microscope des économistes. Les gens
épargnent-ils de manière optimale pour leurs vieux jours comme le prédit le modèle de l’Homo economicus ?
Ou prennent-ils leurs décisions au petit bonheur la chance ? En pratique, l’énorme majorité des salariés
épargne exactement de la manière qui est présente par défaut dans leur entreprise. Si une entreprise a un
taux de contribution par défaut de 3 % du salaire pour la complémentaire retraite, c’est ce que la plupart des
gens épargnent. Presque personne ne se pose la question de savoir si épargner plus ou moins serait mieux.

Et quand le taux d’épargne par défaut change, la plupart des gens adoptent le nouveau taux sans réfléchir.
Autant dire que ce comportement est indigne d’un Homo economicus. Ces résultats indiquent que le
gouvernement devrait fixer par défaut un taux d’épargne retraite complémentaire adéquat pour la majorité des
gens, tout en laissant quelques rares personnes, ayant vraiment étudié le problème, ajuster leur taux
d’épargne si elles le souhaitent.
La régulation des produits financiers à destination des consommateurs était le sujet phare du discours de
John Y. Campbell que j’ai mentionné plus tôt. Selon John Y. Campbell, certains produits financiers devraient
être taxés, voire interdits, parce que les consommateurs prennent des décisions irrationnelles. Il faut apprécier
le caractère révolutionnaire de ce genre de recommandation pour un économiste «standard» comme lui :
interdire un produit financier, c’est admettre que l’Homo economicus ne décrit pas le comportement des
consommateurs, et que le gouvernement peut faire mieux que les marchés. Un exemple de produit financier
qui pourrait être interdit (et qui est déjà interdit en France) : les prêts sur salaire aux Etats-Unis, qui sont faits à
des taux usuriers de l’ordre de 400 %. Comme je le montrais dans une chronique de novembre 2014 (1), ces
prêts accroissent le risque de faillite pour ceux qui y ont recours.
En 2016, les économistes étudieront le comportement des «vrais gens» au lieu de supposer qu’ils se
comportent toujours comme un Homo economicus, et ils se creuseront la tête pour trouver des politiques
publiques qui aident ces vrais gens avec leurs vrais comportements d’Homo sapiens pas toujours très sages.
Espérons donc que les économistes se tiennent mieux à leurs bonnes résolutions que le citoyen lambda !
(1) http://www.liberation.fr/futurs/2014/11/24/etats-unis-les-pauvres-a-la-merci-du-credit-usurier_1149841
Ioana Marinescu Professeure d’économie à la Harris School of Public Policy de l’université de Chicago.
Questions
1. Quels sont les éléments qui remettent en cause le concept d’Homo-economicus aujourd’hui ?
2. Discutez des éléments soulignés dans le texte (lien épargne retraite complémentaire et rationalité) ?
II. TEST : Quel homo œconomicus êtes-vous ?
1. Entre ces deux activités, laquelle préférez-vous ?
a) faire le ménage
b) aller au cinéma
2. Vous déjeunez toute la semaine dans une cafétéria dont la spécialité est un panini que vous
appréciez :
a) vous choisissez le fameux panini à chaque déjeuner.
b) vous choisissez le fameux panini une fois sur deux.
c) vous choisissez le fameux panini une fois par semaine.

3. Vous trouvez par hasard un billet de loterie qui vous donne une chance sur deux de gagner
10 000€, mais on vous propose de racheter ici et maintenant 3000€. Que faites-vous ?
a) vous conservez ce billet de loterie.
b) vous le vendez
c ) vous le donnez à un inconnu
4. C’est l’été, vous êtes sur la plage et vous avez soif… Quel prix maximum êtes-vous prêt à payer une
même boisson rafraichissante, selon que vous l’achetez au bar de l’hôtel de la plage ou au marchand
ambulant ?
a) 4€ quel que soit l’endroit.
b) 4€ au marchand ambulant.
c) 6€ au bar de l’hôtel.
5. Vous et deux de vos amis devez décider du programme de la soirée : cinéma, restaurant ou
concert ? Chacun de vous trois exprime ses préférences :
- vous préférez le cinéma au restaurant et le restaurant au concert, donc le cinéma au concert ;
- votre ami Paul préfère le concert au cinéma et le cinéma au restaurant, donc le concert au
restaurant ;
- votre amie Sarah préfère le restaurant au concert et le concert au cinéma, donc le restaurant au
cinéma.
Parviendrez-vous à un choix commun ?
a) Oui b) Non
6. Vous visitez un pays dont vous ne connaissez pas le code de la route mais vous observez que tout
le monde conduit à gauche, vous décidez de rouler…
a) à droite comme d’habitude.
b) à gauche comme les autres conducteurs.
7. vous êtes sur le point d’acheter une veste et une calculatrice, lorsque le vendeur vous indique
discrètement que la même calculatrice est vendue 10€ moins cher dans une autre boutique à dix
minutes à pied. Dans quelle configuration de prix déciderez-vous de vous rendre à l’autre boutique ?
a) la veste vaut 130€ et la calculatrice vaut 30€.
b) la veste vaut 30€ et la calculatrice vaut 130€.
c) dans les deux cas.
8. Le superbe pull que vous aviez repéré dans une boutique très branchée unique en son genre a
soudainement augmenté de 20%, que décidez-vous ?
a) vous l’achetez quand même.
b) vous renoncez à votre achat.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%